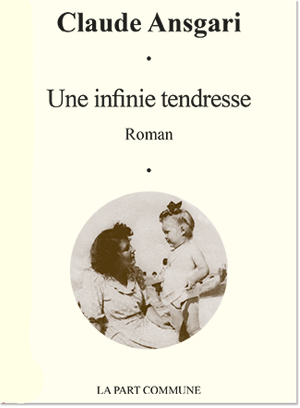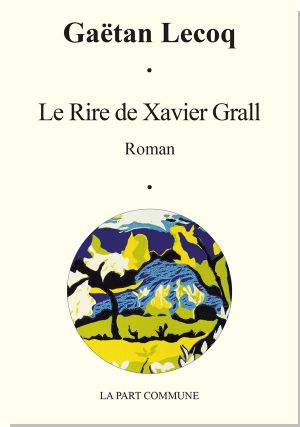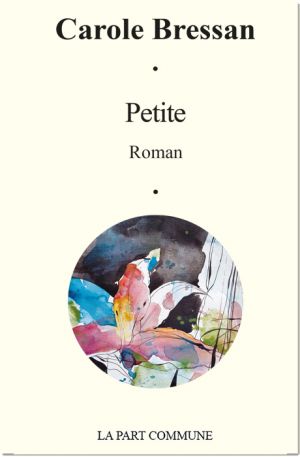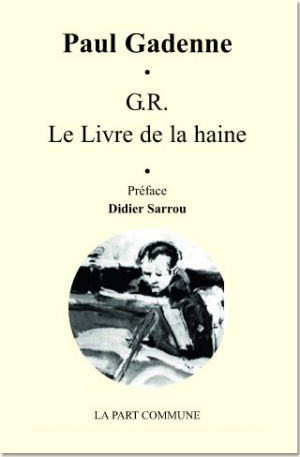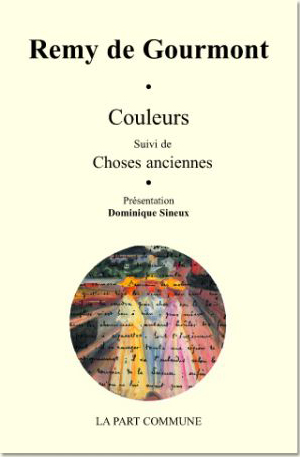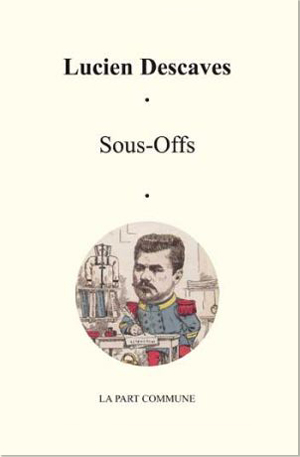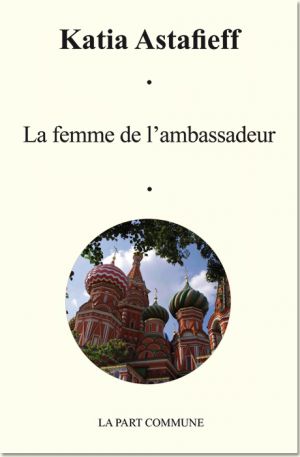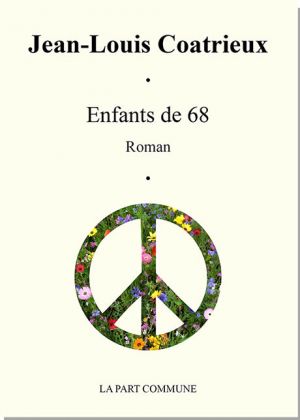Ma petite maman chérie,
Je t’écris de Stresa au bord du lac Majeur. Assise avec Elen à la terrasse d’un café devant un paysage de montagne, d’eau et d’arbres. Je suis arrivée ici après un long voyage en train, et des attentes interminables dans les gares. Un transistor diffuse une chanson niaise à la mode. Le chanteur s’égosille.
Mon cœur hurle silencieusement. C’est le premier voyage que j’accomplis sans toi. Sans pouvoir te joindre. Moi qui aimais tant te téléphoner, six ou sept fois par jour, pour entendre ta voix, pour demander de tes nouvelles, te donner des miennes. Pour te dire : « Je t’aime, maman. » Pour maintenir sans cesse vivant le lien entre nous deux. Pour te faire plaisir. Pour me ressourcer au son de ta voix. J’adorais ces brefs échanges où nous nous donnions signes de vie. Signes de vie. Ils rythmaient les journées.
Je ne sais pourquoi je t’écris aujourd’hui, quatre mois après ton départ. Je n’arrive pas à supporter ton absence. Alors, je t’écris comme je te parlerais. Ne sachant à quelle porte frapperont mes mots d’amour. À la porte de ton cœur, là où tu es désormais.
Mais où ? Cette question m’obsède depuis que tu n’es plus là. J’ai lu des livres sur l’au-delà, sur l’après-vie. Des témoignages troublants. Mais que sait-on de l’autre rive ? Je voudrais inventer une ligne téléphonique particulière pour communiquer avec toi. Tu me manques tellement. Si cruellement.
͠
Peut-être es-tu dans le chant des oiseaux, dans le sifflement obstiné des merles. Tu aimais tellement le printemps. Ma maman, ma douce. C’était la saison de ta venue au monde. Née le 17 mai 1920. Tous les ans tu aimais dire, lorsque l’hiver te faisait peur : « Vivement le printemps ! » Tu aimais voir le renouveau de la nature, découvrir les bourgeons, puis toutes les feuilles d’un vert si tendre et si fragile. Et regarder éclore toutes les fleurs.
Tant qu’il était encore possible, je t’emmenais en voiture sur la route des fleurs. Je t’invitais à admirer des camélias, puis les mimosas, puis les prunus, puis les forsythias. Les magnolias et les rosiers du Japon. Je t’invitais à la fête des fleurs.
Tu les aimais tant. Dernièrement j’ai découvert une trace ancienne si précieuse pour moi de ton amour pour les fleurs. Dans un coffret, un brouillon écrit au crayon de la rédaction pour laquelle tu avais obtenu la note glorieuse de 19 sur 20. Était-ce lors du brevet élémentaire ou à une autre occasion ? Je ne sais plus. Ce succès t’avait donné une légitime fierté. Ma maman poète. Il s’agissait de comparer les mérites des fleurs achetées chez les fleuristes et ceux des fleurs des champs. Je n’ai pas pu déchiffrer tous tes mots à cause des pliures du papier. « Et les modestes fleurs des champs, écrivais-tu, dans leur simplicité touchante, dans leur grâce exquise, ne sont-elles pas dans la nature ce que sont dans la vie de l’homme toutes ces petites joies et ces superflus ? C’est pourquoi il faut aimer les fleurs des champs, leur douce image, leur frêle beauté, parce qu’elles seront toujours pour les humains l’emblème de ce qui rend la vie plus belle et plus agréable. »
Il y avait une dimension philosophique dans ton développement, remarqué pour cette raison. Ta conclusion convenait à ta simplicité naturelle. Ton essai s’achevait par une apologie des fleurs des champs.
Tu aimais les marguerites ! Combien de fois sommes-nous allées en cueillir le long des routes où elles poussent à foison en mai. J’arrêtais la voiture près des fossés, en bordure des petits chemins de campagne et nous allions chercher celles qui s’offraient à nous. Nous en ramenions des brassées. Arrivées à la maison nous composions un grand bouquet dans un large vase. Tu le contemplais avec bonheur.
Je voudrais t’offrir toutes les marguerites de la terre, ô ma douce, ma tendre chérie… Peut-être ce présent auquel je rêve parvient-il jusqu’à toi. Peut-être là où tu es, selon l’expression consacrée, peux-tu contempler des jardins, des prairies en fleurs. Peut-être dans l’au-delà vit-on un éternel printemps… Tu le mériterais tellement. Vivre une éternelle jeunesse dans un émerveillement sans fin. Ma maman, tu étais ma petite fille émerveillée. Si facile à contenter, si prompte à t’enthousiasmer. Ton âme avait la fraîcheur et la beauté des fleurs.
Ton amour des fleurs a duré toute ta vie. Je ne perdais aucune occasion pour l’encourager. Quand nous habitions ensemble dans la maison de mon enfance et de mon adolescence, tu ramenais souvent du marché des bouquets de dahlias rouges et jaunes. Tu ramenais parfois une branche de cerisier. Je t’ai vue aussi confectionner des bouquets d’automne assemblant avec goût des branches cueillies lors de nos promenades à la campagne. Tu savais, à partir de détails harmonieusement disposés, créer de la beauté.
Tout au long des années, années si heureuses, ô ma douce, ma tant aimée, je t’ai offert toutes sortes de fleurs. Beaucoup de roses. Mais tu avais la tristesse de les voir se faner. O ma maman, je voudrais par mes mots, mes pauvres mots, créer pour toi un bouquet d’immortelles.
Peu à peu, je t’ai offert des fleurs que tu pouvais replanter dans une courette que tu avais aménagée en petit jardin. Je t’ai offert des hortensias bleus assortis à la couleur de tes si beaux yeux. Je t’ai offert des lauriers roses et des agapanthes. Ton « jardinet » était ta création et ta fierté. Je t’ai prise en photo dans ce lieu aimé. Je t’ai photographiée devant des roses trémières de toutes les couleurs. Je t’ai même filmée dans ce petit jardin.
J’ai eu du mal à regarder ces images. Mais tout me fait mal. Je porte en moi une si profonde douleur qui me suit partout. Une douleur qui a ton nom, ma maman, mon amour. Une douleur à la mesure de notre infinie douceur, de notre infinie tendresse. O toi qui me donnais tant de joie et de paix.
Je t’ai offert aussi beaucoup d’orchidées, dont tu prenais grand soin dans l’ancien magasin transformé en salon, puis en chambre. Mon dernier cadeau, dans la maison de retraite médicalisée où tu avais dû être placée, en raison de tes problèmes respiratoires, a été une splendide orchidée de couleur fuchsia, la plus belle de tout le magasin. Je te l’ai offerte le deuxième jour de ce terrible mois de janvier. Tu pouvais un peu la voir depuis ton lit où tu restais clouée, sous oxygène et souvent sous perfusion. O ma maman patiente, qui se plaignait si rarement. Ma mère courage, ma mère bravoure.
͠
Durant une dizaine d’années nous avions pris l’habitude d’aller chaque printemps à la pointe de la Torche. C’était une fête pour nous deux, une fête pour nos yeux, de contempler les champs de tulipes, de toutes formes et de toutes les couleurs. Un vrai régal. J’avais l’habitude de te prendre en photo devant un champ de tulipes. Tu m’offrais ton plus beau sourire. Tu laissais faire, non par narcissisme, mais pour me laisser un souvenir de toi. Un joli souvenir. Nous avions l’habitude aussi, avant de repartir, de nous offrir mutuellement un bouquet de tulipes rouges. Couleur de la vie. C’était l’une des expressions, multiples, de notre complicité, de notre mutuelle tendresse. Nous avons pu vivre ces escapades bienheureuses jusqu’à l’âge de tes quatre-vingt neuf ans. Avant de repartir, nous buvions souvent un verre dans un café. Moment si simple et si précieux. Au retour à la maison tu me disais : « Merci pour la belle journée. » C’était ma récompense. Je t’avais fait plaisir. Comment exprimer la nostalgie poignante de ces moments ? Tout semblait si simple, si sûr et en même temps si fragile…
La dernière fois tu étais tombée en arrière en sortant d’un parking. Un homme était venu m’aider à te relever. J’avais eu si peur… Heureusement tu n’avais pas eu mal. Je m’étais reproché de n’avoir pas pu éviter ta chute.
Deux mois après ta disparition qui m’a brisé le cœur, j’ai fait une intervention publique sur mes livres. Accompagnée par Elen, sans laquelle je n’aurais pu vivre cet événement. Je n’avais pas voulu remettre cette rencontre. Et je n’avais pourtant aucune envie de m’y rendre, tant j’étais blessée, atteinte au plus profond. J’avais décidé de parler de toi. Je t’ai rendu hommage en pleurant. C’était le risque à courir. À la fin de la rencontre, l’organisatrice est venue me dire : « Il y a quelque chose pour vous. » Comme on dit dans un hôtel : « Il y a un message pour vous. » Elle m’a offert un bouquet de tulipes. Je l’ai reçu comme un cadeau de toi pour me féliciter de mon courage. Et dehors, dans la rue, j’ai pleuré comme si j’avais reçu un signe de l’invisible. De ta part. Ceux qui ont perdu une personne chérie guettent ainsi désespérément des signes de vie…