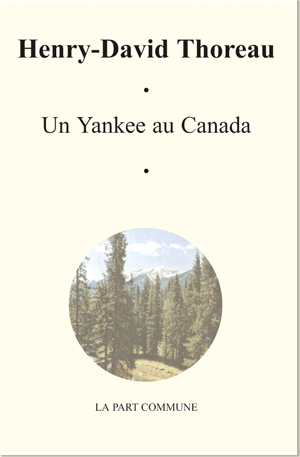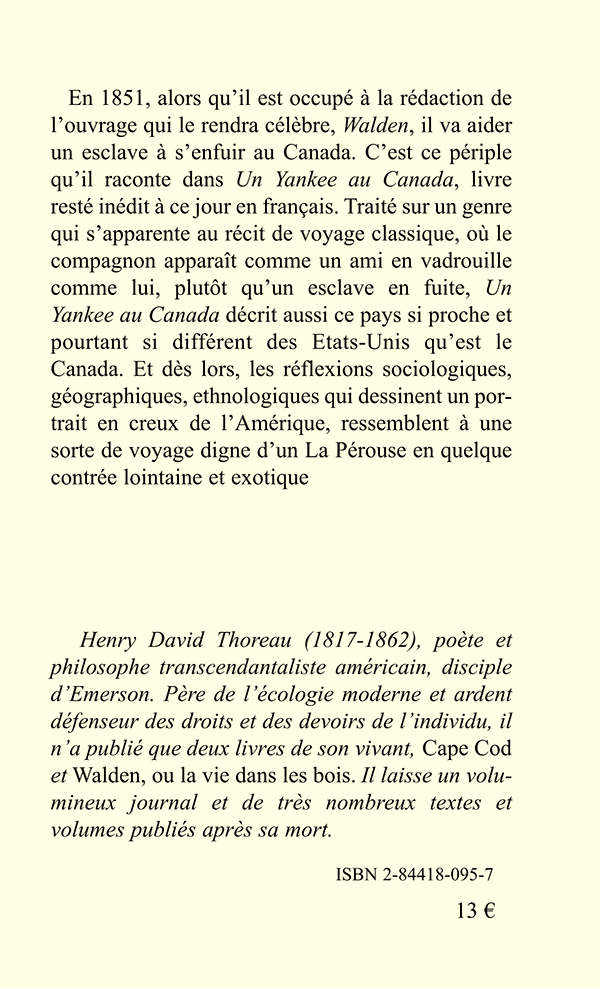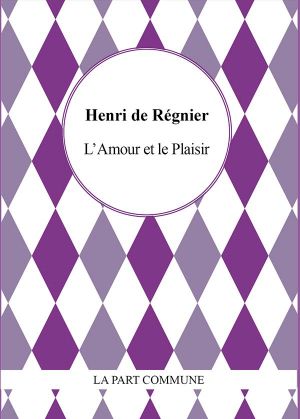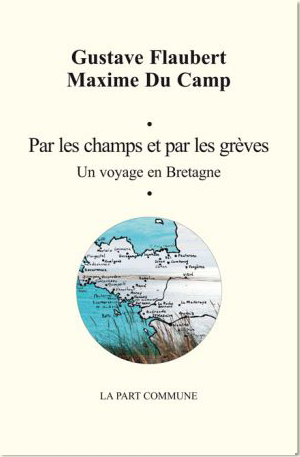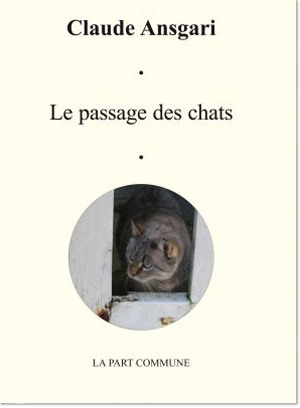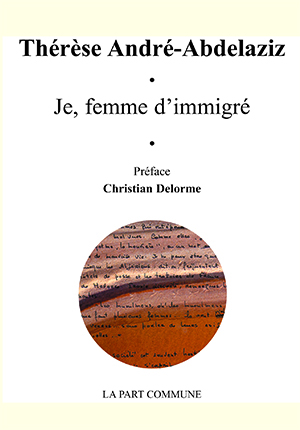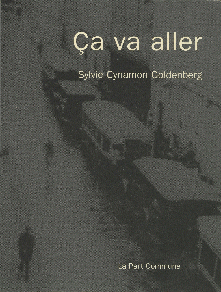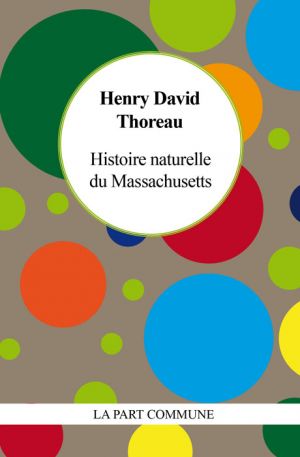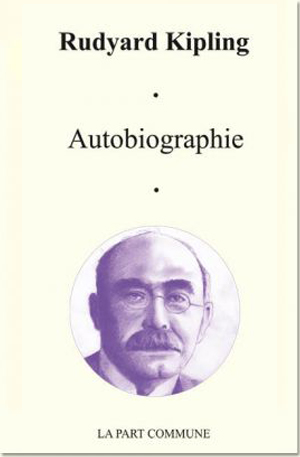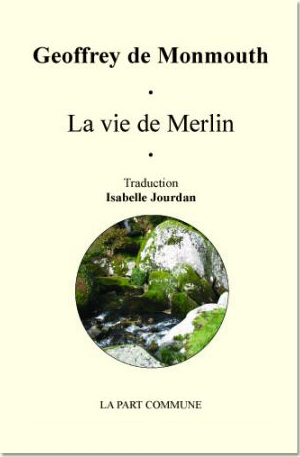Chapitre I.
De Concord à Montréal Je crains fort d’avoir peu à dire sur le Canada, n’en ayant pas vu grand-chose. Tout ce que j’ai attrapé en allant là-bas, ce fut un bon rhume. J’ai quitté Concord, dans le Massachusetts, le mercredi 25 septembre 1850 au matin, destination Québec. Prix du voyage aller retour : sept dollars ; distance de Boston : cinq cent dix miles ; contraint de quitter Montréal dès le vendredi 4 octobre, soit dix jours plus tard. Je ne prendrai pas la peine de donner au lecteur le nom de mes compagnons de voyage. Ils étaient, à ce qu’on dit, quinze cents. Tout ce que je voulais, c’était débarquer au Canada et y faire une authentique randonnée, comme j’aurais fait dans les bois de Concord, un après-midi. Dès Fitchburg, le pays était entièrement nouveau pour moi. À partir d’Ashburnham, alors que nous roulions à vive allure, je remarquai que les feuilles de vigne vierge (Ampelopsis quinquefolia) avaient désormais changé de couleur et qu’elles semblaient draper d’une écharpe rouge les troncs d’arbres morts sur lesquels elles s’étaient nichées. C’était un spectacle émouvant en soi, qui n’était pas sans évoquer une effusion de sang ou rappeler tout au moins la vie militaire, à la façon d’une épaulette ou d’un ruban, qu’on aurait pu dire rougis par le sang coulant de ces arbres blessés dont elles ne parvenaient pas à stopper l’hémorragie. Car l’automne ensanglanté était là, et une véritable guerre indienne se livrait dans la forêt. Ces arbres d’allure martiale paraissaient très nombreux, à cause de la rapidité même de notre course qui reliait entre eux ceux que quelques miles séparaient pourtant. La vigne vierge préfère-t-elle l’orme ? Cinq ou six miles avant d’arriver à Fitzwilliam, nous commençâmes à apercevoir le Mont Monadnoc, mais c’est à partir de Troy que nous vîmes mieux cette montagne, et de plus près. Puis ce furent les tranchées et les digues à Troy. La Keene street fait d’emblée très bonne impression au voyageur ; elle est large, plane, droite et longue. J’ai entendu une de mes proches, qui est née et qui a grandi ici, raconter qu’on pouvait voir un poulet courir à un mile de distance. Je me suis aussi laissé dire que quand cette commune a été créée, on y avait tracé une rue de quatre perches de large, mais qu’au cours d’une rencontre ultérieure des propriétaires, l’un d’eux s’est levé et a fait remarquer : « Nous ne manquons pas de terrain, alors pourquoi notre rue ne ferait-elle pas huit perches de large ? » Du coup, ils votèrent pour que la route fît huit perches de large et depuis, la ville est connue dans les environs et au-delà pour sa belle rue centrale. C’était une façon peu onéreuse de s’assurer confort et célébrité en même temps, et je souhaiterais que tous les nouveaux villages s’en inspirent. Il vaut mieux rêver de grandes choses quand on est jeune, car le terrain est alors bon marché et il est toujours facile de restreindre ses visées par la suite. Il faut que les jeunes gens soient ainsi préparés, au moyen de grands parcs et de larges avenues, à nous faire de vénérables vieillards à l’esprit libéral ! Que l’esprit de tout jeune homme ait de grandioses perspectives, comme la ville de Washington, conçu pour que sa vie soit un succès éclatant, digne d’admiration, quand tous les emplacements auront été bâtis et que les projets du fondateur auront été réalisés. J’aime à croire que tous les petits garçons de la Nouvelle-Angleterre commenceront par tracer dans leur tête une Keene street, large de huit perches. Je connais un homme comparable à la ville de Washington, dont tous les terrains n’ont pas encore été arpentés ni jalonnés, et où le seul bâtiment, exception faite d’un groupe de cabanes éparses, est le Capitole. À tout moment, on peut voir, à distance, ses projets grandioses, nés des mêmes aspirations que les rues spacieuses mais encore vides. Keene street est bâtie sur une bande de terrain très large et plane, pareil au lit d’un lac, et les collines qui l’entourent sont suffisamment éloignées pour permettre de belles promenades. Le paysage de ces villes situées sur les flancs des montagnes est, d’ordinaire, trop encombré. Une ville construite dans une plaine plutôt vaste, ceinte à bonne distance par des collines qui ne bouchent pas l’horizon, offrent les meilleures promenades et les plus belles vues. à mesure que nous progressions vers le nord-ouest, les érables, les hêtres, les bouleaux, les ciguës, les épicéas, les noyers cendrés et les sorbiers devenaient de plus en plus nombreux. Pour le voyageur de passage, le nombre d’ormes dans une ville est l’aune de sa civilité. Dans notre compartiment, un homme a sur lui une bouteille remplie d’alcool. Toute la compagnie sourit chaque fois qu’il l’exhibe. Je n’éprouve aucune difficulté à me retenir. La région de Westmoreland est des plus charmantes. J’ai entendu un passager expliquer l’origine on ne peut plus évidente de ce nom, West-more-land, comme étant purement américaine, et on avait l’impression qu’il venait de faire une véritable découverte ; mais je ne pus m’empêcher de penser à « mon cousin Westmoreland » en Angleterre. Personne ne peut oublier le moment où il arrive aux abords de Bellows-Falls, au pied d’une falaise impressionnante surplombant le Connecticut. Je ne laissai pas d’être décontenancé par la taille du fleuve à cet endroit. Il paraissait réduit à un simple torrent de montagne. Le niveau du courant était évidemment très bas. Les rivières que nous avions traversées en cette matinée relevaient davantage du cours d’eau de montagne que celles qui coulent aux alentours de Concord, et je fus très surpris de voir un peu partout des traces de crues récentes qui avaient emporté des ponts et endommagé la voie de chemin de fer, bien que je n’en eusse pas entendu parler. À Ludlow, Mount Holly et au-delà, on tombe sur un paysage montagneux des plus intéressant, ni accidenté ni démesuré, mais un paysage dans lequel on peut entreprendre aisément une excursion, longues vallées étroites au bout desquelles se déploie l’horizon. On est alors au cœur des Montagnes Vertes. Aux alentours de Mount Holly, on peut voir quelques pics bleutés un peu plus élevés, parmi lesquels, peut-être, Killington Peak. Par endroits, comme sur les chemins de fer du Grand Ouest, on est entraîné sur des remblais montagneux, d’où les chevaux effrayés dans les vallées semblent réduits à la taille de simples chiens. Toutes les collines rougissent. M’est avis que l’automne est la meilleure saison pour voyager, même dans les Montagnes Vertes. On s’exclame souvent in petto : Comme ces érables sont rouges ! L’érable à sucre ne l’est pas autant. On en voit quelques uns avec des taches rosées qui font penser à des joues, rougissant d’un côté seulement comme un fruit, tandis que tout le reste de l’arbre est vert, preuve que la lumière ou les gelées se sont montrées partiales, ou bien que certaines branches ont été plus précoces que d’autres. On voit un grand nombre de grands frênes élancés dont le feuillage a pris une couleur de mûre foncée. Le noyer cendré, qui est un arbre qui s’étend beaucoup, devient complètement jaune, ce qui atteste de sa parenté avec le noyer blanc d’Amérique. J’ai aussi été frappé par les teintes jaune vif du bouleau jaune. L’érable à sucre possède un « pied » remarquablement dessiné. Les bocages que forment ces arbres ressemblaient à d’immenses forêts de huttes, où les branches s’arrêtant à hauteur d’uniforme, à quatre ou cinq pieds au-dessus du sol, tels des avant-toit, comme si elles avaient été coupées avec art, de sorte qu’on pourrait regarder dans le bocage avec sa voûte feuillue, un peu comme sous une tente dont l’auvent a été relevé. Quand on approche du Lac Champlain, on commence à apercevoir les montagnes de New York. La première vue que l’on a du lac à Vergennes est impressionnante, mais davantage par association que par une quelconque particularité du paysage. Il est là, si petit (sans commune mesure avec la taille de l’État tel qu’il est représenté sur la carte), mais si beau et calme, comme une reproduction du Lac de Lucerne sur une boîte à musique, où l’on devine le mot Lucerne dans le feuillage, bien plus beau qu’il n’est jamais apparu sur la carte. Il ne dit pas : « Me voici, je suis le Lac Champlain », comme pourrait le faire le conducteur, mais après avoir étudié la géographie durant trente ans, on traverse une colline un après-midi et le voilà ! Mais on en a ici qu’un aperçu. À Burlington, on court vers un quai et on embarque à bord d’un bateau à vapeur à deux cent trente-deux miles de Boston. Nous avions quitté Concord vingt minutes avant que huit heures du matin ne sonnent, et nous étions à Burlington sur le coup des six heures du soir, mais trop tard pour voir le lac. Nous n’eûmes notre première belle vue du lac qu’à l’aube, juste avant d’atteindre Plattsburg, et nous vîmes des chaînes bleues de montagnes de part et d’autre, dans l’État de New York et celui du Vermont, particulièrement impressionnantes dans le premier. On pouvait apercevoir au loin quelques schooners blancs comme des mouettes, car il n’a pas l’aspect désolé et solitaire d’un lac en Tartarie, mais c’était un spectacle dont on ne pouvait pas dire grand-chose. Aussi ai-je remis à un autre jour ma description du Lac Champlain. La plus ancienne référence à ces eaux que j’ai trouvée figure dans le récit par Cartier de la découverte et de l’exploration du Saint-Laurent en 1535. Samuel de Champlain a en fait découvert et remonté le lac en juillet 1609, onze ans avant l’établissement de la colonie de Plymouth10, en accompagnant un détachement militaire d’Indo-Canadiens contre les Iroquois. Il dit des îles qui constellent le lac qu’elles sont inhabitables bien qu’elles soient fort agréables, en raison des guerres continuelles entre Indiens, qui les ont obligé à quitter fleuves et lacs pour s’enfoncer dans les terres, afin de ne pas être attaqués par surprise. « Continuant notre routte », dit-il, « dans ce lac du costé de l’Occident, considérant le pays, je veis du costé de l’Orient de fort hautes montagnes, où sur le sommet y avoit de la nege. Je m’enquis aux Sauvages si ces lieux estoient habitez : Ils me dirent qu’oui, & que c’estoient Hiroquois, & qu’en ces lieux y avoit de belles vallées, & campagnes fertiles en bleds, comme j’en ay mangé aud[it] pays, avec infinité d’autres fruicts. » C’est là la première description de ce qui est aujourd’hui le Vermont.