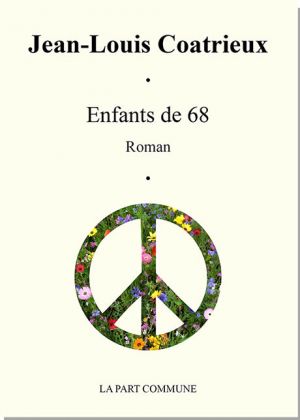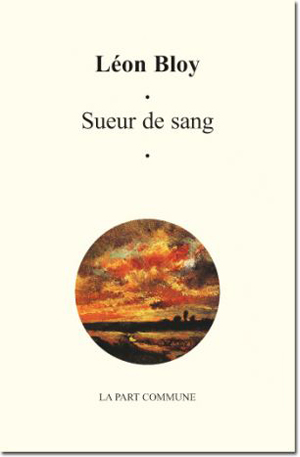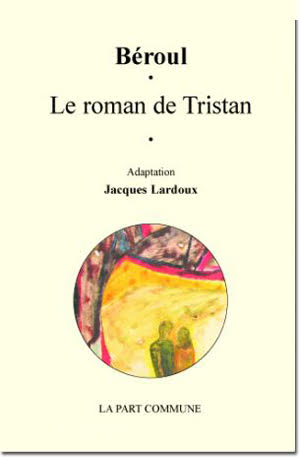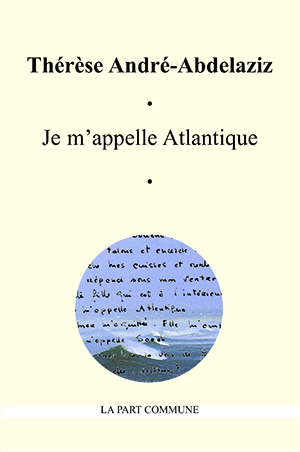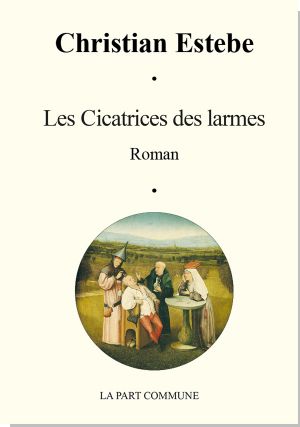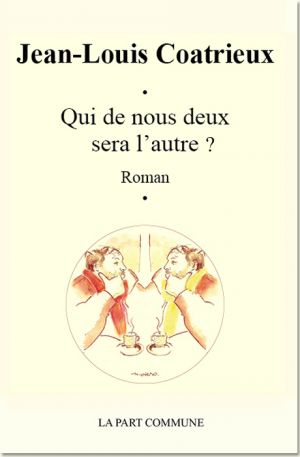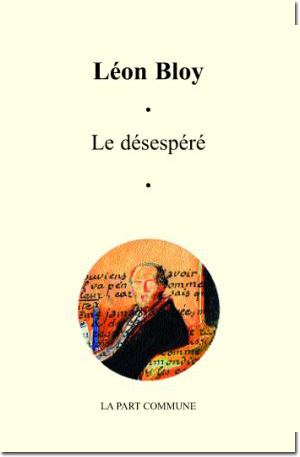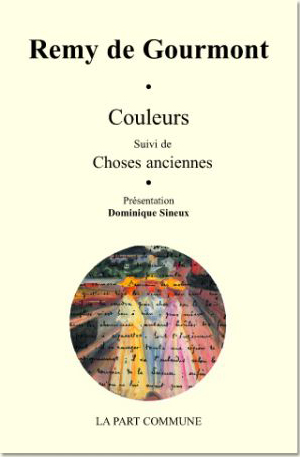Le maître d’amour
Quatre mois de voyage entre Brindes et Tomes. Dès qu’on débarque dans la ville de fer, il y a le vent nu, sans odeur. Il y a la mer privée de sa couleur de mer, une sorte de marais dormant dont la teinte est diluée par les eaux du Danube inférieur, on dit l’Hister.
Posée non loin de l’embouchure du fleuve, Tomes est peuplée par des barbares, des Grecs, et une petite colonie romaine. Au-delà de ses murailles, il n’est rien hormis des mines, de nouvelles murailles, des terres gorgées d’eau. C’est le dernier poste-frontière de l’empire, sur les bords du Pont-Euxin, la mer hospitalière. Son nom se révèle vite mensonger, il ne dit pas la sensation immédiate de bout du monde quand on pose le pied sur le rivage. Ni le climat effroyable, le froid si vif, expliquera plus tard l’exilé, que le vin s’y boit par morceaux. Pour l’instant, celui de son débarquement, il n’a d’yeux que pour les hommes emmitouflés dans des braies et peaux cousues. Seuls leurs visages apparaissent, pas rasés, mal encadrés de longues chevelures hirsutes, en désordre. Et leurs bouches qui remâchent des mots affreusement rugueux. Quelques pas sur le port, presque aussitôt un double exil commence. Exil de l’oreille et du regard.
Tomes devenue aujourd’hui la station balnéaire de Constantza. Le lieu de villégiature des apparatchiks. J’ai été à Constantza et je n’ai pas vu la mer décolorée. Je n’ai pas rêvé sur la piata Ovidio, la grande place de la ville aujourd’hui, de son office de tourisme. J’en ai à peine lu le nom, ignorant alors qu’on pouvait être condamné à mourir au bout du monde pour s’être immobilisé un instant de trop au seuil d’une porte entrouverte.
Publius Ovidius Naso, Ovide en terre italienne, s’appellera simplement Nason au rivage barbare, trop éloigné de lui-même pour conserver son nom romain. Pendant sept ans, il envoie des lettres sur sa terre d’origine, elles constitueront les cinq livres des Tristes (pour dire latin Tristia ou Tristium libri), les quatre des Pontiques (Epistulae ex Ponto). Dès le début, il conseille à ses correspondants de les lire en eux-mêmes, taciti secum, sans que personne ne puisse les entendre.
à quatre siècles de distance, Augustin s’étonnant de la lecture de saint Ambroise, de son regard sur les pages, note que ni sa langue, ni ses lèvres ne bougeaient. Ses raisons, la peur des questions d’un auditeur ou le désir de ménager sa voix, ne pouvaient être que bonnes chez un homme comme lui. Hasard des palimpsestes. Le plus ancien manuscrit des Pontiques, tronqué, réduit à vingt-cinq vers, est recouvert au VIIème siècle par un fragment des Confessions (celui de l’œil de silence de saint Ambroise ?), dans la rencontre des phrases qui réaffleurent, mains mêlées à travers les couches de cire.
Lisez-moi, lèvres muettes, répète Nason à ses amis. Soyez prudents. En utilisant des mots sonores, vous risqueriez d’être accusés de complicité, mais surtout de raviver la fureur d’Auguste et ma blessure. Or, ajoute-t-il, une partie de ce qui m’est arrivé, je n’ai pas le droit de la désigner plus clairement, doit disparaître avec moi. Puisse mon tombeau l’ensevelir.
Deux fautes ont provoqué sa perte et son exil, carmen et error. Il ne cesse de revendiquer la première, grave, pardonnable pourtant. Celle d’un livre, unique dans son genre, un Ars Amatoria. Un traité technique pour apprendre non les jeux d’osselets, de dés ou du cerceau, mais ceux de l’amour. Un art de manier au mieux son corps. Un manuel des positions les plus propices au plaisir, des recettes pour le faire naître et durer.
Le reste de l’origine de la catastrophe tient en un mot, erreur plus que faute, faite de hasard, d’inconscience. Sa teneur n’est révélée ni démentie par son auteur.
Les livres d’exil de Nason prendront toujours la forme de lettres à sa famille, ses amis, à des familiers de l’empereur, du prince, comme il se plaît souvent à l’appeler. Mais sans nom de destinataires. Aujourd’hui encore, leur identité reste incertaine, hormis pour Auguste et sa propre femme, carissima, ma chérie, prénom soigneusement laissé dans l’ombre. Sa demande sans doute.
Dans la lenteur de ses courriers à Milena, Kafka résumera la souffrance de toute correspondance. Un commerce avec des fantômes, non seulement avec celui à qui on s’adresse, mais avec le sien propre. Le fantôme croît sous la main qui écrit.
Destinataires privés de visage, lettres qui errent des mois sur des mers hostiles avant d’arriver à Rome, qui se perdent, n’obtiennent pas de réponses ou des réponses devenues absurdes un an plus tard. Quand Nason les rédige, il se parle à lui-même, prête à ses amis les sentiments qu’il souhaite les voir éprouver, faits de manque, d’anxiété, de nostalgie de sa présence, l’appétit les fuit et le sommeil, la nuit leur est interminable. Il ne peut écrire ces phrases mélancoliques sans les boire, sans s’en engraisser. Penché au-dessus de son épaule, son fantôme grandit à toute vitesse.
Ses correspondants doivent lui rappeler à chaque fois leur refus d’être désignés. Il se devine à la façon dont Nason veut l’entendre d’abord. Ses Tristia sont alors un émouvant chant d’amitié. Tu te reconnais, j’en suis sûr, tu aurais maintenant envie de dire en public c’est moi. Tu sais bien, et tu t’en réjouis, que cher ami remplace ton vrai nom.
Le banni les rassure avec patience. Ne t’inquiète donc pas, notre amitié a été assez brève pour que tu puisses la dissimuler sans mal. Il dit sa vigilance de tous les instants pour rester fidèle à sa promesse. Nouveaux courriers, nouvelles variantes. N’ayez pas peur d’être cités, je ne vous tirerai pas de l’ombre où vous vous cachez. Je ne marquerai pas le moindre détail susceptible de vous faire reconnaître, je redoute trop de vous nuire.
Très vite, le ton est moins amène. Après quelques supplications, si seulement tu me permettais d’inscrire ton nom pour rappeler notre amitié, Nason ne résiste pas à la tentation de jouer avec leurs craintes. Il leur confie volontiers la bêtise qu’il a été bien près de faire, je ne plaisante pas, j’ai failli, entraîné par mon ardeur, laisser échapper ton nom (à son correspondant de trembler, une autre fois peut-être). Ou, à propos des clins d’œil et signes de reconnaissance disséminés dans les lignes : peut-être en ai-je abusé et t’ai-je nommé. Si tu es trahi, c’est la faute de tes qualités. Et, dans une autre lettre, un jeu supplémentaire proposé à un ami bien prudent, une devinette. Si tu veux un indice pour être sûr que c’est toi à qui je parle, le voilà, discret, rassure-toi. Invisible aux yeux de tous, tu me portes partout à ton doigt. Suivent quelques vers consacrés à l’anneau à l’intérieur duquel, à l’abri des regards, Hygin ou un autre de ses proches (nul n’osera aller vérifier) a gravé le nom et logé un minuscule portrait du proscrit.