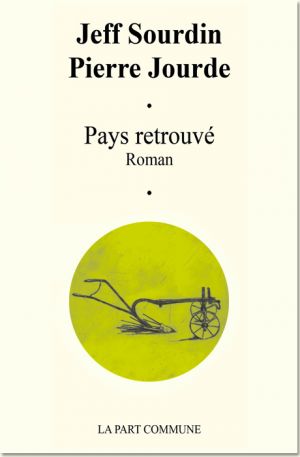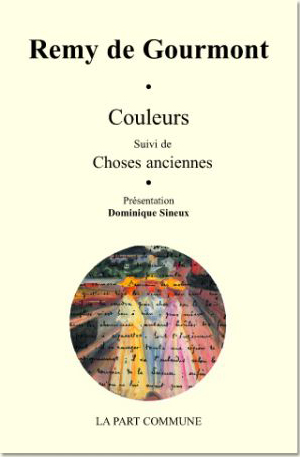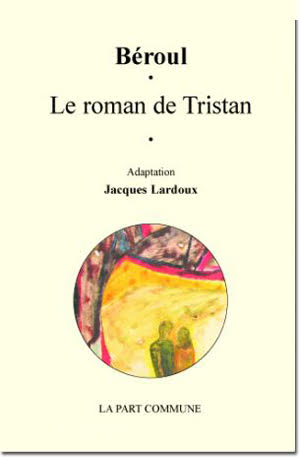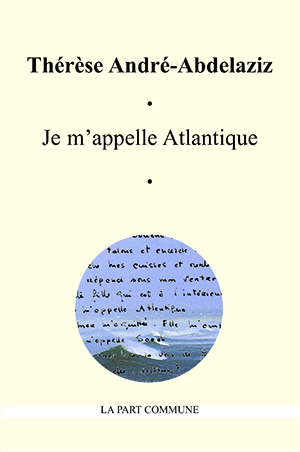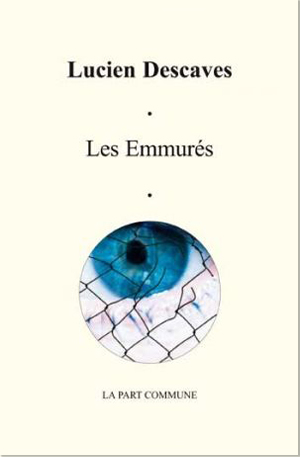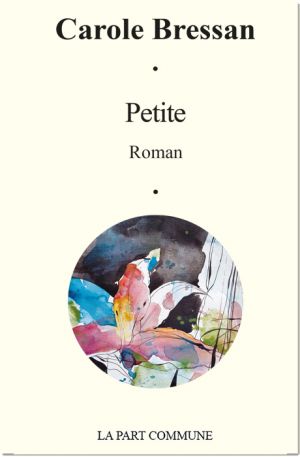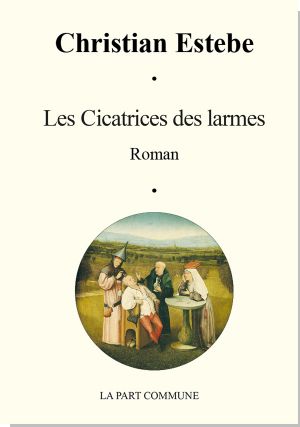C’est à la mort de mon père que je me suis acheté le complet.
Un complet-veston gris clair. Gilet, pantalon, veste du même ton et une chemise d’une teinte plus foncée. C’était la première fois que je m’achetais un complet et le vendeur avait été si charmant que j’aurais eu des scrupules à ressortir du magasin sans lui avoir rien pris.
D’un complet, je n’avais nul besoin dans un quotidien que j’occupais essentiellement à laisser passer le temps. Je n’en avais pas davantage les moyens mais je m’étais dit que c’était maintenant ou jamais. Il n’y aurait pas meilleure occasion, j’avais déjà quarante-huit ans.
J’ai gardé le complet sur moi et je me souviens qu’une fois sorti dans la rue, je me suis presque surpris à siffloter. Il faisait beau pour un mois de mars et l’espace d’un instant, j’ai même oublié la raison de ma présence dans cette partie de la ville. J’ai arpenté la rue Nationale d’un pas nonchalant et ai pris sans autrement me concerter la direction du jardin public. Je me sentais bien dans mon tout premier complet et cela devait faire un sacré bout de temps que cela ne m’était pas arrivé.
Au jardin, je suis resté un long moment à admirer la vue : le château était très beau sous le soleil et je n’étais pas pressé de le quitter. Évidemment en rentrant dans mon deux pièces, j’ai retrouvé mon lot de soucis, ceux que j’avais plus ou moins réussi à domestiquer au fil des années, et les récents, liés aux préparatifs funéraires.
J’étais fils unique et n’en tenais pas rancune à mes parents. Ils avaient fait ce qu’ils avaient pu avec le peu de tendresse que la vie leur avait légué et le quotidien qu’il avait bien fallu affronter. Avec du travail pour presque dix et un revenu pour un seul, nous tirions le diable par la queue. Nous ne sortions pas, avions peu de loisirs et d’amis. Nos seuls interlocuteurs étaient des cultivateurs avec qui mes parents s’entraidaient lors des corvées ou des travaux dans les champs. À vivre ensemble tous les trois du matin jusqu’au soir, presque coupés du monde, nous n’avions souvent plus rien à dire si bien qu’au final, nous échangions surtout des silences.
Lorsque maman avait pris son tour pour nous quitter, papa avait tout arrangé pour la cérémonie. Il ne m’avait rien demandé, pas même de dire un mot à l’église. De peur peut-être de devoir en dire un, lui aussi. Taiseux, nous l’étions de père en fils. Je m’étais laissé guider, absent à moi-même. Nous l’avions veillée trois jours, veillant surtout à nous tenir bien droits côte à côte au cimetière. Ça avait été à peu près tout de notre hommage.
Maman avait été emportée très vite, lassée de vivre, une maladie dont on ne guérit pas. Je n’habitais déjà plus avec eux à ce moment-là. À dix-huit ans, j’étais parti en ville, dans une chambre d’une taille ridicule mais adaptée à ma solitude. Dans ma mansarde, où seule une petite lucarne donnait un aperçu du ciel, je pensais que si je mourais dans l’instant, une éternité pourrait s’écouler avant qu’on ne me retrouve.
Mon père était très malade mais ne m’en avait rien dit. Je l’avais peu vu depuis les étrennes et son médecin traitant m’expliqua par la suite qu’il avait beaucoup baissé depuis. Quand l’hôpital m’avait appelé, c’était critique. Quelques heures plus tard, c’était fini.
Je me suis senti un peu perdu, seul dans le couloir et je suis allé me chercher un café à la machine. Je ne savais pas ce que je devais faire, faire un tour m’a paru déjà pas si mal. Je leur en voulais de me laisser tout seul. Bien sûr, c’était un peu tard pour les reproches mais, à ce moment-là, j’aurais bien aimé avoir une sœur ou un frère à appeler. Pour se dire trois fois rien mais tout de même ça aurait fait du bien.
À choisir, j’aurais préféré avoir une sœur. Je crois que pour ce genre de situation, les sœurs sont ce qui se fait de mieux.
J’ai appelé mon cousin Éric, qui n’était pas sûr de pouvoir venir à l’enterrement, puis mon oncle Alfred, qui a eu du mal à comprendre l’information. Pas à cause de l’émotion, Alfred était sourd comme un pot, mais je n’avais pas le cœur à hurler dans le téléphone. Mes cousines vivaient loin, nous avions perdu le contact et les autres membres de ma famille étaient déjà morts.
C’est à l’hôpital qu’ils m’ont demandé comment je pensais m’occuper du mort. C’est la première fois, j’ai dit pour m’excuser, et eux, pas de souci, on va vous conseiller.
De braves gens, au moins aussi chics que mon vendeur de complets.
Une société funéraire s’est occupée de tout, ça coûtait bonbon mais papa avait encore quelques économies. Vous n’avez rien à faire, nous vous laissons vous concentrer sur votre peine. C’était une quinquagénaire blonde au visage amène qui parlait. Me concentrer c’était bien ça le problème, j’avais jamais bien su faire, mes pensées partaient toujours dans tous les sens mais je me suis appliqué. J’ai pensé à notre dernière discussion. Au téléphone. La météo. Il s’était plaint du mauvais temps, satané rhumatisme, et j’avais dû répondre que c’était vrai, l’hiver était encore bien présent.
Des coups de fil comme ça on en avait partagé des centaines.
C’est risible, de telles banalités, mais je crois vraiment que ça nous convenait à tous les deux. On n’aurait pas voulu d’une autre relation.
La responsable m’a demandé ce que je voulais pour l’annonce dans le journal. Est-ce que le modèle classique me convenait ? C’est ma première fois, j’ai répété, je faisais confiance ; le classique c’est très bien, elle a répondu.
Le jour de l’enterrement, je suis allé avec mon complet-veston puisque je n’avais ni frère ni sœur ni ami pour m’accompagner. Je me suis assis au premier rang, réservé à la famille. Comme dans la chanson, j’étais devant, j’étais derrière, j’étais tout seul au premier rang.
La famille, c’était moi.
Enfin, quelques personnes étaient venues quand même. Des cultivateurs de Bonneterre essentiellement. Deux ou trois familles de Château d’eau. Des copains de Saint-Martin. Des connaissances et des voisins.
La cérémonie s’est bien déroulée. Le prêtre a bien dit deux trois idioties sur la vie éternelle mais je n’ai pas eu le cœur de les relever, et puis ça n’aurait pas plu à mon père qu’on se fasse remarquer, alors je me suis fait tout petit dans mon complet et j’ai bien écouté tout le reste.
Au cimetière, il n’y avait que le prêtre, les employés de la société funéraire et moi. L’éloge fut rapide, la mise en terre éclair et le temps que je dise merci, merci à tous, ils s’étaient volatilisés. J’ai dit au revoir papa et je suis rentré chez moi.
Je ne sais pas pourquoi j’ai remis le complet le lendemain, le jour d’après et tous les autres jours qui ont suivi.
Je crois que le premier matin, c’était par négligence. Je me suis habillé comme la veille – comme je fais à peu près tout le temps. Cette journée-là, je n’ai rien fait d’extraordinaire mais j’ai trouvé agréable de me balader avec mon complet. C’était comme une activité en soi. J’ai vu aussi que le regard des autres n’était plus le même. On me donnait du monsieur partout et j’ai même eu droit à des sourires de vieilles demoiselles.
Le jour suivant, je crois que le même cérémonial s’est répété. Ne sachant quoi me mettre sur le dos, j’ai mis mon complet. Je crois aussi que ça me faisait penser à mon père.
Ce rituel a duré un mois.
Trente jours.
Ce matin, matin radieux du mois d’avril, j’ai décrété que c’était terminé. J’ai rangé le complet dans l’armoire, où les cintres sont plus nombreux que les fripes. Le complet n’a pas eu l’air fâché de pouvoir souffler un peu. Il n’a pas pris une ride sur le veston. Ni tâché ni abîmé, rien du tout. Le vendeur avait raison, c’est vraiment de la belle qualité.