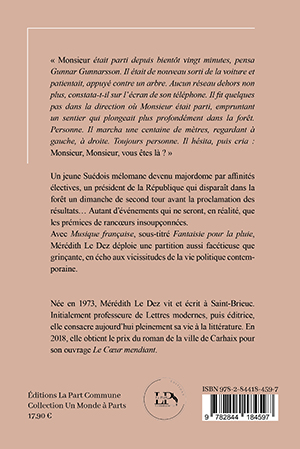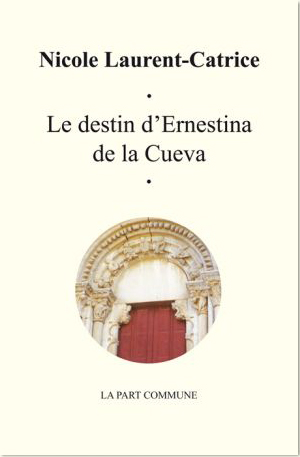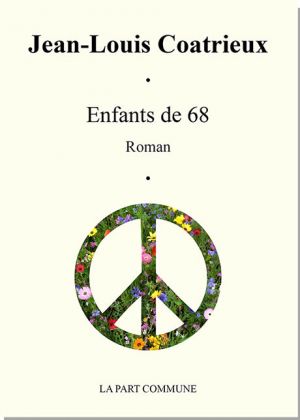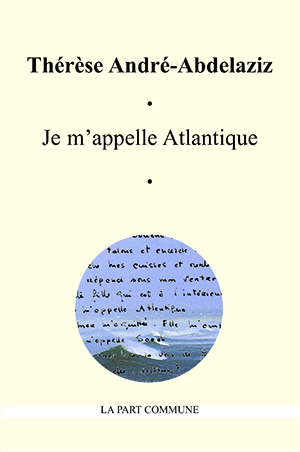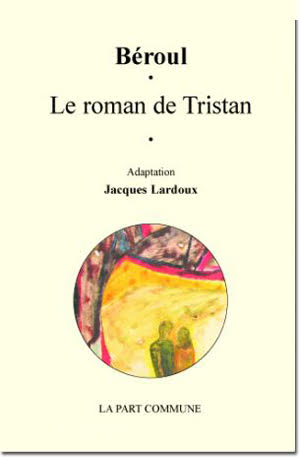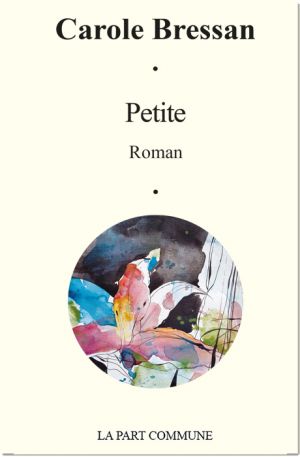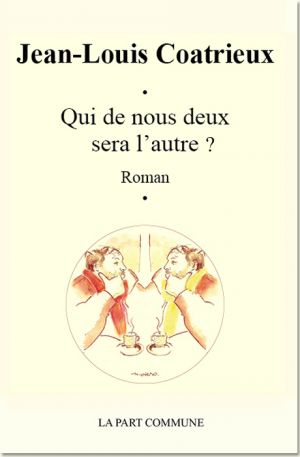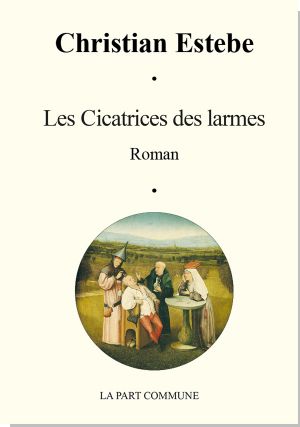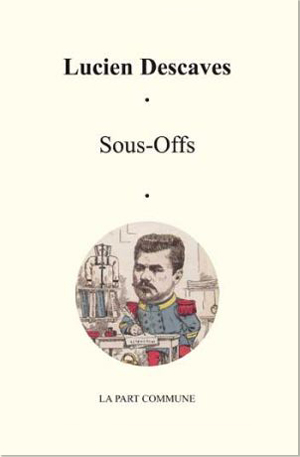Prélude
Il avait fermé les yeux. La pluie distinctement tombait note après note sur le toit de la voiture. Il ne l’entendait pas. Il s’était assoupi. Quelques minutes, un instant. Il plongeait. C’était encore la campagne française telle qu’il l’avait imaginée. Une petite ville au bord de la forêt. De la gare jusqu’à la maison, trois kilomètres à pied qu’il avait parcourus, la première fois, tellement tendu vers son but après un si long voyage depuis son nord lointain qu’il en perdait le souffle. La Maison. Enfin.
Presque cent ans plus tôt, Maurice Ravel, après une dizaine de déménagements entre Paris et ses environs, avait acheté une bicoque à Montfort-l’Amaury. La maison s’appelait Le Belvédère. Construite au début du XXe siècle, elle offrait depuis pratiquement toutes ses pièces un vaste panorama sur les toits de la cité, l’église, le château, et sur la campagne, en bordure de la forêt de Rambouillet où le compositeur avait pris ses habitudes de promenade. Ce n’était pas une maison de grand style, non. Elle était petite et peu pratique. On a souvent plaisanté sur le fait qu’elle était bâtie à la mesure de son hôte dont la taille ne dépassait pas un mètre soixante et un. Un pavillon sur deux niveaux qui ne communiquaient pas entre eux quand Ravel l’avait acquis, flanqué d’une terrasse et d’un jardin lui aussi exigu, pour en faire son royaume, un univers bizarrement raffiné dans le moindre détail et qui ne laissait pas de fasciner les visiteurs, jusqu’au jardin remanié en paliers, avec son bassin à jet d’eau dessiné par le nouveau propriétaire et sa pelouse japonaise. Une maison d’esthète, assurément. Près du piano du maître veillait le portrait de sa mère, décédée quatre ans avant son installation au Belvédère et dont il pleurait la mort avec un désespoir qui augmente au fil du temps. C’était la maison d’un solitaire et d’un homme de bonne compagnie tout à la fois. Elle était suffisamment éloignée de la capitale pour préserver sa tranquillité et suffisamment proche pour accueillir temporairement les amis. Pendant six ans, Ravel avait restructuré en profondeur le pavillon, lui ajoutant deux ailes et cloisonnant les pièces. Il y en avait désormais huit. Le salon de musique en était le cœur vibrant. Ravel y composa sur son Érard demi-queue le fameux Boléro, mais aussi L’Enfant et les sortilèges, entre autres merveilles.
Finesse et fantaisie. Féérie. L’émerveillement ne l’avait plus quitté depuis qu’il avait mis les pieds la première fois au Belvédère avant d’en devenir, passagèrement, le guide. Tant d’objets étonnants et délicats, babioles de rien faisant illusion ou pièces rares de collectionneur, en si peu d’espace. Il se souvenait, entre autres délicieuses curiosités, de la cage dorée où chantait un rossignol miniature aux ailes faites de vraies plumes. Il imaginait Ravel actionner le mécanisme pour regarder l’oiseau battre des ailes et l’écouter chanter avec une joie d’enfant, naïve et généreuse, partageant son plaisir avec ses amis artistes. Il rêvait à ceux-ci, égrenant quelques noms d’écrivains pour lui illustres, et pour tant d’autres tombés en désuétude, Tristan Klingsor, Léon-Paul Fargue, Colette, Jacques de Lacretelle… « Ravel l’enchanteur », pensait-il. Dans la bibliothèque du Belvédère, riche de près de mille volumes, des éditions rares témoignaient encore de son goût pour la littérature française en particulier, La Fontaine, Molière, Racine, Balzac, Hugo, Proust, ou encore les œuvres originales de poètes : Baudelaire, Mallarmé, Valéry…
Ravel l’enchanteur, avait-il déclaré pour le définir d’un seul mot, à ce couple de visiteurs inattendus qui s’attardaient plus longuement que les autres et qui la semaine suivante étaient revenus avec une proposition pour lui. La femme souriait, intriguée, le dévisageant avec attention, comme si elle cherchait à élucider une très vieille énigme dont il faisait partie depuis toujours alors qu’elle ne l’avait jamais vu auparavant. L’homme, plus éloquent, voulait parler musique. Comme beaucoup de visiteurs érudits, dont certains, parfois animés d’une passion jalouse, semblaient vouloir mettre à l’épreuve ses connaissances, il l’interrogeait précisément sur le génie de Maurice Ravel, à travers l’œuvre la plus commentée du compositeur, le Boléro, dont les circonstances de création étaient tout à fait particulières, s’agissant d’une commande dont la réalisation avait rencontré des difficultés inextricables, Ravel ayant été contraint de renoncer pour une question de droits à ses projets initiaux. Trois semaines avant la première des ballets à L’Opéra de Paris, Ravel avait dû annoncer à la danseuse et mécène Ida Rubinstein, son amie, qu’il ne pourrait honorer la commande. Et pourtant, en trois semaines, il l’honora…
« Ce qui me restait à faire était d’imaginer une partition sans musique, entendez qui ne me pose aucun problème musical, puisque je n’avais pas le temps de composer de la musique. Restait à choisir une idée vraiment simplette, que tout le monde pourrait siffloter à la sortie tellement elle serait ridiculement simple, et puis, là-dessus, faire un devoir d’orchestre. Je me suis donc dit que j’allais montrer ce qui se passe dans un orchestre, en partant du haut d’une partition, c’est-à-dire la flûte, et en descendant jusqu’à la contrebasse. Restait à montrer les mariages plus ou moins subtils qu’on peut envisager entre les divers pupitres, jusqu’au moment où, ayant fait entendre tout l’orchestre, et ça fait un bruit terrifiant, survient inopinément, et de façon saisissante, une modulation vers une tonalité voisine, puis un rapide retour au ton initial et enfin une conclusion à l’accent angoissé qui rappelle celle de la Valse. »
Le jeune guide avait retracé l’histoire de ce succès universel, la musique la plus jouée dans le monde, en citant, pour conclure, les propos de Ravel commentant son travail.
« Ce n’est qu’un petit maître, pourtant, qui n’a pas révolutionné la musique. » Il y avait, dans ce jugement sentencieux, malgré tout, une pointe d’étonnement et du défi, comme si celui qui l’avait prononcé n’attendait qu’une chose, être dédit. L’homme, sûr de lui, avait enfourché le vieux refrain tellement entonné par d’autres avant lui, comme son père et son grand-père, et dont on pouvait lire l’appréciation quelque peu sévère à peu près énoncée en ces termes dans une histoire de la musique des origines à nos jours : la bibliothèque familiale dont il avait hérité conservait l’édition originale dédicacée par l’auteur, un fameux mélomane, plus connu pour son fascisme et son antisémitisme, Lucien Rebatet. Le jeune homme en découvrirait le volume quelque temps plus tard au côté de celui d’Émile Vuillermoz, musicographe de renom, dans une autre maison en lisière de forêt, une vaste maison où sans être dérangé il aurait tout loisir, lui avait-on dit, de se perdre en cultivant sa fantaisie.