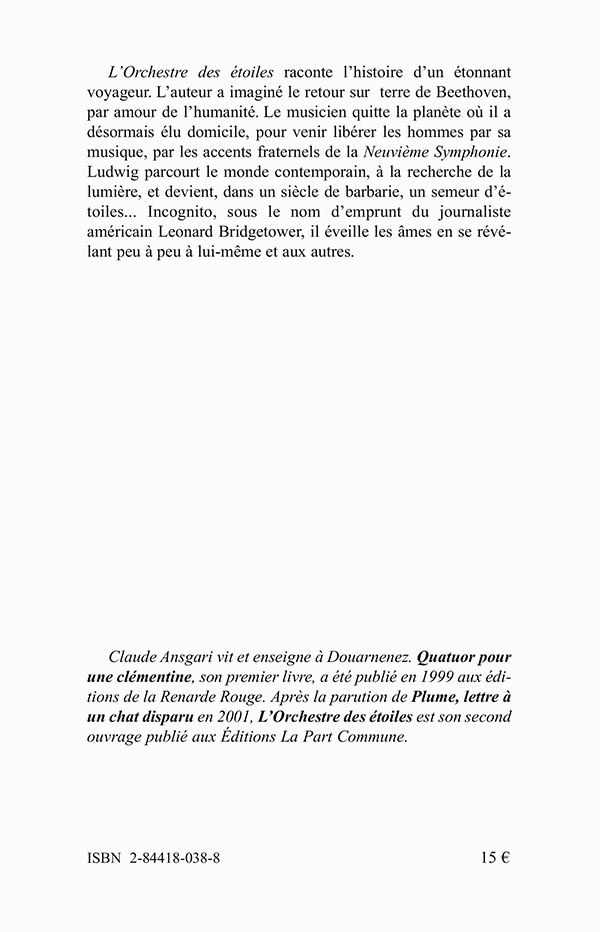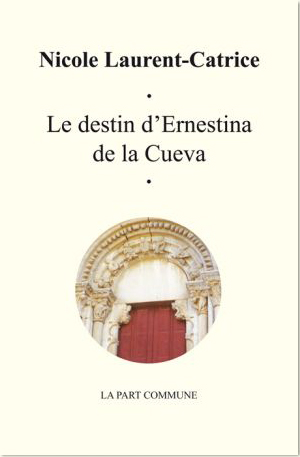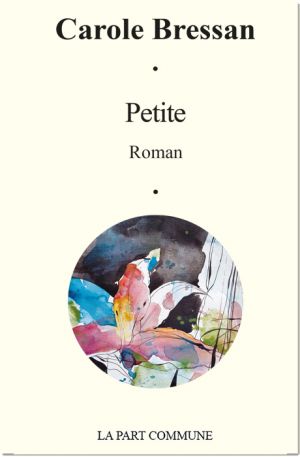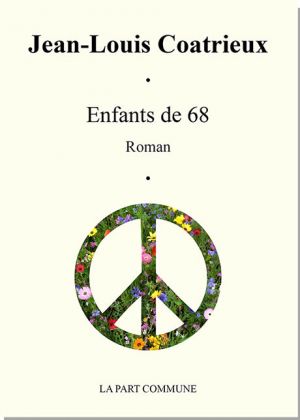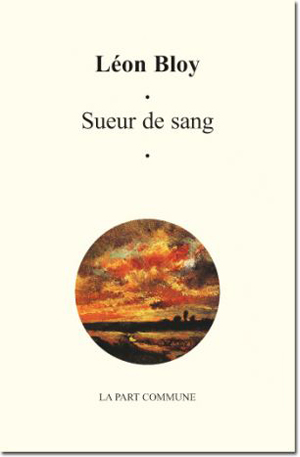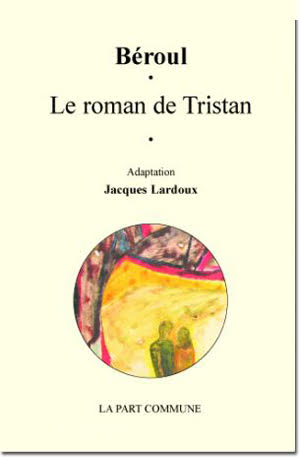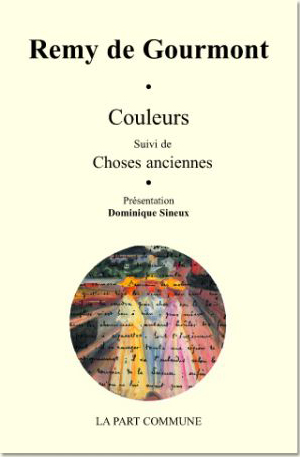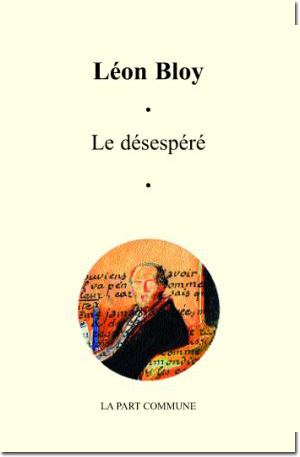Ainsi errait, dans les rues de New York, Ludwig van Beethoven, tel qu’il pouvait apparaître autrefois vers l’âge de quarante ans : le visage plein d’énergie, aux traits léonins, la bouche large et ferme dans une expression de grande volonté, le menton affirmé et creusé d’une fossette, les yeux grands et bruns brûlant de passion, le front haut et noble, la chevelure abondante, un peu ébouriffée en crinière. Il avait voulu rester fidèle à son image. Seulement, pour passer inaperçu dans cette Amérique où tout semblait attiré par le ciel (les fusées, les maisons et les humains), il avait effectivement beaucoup grandi : il mesurait à présent près d’un mètre quatre-vingt-dix.
C’est dans un même souci de discrétion qu’il décida de changer de nom. En gardant ses initiales il choisit de s’appeler Leonard Bridgetower. Il prit le prénom du célèbre peintre italien et le nom du violoniste virtuose qui avait joué la première fois sa Sonate à Kreutzer : un métis au grand talent. Par amour de la liberté, il lui plaisait de porter le nom d’un homme de couleur dans un pays longtemps déchiré par l’oppression des Noirs et leur lutte pour l’égalité. Beethoven lui-même avait le teint si brun, qu’on le croyait autrefois d’origine espagnole…
En avançant dans les rues de New York, sans but précis, sans connaître son chemin, Ludwig avait en tête les dernières paroles d’Ariel : « Tu risques d’en voir de toutes les couleurs… Surtout, n’oublie pas de t’amuser ! »
Il s’arrêta devant la porte d’un cinéma, où l’on passait des films de Charlie Chaplin. Il eut envie d’entrer dans la salle, mais s’avisa qu’il était sans argent. En fouillant machinalement dans ses poches, il eut la surprise d’y trouver une grande liasse de dollars. En lui donnant l’accolade d’adieu, Ariel, son ange gardien avait veillé à lui laisser ce viatique pour son passage sur la terre.
C’est en noir et blanc que Ludwig découvrit le monde de l’image. Il adora le personnage de Charlot, dépassé par l’univers des objets, souvent victime de la bêtise des hommes, mais plein d’ingéniosité pour se sortir des situations les plus critiques. Il riait de ses mésaventures, mais éprouvait de la compassion pour ce bonhomme innocent, qui s’en allait sur les chemins, le baluchon au bout d’un bâton. Dans la situation qui était à présent la sienne, Ludwig pouvait s’identifier à ce voyageur maladroit. Le goût du rire s’épanouissait en lui. Il devint un spectateur assidu des films de Woody Allen. Il comprit en voyant Manhattan que les gratte-ciel pouvaient avoir leur poésie. Il prit plaisir aux bavardages new-yorkais et aux tourments de la psychanalyse. Et puis Woody Allen choisissait tellement bien les musiques de ses films, que c’était un vrai délice de se trouver dans une salle obscure à savourer la musique si profondément, que parfois, les yeux fermés de bonheur, Ludwig en oubliait de regarder l’écran !
Sa passion de la musique, son engouement récent pour l’image et la couleur en firent un amateur averti du cinéma de Stanley Kubrick. Il fut enthousiasmé par 2001 l’Odyssée de l’espace, par les évolutions de la capsule spatiale dans l’immensité du cosmos au rythme d’une valse de Strauss. Il eut envie d’applaudir en voyant Barry Lindon scandé par une sarabande de son cher Haendel, celui qu’il considérait jadis comme le plus grand musicien. Il se sentait chez lui au cinéma. Il fut même étonné que l’invention humaine n’eût pas plus tôt uni les couleurs et les sons.
C’est alors qu’il découvrit Orange mécanique du même cinéaste. Le titre lui sembla d’abord bizarre, comme une contradiction dans les termes. Mais l’étrangeté, l’originalité l’attiraient. Il vit le film et en fut horrifié. Même si, en y réfléchissant plus tard avec calme, il comprit qu’il s’agissait d’une condamnation de la violence sous toutes ses formes, il ne put supporter I’association de la musique et des atrocités commises par une bande de voyous, dont le chef se prétendait l’admirateur fanatique de la Neuvième Symphonie de Ludwig van… et particulièrement de ce scherzo que le compositeur avait voulu débordant d’une énergie libératrice. Il ne put endurer d’entendre sa musique déformée, car elle était transformée au point d’être presque méconnaissable : il manquait des notes, d’autres y étaient ajoutées, les tempi étaient sacrifiés, défigurés en une danse infernale. Et les horreurs commises sur sa musique lui étaient intolérables. On l’entendit crier dans l’obscurité de la salle : « Ce n’est pas ma musique, ce n’est pas ma musique ! » Les spectateurs le rappelèrent à l’ordre par des « chut ! » insistants et agacés.
Fou de douleur, Ludwig quitta le cinéma, en claquant la porte. Il aurait voulu écrire une lettre de protestation au cinéaste, faire interdire le film. Mais à quel titre et de quel droit ? Voilà que le plus farouche partisan de la liberté se découvrait le plus sévère des censeurs. Il s’était rarement senti aussi accablé. L’expérience du camp de Todfolterverzweiflungsdorf l’avait largement renseigné sur les bas-fonds de l’âme humaine, mais cette fois-là il avait pu intervenir, sauver le musicien et sa musique, détruire les assassins. N’y avait-il rien de changé ? La frontière entre le mal et le bien était-elle si fragile, que l’on pouvait à tout moment basculer de l’un à l’autre, transformer le bien en mal, déformer une symphonie de la joie et de la fraternité en une mascarade funèbre de la destruction ?
Désespéré, il marchait dans les rues de New York en découvrant dans chaque humain rencontré un monstre toujours possible. Il faillit courir, hurler d’épouvante, mais parvint à se maîtriser, en se persuadant que la face terrible de l’homme n’était pas forcément celle qui l’emporterait…