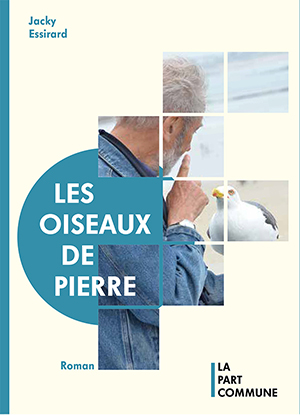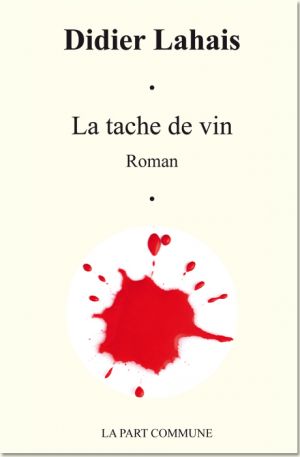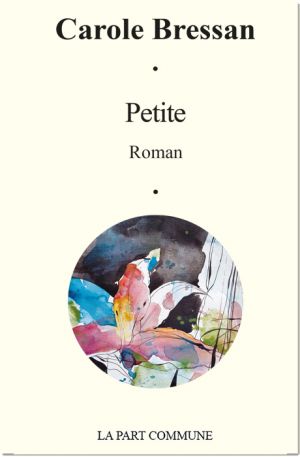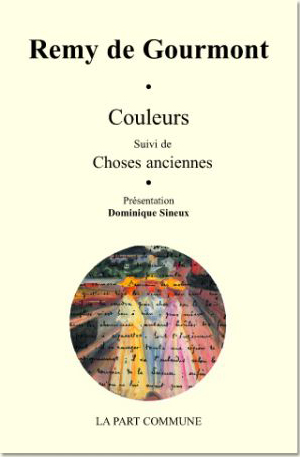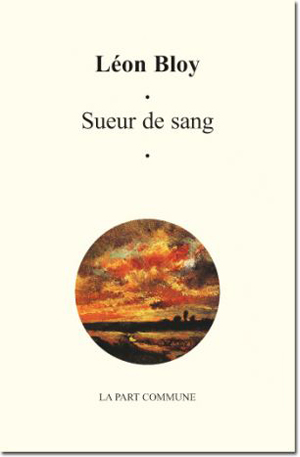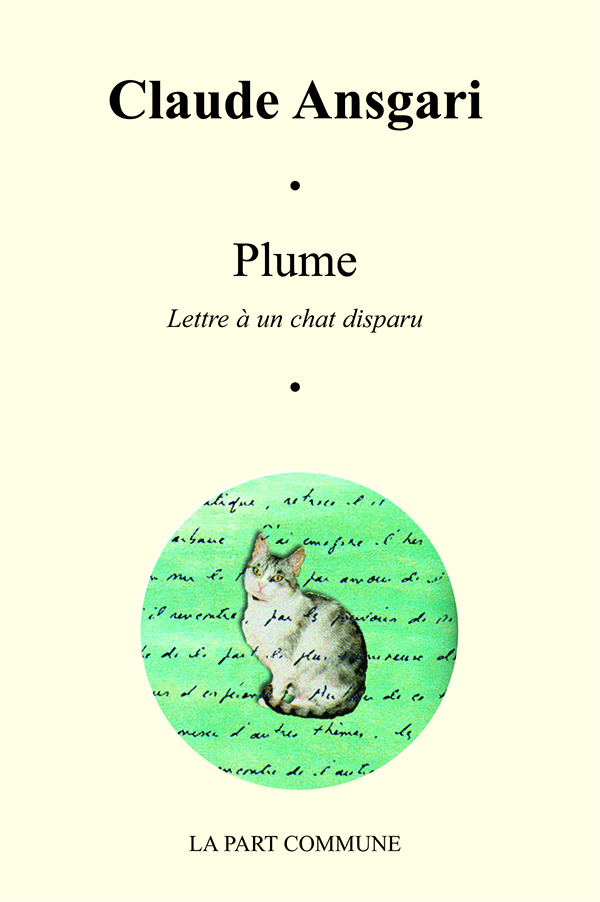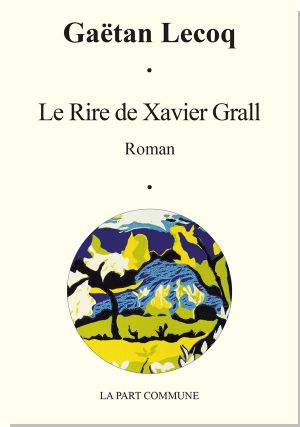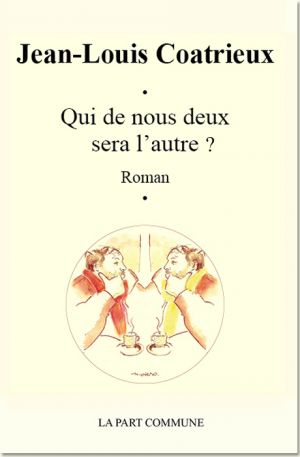1
Une voix nasillarde annoncée le terminus. Le hurlement du freinage emplit tout l’espace et le train s’arrête avec des crissements et des secousses
dignes d’un vieux western. J’avais voyagé dans le wagon de queue et je dus remonter le quai pour gagner la sortie. J’entraînai avec moi une dizaine
de passagers mais je fus le seul à avoir besoin d’un taxi. Un lampadaire solitaire éclairait le parking devant la gare. Les tables et les chaises de la brasserie étaient empilées dans un coin de la terrasse. Le couvre-feu semble être tombé sur la place. Il restait quarante kilomètres pour atteindre
le port où je devais embarquer. Un taxi accepte la course au prix fort et quelques minutes plus tard nous roulâmes en pleine campagne, traversant une
zone de prairies et de cultures qui, sous le disque de la pleine lune, baignait dans une clarté laiteuse.
Puis la route commençait à gravir une colline. Elle serpenta au milieu d’une forêt dense de feuillus que les phares savaient brièvement dans leur double cône de lumière. La pente se fit plus raide et virage après virage la voiture attaqua le haut du massif. Le chauffeur qui jusqu’ici n’avait pas été bavard leva les yeux vers son rétroviseur et m’adressa la parole.
– Vous êtes déjà venu ?
– Non, c’est la première fois. L’endroit est sinistre.
On dirait que la forêt retient toute la nuit dans ses arbres.
Il s’esclaffa.
– Il n’y a que les bêtes et les chasseurs qui vivent là. C’est une forêt très ancienne. Il y a beaucoup de légendes.
– Le massif date de l’ère primaire.
Je commençais à étaler mes connaissances. La conversation prit de la hauteur et le chauffeur préféra garder un cap moins technique.
– L’endroit où vous allez est un peu plus gai, surtout l’été. L’hiver il n’y a que les pêcheurs. Après le prochain village, nous serons presque arrivés.
Le conducteur redevient silencieux. Aucun chemin, aucune trouée. La forêt s’oppose à toute pénétration du regard. Je regardai par la vitre les
sapins qui comme des fantômes surgissaient de l’ombre pour replonger dans l’anonymat. Et cette alternance quasi hypnotique m’entraînait vers un
pays où la réalité se mêlait à l’imaginaire. Nous quittâmes la protection des arbres pour déboucher sur la crête. Des dents schisteuses perçaient la
végétation rase. Je retrouve le décor des légendes celtiques et cette atmosphère lourde et angoissante des Monts d’Arrée, la nuit.
Le maléfice ne dure pas. Le taxi descendit l’autre versant et j’aperçus les maisons basses d’un village. Pierres grises, coiffées d’ardoises, je
ne repèrai qu’un seul commerce. L’église se déroule bizarrement à l’écart, sur une butte, accompagnée des croix du cimetière. Aucun passant ne hantait la rue principale. Toute la vie du village se dissimulait derrière les portes et les volets clos.
Une dernière habitation et l’automobile ont continué et la descente. C’était comme si nous reprenions la route dans l’autre sens. Les mêmes virages et la
même forêt lugubre avec au-dessus l’œil rond et pâle de la lune qui appelait les sorcières au sabbat.
Enfin nous sortîmes de la sapinière. La route plate et rectiligne se dirigeait maintenant vers l’océan. Je regardai par la vitre arrière : le village dominait les arbres de sa masse géométrique. La lune s’est présentée à l’aplomb du triangle du clocher. Ma montre indiquait 21 heures 45. Dans quelques minutes
je serais sur le quai d’un petit port de pêche où un bateau m’attendait. Je rencontrerai la femme qui avait répondu au téléphone et qui veillait sur Manuel Canaro depuis deux ans.
Mon voyage en taxi s’acheva devant un bar dont les fenêtres étroites laissaient filtrer un faible lueur. Je payai la course et saisis mon sac dans le coffre. La voiture fit demi-tour et repartit vers la ville me prévint seule.
29 mai 2007. La lettre de Manuel Canaro était arrivée trois jours plus tôt. L’écriture sur l’enveloppe, petite, tremblée, était une mauvaise copie de celle que je connaissais. Avant même de la décacheter j’avais pressenti les ennuis de santé du peintre. Cela s’était confirmé à la lecture. Quelques mots au centre de la page m’annonçaient sa maladie et demandaient à venir d’urgence.
Je n’avais pas vu Manuel Canaro depuis deux ans mais j’entretenais avec lui une correspondance épisodique. Notre première rencontre remontait à
une exposition en 1987 dans une galerie du Marais. Subjugué par le personnage et l’œuvre, j’avais suivi son ascension et commencé sous son égide une activité de biographe et de critique d’art sans rapport avec mon métier de professeur d’histoire. Travail pertinent de l’amitié et de la curiosité au départ, je m’étais intéressé à d’autres artistes et j’avais lâché le lycée. Je gardais un privilège privilégié avec celui qui m’avait initié à la peinture et décidé de ma vocation. La lettre était explicite, la maladie ne lui laissait que peu de temps à vivre. Je réglais quelques affaires avant de prendre le train à Montparnasse et cinq heures après j’étais sur un quai désert, sur la côte Nord de la Bretagne, attendant, espérant qu’on me remarque et qu’on m’appelle.
Le cliquetis des haubans et le ressac étaient les seuls bruits dans la nuit qui commençait. L’ambiance me rappelait une ancienne Série noire, quand le héros, col de veste relevé, fumait une cigarette enfoncée contre le pot d’un lampadaire.
Il manquait la pluie. J’avais donné l’heure de mon arrivée et ne voyais personne. Pas de message sur mon téléphone. Je me résignai à entrer dans le bar. La salle était basse et petite, saturée de fumée et d’odeurs fortes de sueur et de vinasse. Il y avait trois hommes accoudés au zinc, paupières mi-closes, regards suspects. Je saluai et demandai si par hasard quelqu’un parmi eux était chargé de me déposer sur l’île.
Ils se regardèrent.
– T’es au courant qu’y a un parisien qui va sur l’île ?
Le patron derrière le bar posa son ballon de rouge.
– Ouais c’est pour le peintre. La p’tite a pas pu venir.
Je m’étonnai.
– Comment je fais ?
– Ben c’est trop tard pour passer, faut attendre demain matin avec la navette.
Je grognai et montrai ma mauvaise humeur.
– Quelqu’un peut m’emmener ce soir, je paierai la double traversée.
J’espère une réponse mais ils reprennent leur discussion, m’ignorant souverainement. Alors je m’adresse au bistrot.
– Vous avez une chambre ?
Un large sourire relève ses joues mal rasées.
– Pas de chambre, vous pouvez dormir sur la banquette si ça vous dit.
Et d’un geste ample il me montra le mobilier en skaï rouge derrière la table longue. Il ajouta :
– C’est pas large mais si on ne bouge pas.
Il se fichait de moi mais le choix était restreint. Je ris pour ne pas paraître idiot, j’accepte le défi et payai ma tournée. Aussitôt l’ambiance se fit chaleureuse et on me demanda un commentaire je m’appelais. Thomas.
Comme le saint a répondu le patron. On trinqua à l’apôtre puis à chacun de nous. Vers minuit il agita la cloche et ferma la porte à clef derrière ses clients.
Je me couchai à moitié ivre. C’est de cette manière que cette histoire a commencé.