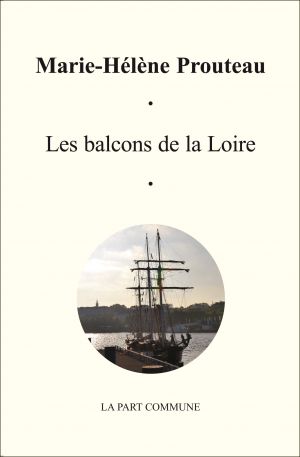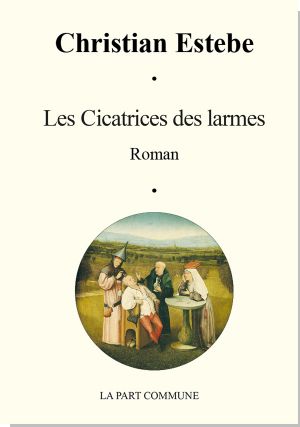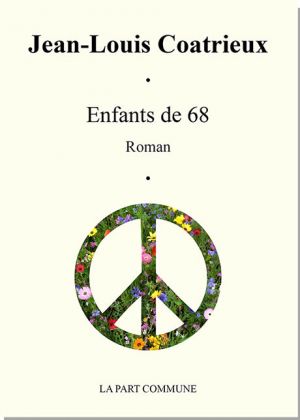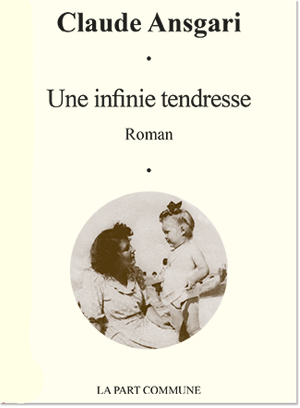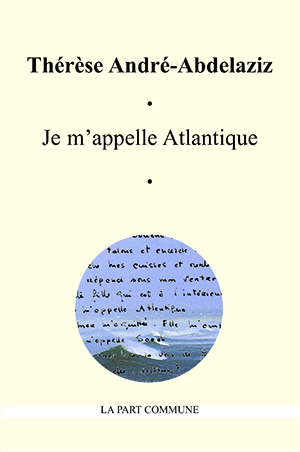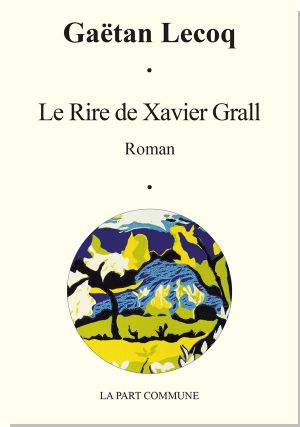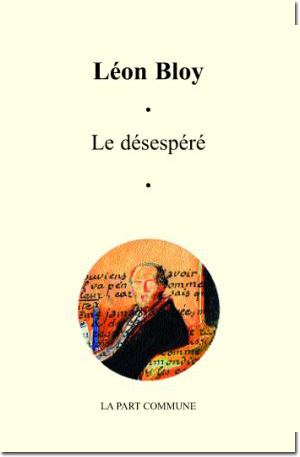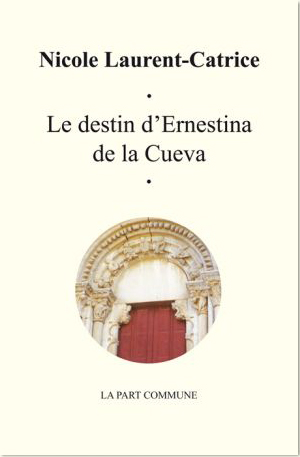Je m’appelle Paul Duprat, je n’ai pas eu d’enfant de la femme qui a partagé ma vie huit années. Avec Yordi, je n’ai pas de lien naturel, il vient d’un autre monde dont il garde au plus profond les voix chères. Pour lui, je suis une sorte de père second… Vous voyez ? C’est à peu près ce que je dirais au juge si je me rendais à l’audience du Tribunal Administratif aujourd’hui.
Mais j’ai prévenu mon avocate, Cécile Danion, que je ne m’y rendrais pas quand elle m’a proposé de la rappeler pour connaître l’heure de l’audience. Yordi n’ira pas non plus, il est en lieu sûr, si je puis dire. Comme vous voulez, m’a répondu la jeune femme, en secouant les boucles serrées de sa chevelure châtain. Elle porte d’immenses lunettes qui lui mangent presque le visage. Elle est grande, élégante, souvent vêtue d’un tailleur pantalon et conduit une Volkswagen couleur jaune safran. La première fois que je l’ai rencontrée, c’était en novembre dernier quand je l’avais contactée pour qu’elle établisse la requête auprès du Tribunal d’Instance. Elle a fort bien mené les choses, avec cette incroyable énergie qui m’a frappé chez elle : le lien qui nous attache, Yordi et moi, a été reconnu par la loi. Il a fallu six mois.
Depuis, je n’avais pas revu la jeune avocate.
Et puis, en mai dernier, Yordi a été convoqué à la Préfecture : le service des étrangers lui a opposé un refus de carte de séjour. C’est tombé sur nous comme un couperet : cette fois, il a suffi d’une demi-journée. Nous étions totalement désemparés, Yordi et moi : Qu’est-ce qui nous arrive ? Qu’est-ce qui nous arrive, répétions-nous, hébétés. Ce doit être une erreur ! Cela ressemble à un mauvais film d’épouvante. Pourquoi la loi qui a reconnu le lien entre nous veut-elle maintenant nous séparer ? J’ai l’impression d’avancer en terre de folie. L’avocate que j’ai rencontrée hier à son cabinet a eu beau éviter le jargon, les formules « procédure simple », « procédure plénière », « requérant », « droit civil », « droit international » ont quelque chose d’étrange et paraissent concerner quelqu’un d’autre…Mon histoire ne peut se confier à ces mots qui ne parlent pas au cœur. Ce 18 septembre 1997, je sens que le temps peut vaciller pour tous les deux. La requête déposée par Yordi est l’ultime recours pour faire annuler cette décision. Qu’est-ce qui peut se passer ensuite ? L’expulsion peut-être ? Ce qui me paraît déjà plus qu’une supposition se tient tapi au fond de moi, prêt à bondir et à m’étouffer. Est-il possible d’acquiescer au pire ?
Tôt ce matin, je suis sorti. J’avais besoin de respirer à l’air libre pour oublier ces semaines de tracasseries paperassières. Respirer à pleins poumons, ne plus m’en tenir à ce souffle au ralenti auquel je m’étais habitué ces derniers mois, comme s’il fallait vivre à petits bruits pour conjurer la peur. Je marche. J’ai traversé le Jardin des Plantes. J’y ai croisé des joggers en tenue et quelques lycéens pressés, en route vers le lycée voisin, visiblement en retard. Je n’ai fait que passer devant l’enclos des daims, contrairement à mon habitude. En marchant, j’ai eu l’impression de me libérer de cette camisole de soucis qui me comprime depuis des jours. Voici le bel immeuble Deurbroucq, siège du Tribunal Administratif de Nantes. Je n’ai pas la moindre envie de m’attarder devant cet hôtel particulier construit par un riche armateur du XVIIIe. « Un dossier complexe et une bonne discussion juridique », a dit l’avocate qui avait l’air enthousiasmée et pleine de combativité. Je suis arrivé dans le petit square au bout de l’île Gloriette, non loin du Tribunal, où je lui ai dit qu’elle pourrait me trouver si elle le voulait, à l’issue de l’audience. Je m’assieds sur un des bancs disposés le long du quai.
Je ne peux m’empêcher de me dire que ma vie est suspendue à l’attente de ce jugement. Je veux préserver ce qui me reste de ténacité et de vaillance pour dire ces jours de colère. J’aimerais trouver des mots pareils aux vagues qui rincent les grèves au loin et reviennent en d’âpres houles. Mais je suis plus à l’aise dans les gestes et les mouvements pour exprimer mes émotions, je suis artiste mime. Si je pouvais, dans les allées de ce square, j’improviserais un numéro en solo. Je m’abandonnerais, pupilles dilatées, regard acéré, je jouerais ce qui n’est pas montrable. Tout mon corps se mettrait en tension, il y aurait le balancement du buste, des bras, les poings serrés pour dire tantôt la rage, tantôt le découragement. Le tremblé des sentiments quand tout se mêle. Les gens alentours n’auraient pas de mal à me prendre pour un pantin ivre, un crétin ou un fou. Peu m’importe, n’avons-nous pas tous un brin de folie qui nous habite par intermittence ?