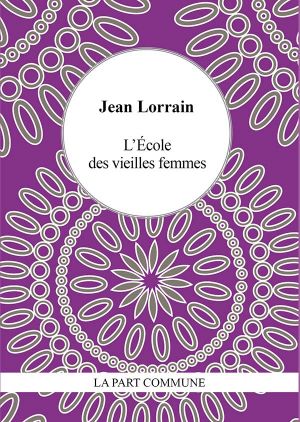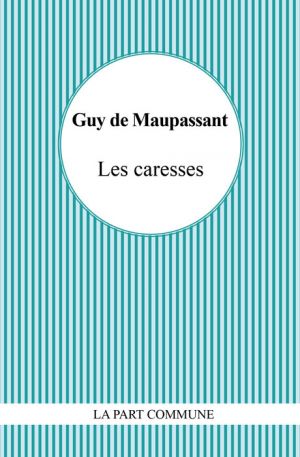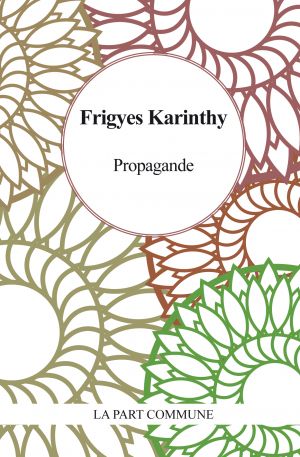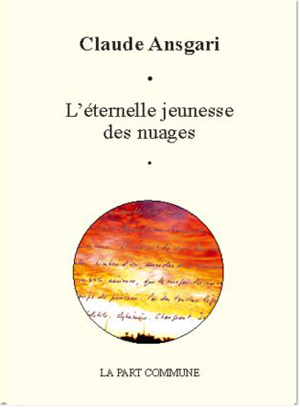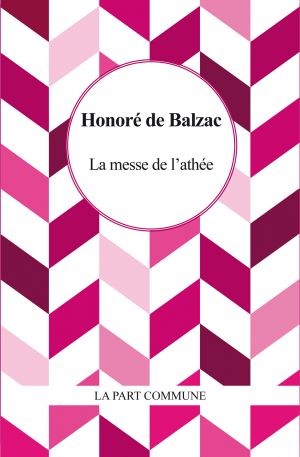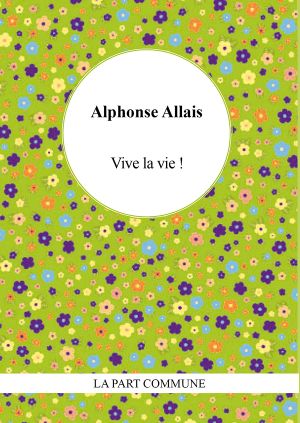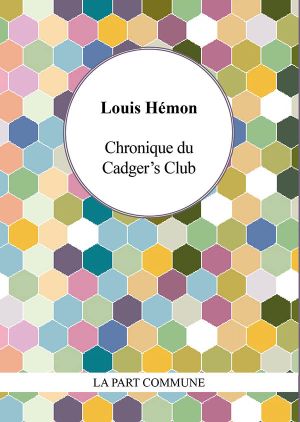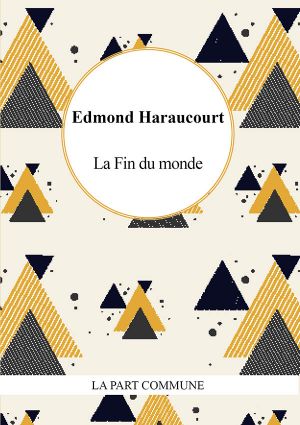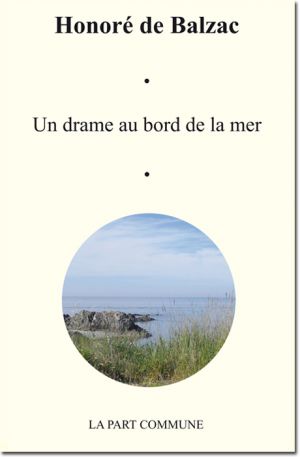LE TESTAMENT
M. Borrusset était mort. L’étiquette d’un deuil de cour emplissait toute la demeure, imposé aux communs comme à l’office par la douleur un peu théâtrale de Madame.
Madame Borrusset avait vingt-neuf ans de plus que son mari : son veuvage était de ceux qui ne se consolent pas (qui ne se consolent plus, pensait in petto M. Ernest, le valet de chambre du défunt) car madame Borrusset était déjà veuve d’un premier mari quand elle avait reçu le coup de foudre d’Hector-Armand-Jean Borrusset, qu’elle pleurait si désespérément aujourd’hui.
C’était un deuil tragique, irréparable, l’agonie et la mise en bière d’une grande passion qui avait bouleversé et animé toute une vie, illuminé et rajeuni les vingt dernières années d’une imprévue vieillesse. Aussi la grande peine de la veuve avait-elle tendu tous les murs du château de noir. Le grand hall d’entrée avait été converti en chapelle ardente ; la châtelaine avait réquisitionné tous les accessoires funéraires de l’église du pays. Un curé de campagne ne résiste pas à l’autorité d’une ouaille aussi millionnaire que l’était madame Borrusset. Autour du catafalque dressé au pied de l’escalier d’honneur, cet escalier qu’avait tant de fois gravi et descendu le pas alerte et sonore de M. Borrusset, la consigne était de renouveler les cierges d’heure en heure et qu’il y eût au moins toujours dix personnes à genoux devant le cercueil. La livrée observait les ordres ; la douleur et la vanité ne mesurent pas les pourboires.
Les paysans eux-mêmes avaient été convoqués à venir honorer et saluer le défunt.
Madame avait su inspirer un tel respect à tous ces pauvres gens ! Madame était née Russe et elle était princesse quand elle avait distingué Hector-Armand-Jean Borrusset. Sa nationalité, son titre et les vingt millions, auxquels on estimait sa fortune, pesaient étrangement sur ces campagnes vassales ; ces pauvres Bretons bretonnant, dans leur imagination balbutiante, la confondaient peu ou prou avec Notre-Dame d’Auray et la grande-duchesse Anne. Une femme, qui, à soixante ans, avait su inspirer une passion à un homme de trente, les stupéfiait ; il y avait pour eux de la sorcellerie là-dedans, et, à leur idée, la châtelaine de Port-Baniou était un personnage de légende. Aussi pour complaire à Madame avaient-ils tous saccagé le jardin, la lande et le verger. La neige rose des pommiers, l’or violent des genêts et la pourpre violacée des violiers processionnaient depuis l’aube à travers la campagne, portés à bout de bras comme des cierges, et tout ce pèlerinage fleuri mettait sous le ciel bas de mai, le ciel gris et bouleversé de nuées de la vieille Armorique, une gaîté lumineuse de Fête-Dieu.
Des fenêtres de sa chambre, madame Borrusset regardait les sentiers du pays s’animer et marcher tout en fleurs vers les grilles de Port-Baniou. Sa vanité de veuve était satisfaite.
…………………………………………………………………
C’est devant un catafalque, dans le clair-obscur illuminé d’une chapelle ardente, que lui était apparu pour la première fois M. Borrusset. Le prince Atthianeff venait de mourir (il y avait de cela vingt ans), et dans l’hôtel de la rue de Varenne, revêtu des tentures à larmes d’argent qui décoraient aujourd’hui Port-Baniou, la princesse Atthianeff veillait, au milieu des serviteurs, le prince qu’elle n’avait jamais aimé. Dans l’ombre, un jeune homme vêtu de noir s’activait, gourmandant les huissiers et réglant le cérémonial des funérailles : M. Hector-Armand-Jean Borrusset, employé des pompes funèbres.
De forte prestance, la peau très blanche, la moustache longue et les yeux câlins, M. Borrusset était alors dans toute la fleur de ses vingt-neuf ans ; la princesse en avait près de soixante. Fragilité d’un cœur qu’on eût pu croire endurci par la vie, et sourde ardeur d’un tempérament qui, chez certaines femmes, ne s’éteint jamais : l’employé aux pompes funèbres déchaînait chez la veuve une folle, une effrénée passion. Ce fut le coup de foudre. Quand, trois semaines après, M. Borrusset se présentait à l’hôtel pour le règlement des funérailles, c’est la princesse qui le recevait et là, dans le petit salon encore rempli de photographies du mort, l’accueil qu’on lui fit, la main qu’on lui tendit, et les yeux, caresse et prière, qu’on ne pouvait plus détacher des siens, apprirent à M. Borrusset l’étendue des ravages opérés par son physique dans le cœur de la veuve. M. Borrusset était Angevin, c’est-à-dire intuitif, madré et patient ; il n’avait aucune fortune, gagnait environ cinq cents francs par mois, avait de grands besoins et envisageait l’avenir avec une certaine terreur. Il jugeait la situation. Il baisait respectueusement la main qu’on lui tendait et veloutait d’une œillade la douceur déjà prenante de son regard.
Un mois après, la princesse Atthianeff attachait M. Borrusset à sa personne comme secrétaire. Un an ne s’était pas écoulé qu’elle l’épousait. Elle reconnaissait à ce jeune mari un apport de cinq millions.
La colonie russe n’acceptait pas ce mariage, la famille encore moins ; de Saint-Pétersbourg, on faisait dire à madame Borrusset qu’elle n’eût plus à revenir en Russie. Alors commença pour le jeune ménage la vie nomade et d’éternelle errance de villes d’eaux en villes d’eaux et de plages en plages, qui est l’existence de tous les déclassés, des courtisanes cosmopolites et des Altesses en déplacement. On les vit successivement à Nice, à Monte-Carlo, à Florence, à Palerme, à Naples. Alger les posséda au printemps ; Venise en automne ; Saint-Moritz les hébergea deux hivers (le mari était un peu fatigué, l’air des montagnes était devenu nécessaire à ses bronches), et puis on les revit à Séville, à Grenade, à Cadix pour les retrouver une autre année à Tunis. Partout ils traînèrent leur bonheur, un bonheur si avide de changements et de départs qu’il ressemblait à de l’ennui. Partout la même stupeur les accueillait dans les gares comme dans les hôtels, et dans toutes les langues du monde les mêmes réflexions effarées de voir cette épouse aux allures de mère escorter, nuit et jour, sans la lâcher d’une minute, la langueur excédée de ce jeune mari.
Madame Borrusset, elle, nageait dans une joie quasi-céleste, presque rajeunie au contact de ce jeune amour, persuadée dans son inconscient égoïsme, que son bonheur était partagé, s’ingéniant à des parures, à des coiffures et à des bijoux dont la légèreté juvénile et la clarté des nuances la vieillissaient encore… Cette servitude avait duré vingt ans.
D’abord très jalouse dans les premières années de son mariage, l’ex-princesse Atthianeff avait dû se rendre compte que M. Borrusset ne la trompait pas. Elle lui en sut gré et par reconnaissance lui assura par testament l’usufruit de toute sa fortune, car elle finirait bien par mourir un jour. Elle avait vingt-neuf ans de plus que lui. Alors elle lui rendrait sa liberté, à ce cher Hector, mais elle comptait bien le faire le plus tard possible…
Or, voilà qu’en dépit de toutes les prévisions, c’est lui qui partait le premier. Qu’allait-elle devenir, seule avec les fantômes du passé, dans cette vaste demeure encore pleine de lui ?
…………………………………………………………………
Les fermiers et les paysans continuaient à s’entasser devant les marches du perron. Un incessant défilé processionnait par les allées du parc. Madame Borrusset quittait machinalement la fenêtre, où elle se tenait, le front appuyé à la vitre ; et de sa chambre passait dans celle de son mari. Une odeur de cire et de roses fanées persistait dans la pièce, aggravée d’un relent de phénol et d’une autre odeur encore ; les trois fenêtres étaient pourtant grandes ouvertes derrière les persiennes closes. Cette atmosphère âcre et fade prenait la princesse à la gorge ; elle allait à une des persiennes et la poussait. Un flot de jour pénétrait dans la chambre, un secrétaire Empire en acajou ronceux s’en éclairait dans l’ombre. C’était là qu’Hector-Armand-Jean rangeait tous ses papiers… Les papiers d’un mort, c’est encore un peu de sa vie : inconsciemment, pour le plaisir de retrouver des contacts et de respirer des pensées et sans curiosité aucune, la princesse prenait sur le marbre du secrétaire un trousseau de clefs et, ouvrant la tablette, elle fouillait maintenant les tiroirs.
« Ceci est mon testament… » Madame Borrusset retournait curieusement entre ses mains une grande enveloppe de parchemin, alourdie de quatre sceaux de cire rouge.
« Ceci est mon testament… » Le défunt avait donc songé qu’il pouvait mourir avant elle. Il avait eu cette pensée, ce cher Hector, et il avait songé à sa veuve !
L’humidité d’une larme rafraîchissait ses paupières.
D’un coup d’ongle elle déchirait l’enveloppe : « Je, soussigné, lègue toute ma fortune à… ». Et la pâleur de la vieille femme devenait verte, le parchemin tremblait violemment entre ses doigts, des injures et des blasphèmes montaient confusément à ses lèvres. Elle les mâchait plus qu’elle ne les balbutiait entre ses gencives molles. La princesse Atthianeff n’en croyait pas ses pauvres yeux. Le défunt la déshéritait. Cette fortune qui était la sienne, ces cinq millions qu’elle lui avait reconnus en apport et qui étaient devenus sept par d’habiles placements et à force d’économies, son cher Hector les laissait à une demoiselle Cécile Hérard, rentière à Vannes, et madame Borrusset cherchait vainement à placer un visage sur ce nom. Il ne lui était pas inconnu pourtant. Qu’était cette demoiselle Hérard au défunt ? Sa maîtresse sans doute ? Tout à coup, la princesse Atthianeff avait un sourd rugissement : elle se souvenait. Cette demoiselle Cécile Hérard était une demoiselle de compagnie, assez habile musicienne, qu’elle avait prise à son service, cinq ans après son mariage, et qui avait fait avec eux le voyage de Jérusalem, du Caire et de la Grande-Grèce. Elle l’avait attachée à sa personne à cause de ses talents de cithariste : Mademoiselle Cécile Hérard animait un peu la solitude des soirées d’hôtel à l’étranger. Elle n’était demeurée que six mois auprès d’eux. C’est M. Borrusset lui-même qui avait exigé son renvoi. Cette musique acidulée l’énervait, le profil moutonnier de la donzelle et la résignation de ses yeux de victime avaient aussi le don de l’excéder : il le disait du moins. Madame Borrusset avait dû souvent défendre la demoiselle de compagnie et c’est à elle qu’il laissait sa fortune !
Traversée d’une affreuse lueur, la princesse bouleversait le secrétaire, violentait les tiroirs, forçait les serrures et, saccageant et dévastant le pauvre vieux meuble avec une brutalité policière, y découvrait enfin les paquets de lettres qu’elle soupçonnait.
Elles étaient là précieusement classées, date par date, année par année. Il y en avait quinze paquets : il y avait quinze ans que cela durait ! Pendant quinze ans M. Borrusset l’avait trompée : les lettres étaient explicites. La princesse les lisait au hasard, d’un œil égaré et avide. Toutes, depuis les premières, émues et reconnaissantes, vibrantes de la passion partagée et pleines de remerciements pour la rente servie, criaient et proclamaient la faute ; puis c’était la naissance du premier enfant, les détails de l’accouchement clandestin, puis la naissance du second (car il avait deux enfants, le misérable, deux enfants de cette gourgandine !). Et ces enfants vivaient, un fils et une fille, Hector et Jeanne. Alors la correspondance devenait celle d’une femme mariée, d’une bonne bourgeoise informant des progrès et de la santé des enfants la sollicitude d’un père et d’un mari. Dans toutes ses lettres l’amante plaignait son complice de l’horrible servage qu’il subissait auprès de sa vieille. Dans toutes ses lettres, mademoiselle Cécile Hérard accusait la mort de lenteur et souhaitait ardemment le trépas de madame Borrusset. Avait-elle assez encombré leur existence ? Et avec quelle sauvage ardeur on avait souhaité la voir mourir ? L’avaient-ils assez poussée de leurs vœux dans la tombe, depuis quinze ans qu’elle gênait de sa présence leurs salauderies de mari adultère et de fille entretenue… « Quand la vieille sera morte, quand ton crampon ne sera plus là », telles étaient les phrases qui revenaient toujours comme un leitmotiv dans ces lettres.
Il y avait donc un Dieu pour que leur ignominie et leur duplicité eussent été ainsi punies. C’était elle qui survivait ! Avec un ricanement féroce, l’épouse outragée s’emparait du testament et faisait le geste de le déchirer. Une note écrite en bas, au-dessous de la signature, arrêtait son geste : « le double de ce testament a été déposé chez maître Auburtin, notaire, rue de l’Homme-à-la-Tête-Coupée, à Vannes. » M. Borrusset avait prévu les fureurs de sa veuve.
Déjouée, la princesse Atthianeff poussait un cri de rage, puis, ouvrant la porte de la chambre, elle se précipitait dans le vestibule et descendait comme ivre, la taille raidie et les yeux fixes, les vingt degrés de l’escalier.
Le catafalque se dressait au pied, dans une splendeur de draperies larmées d’argent, parmi une illumination de cierges ; des amoncellements de fleurs, des effeuillements de pétales et tout un échafaudage de couronnes allumaient dans le clair-obscur des clartés neigeuses, et c’étaient tout autour des répons d’enfants de chœur, des cliquetis d’encensoirs, un égouttement de goupillons, et des marmottements de valets en prières.
La veuve se ruait au milieu de tout ce deuil. Elle renversait les flambeaux, éteignait les lumières, bousculait les couronnes, piétinait les fleurs et, dispersant d’un geste les assistants mis soudain debout :
– Hors d’ici, allez-vous-en ! Qu’on le laisse seul, seul avec moi, seule avec lui ! Partez, éteignez tout, emportez le crucifix, emportez l’eau bénite et au fumier les fleurs ! Allez-vous-en, vous dis-je ! Qu’il reste seul comme un lépreux et qu’on l’enterre comme un chien !