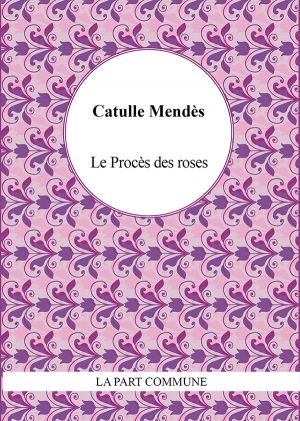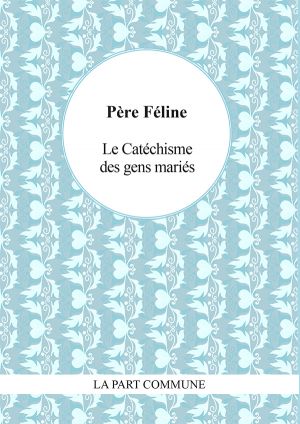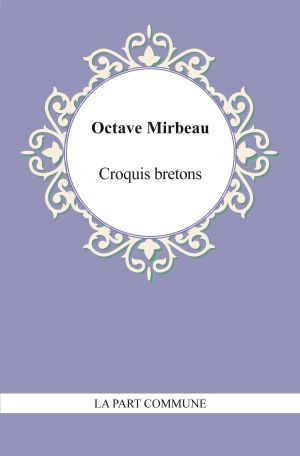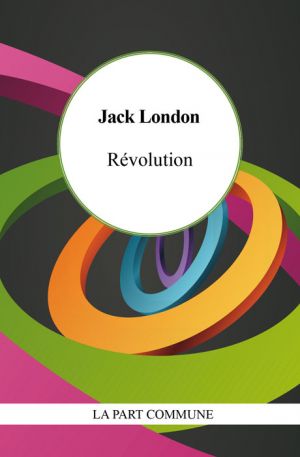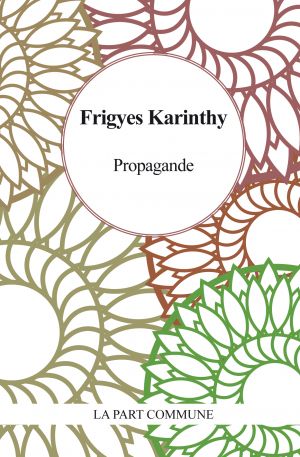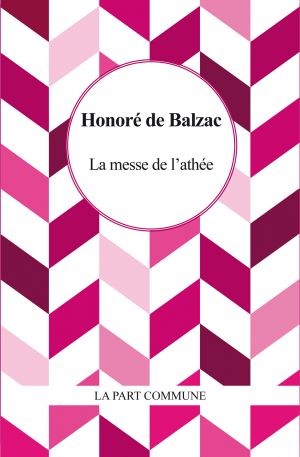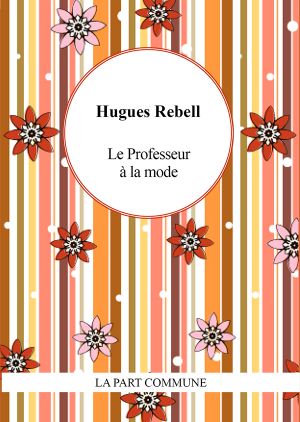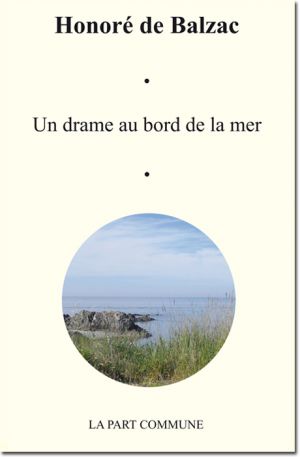Dans le jardin des aliénés, où vole parmi le soleil la neige ailée des papillons, le jeune fou se promène. Il est pâle, avec l’air doux. Et tant de tristesse dans ses yeux vagues ! Il s’arrête devant un églantier, cueille une églantine ; il s’arrête entre deux rosiers, cueille, à l’un, une rose-thé, cueille, à l’autre, une rose moussue.
Sur un banc de bois, au détour de l’allée, il place les trois fleurs cueillies.
Il dit à l’églantine :
– Églantine, répondez ! Vous êtes accusée d’avoir, au temps où vous étiez jeune fille, abandonné sans miséricorde, pour épouser un vieillard, qui était riche, un pauvre et triste enfant, qui vous adorait. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
Il attend la réponse. Il reprend :
– La cause est entendue. Je vous condamne.
Il dit à la rose-thé :
– Rose-thé, répondez ! Vous êtes accusée d’avoir, au temps où vous étiez jeune femme et mondaine, désespéré, torturé par le manège infâme des sourires menteurs et des consentements rétractés, un misérable jeune homme dont le cœur, hélas ! battait pour vous seule, ardemment. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
Il attend la réponse. Il reprend :
– La cause est entendue. Je vous condamne.
Il dit à la rose moussue :
– Rose moussue, réponds ! Tu es accusée d’avoir, au temps où tu étais une belle fille vendeuse de baisers et de rires, affolé par tes caresses perverses, et ruiné et avili un malheureux homme qui demandait à ton sein où l’on s’endort, à ta bouche où l’on se grise, l’oubli des désespoirs anciens. Qu’as-tu à dire pour ta défense ?
Il attend la réponse. Il reprend :
– La cause est entendue. Je te condamne.
Ces jugements rendus, il tire de sa poche un joli instrument, compliqué, fait de bois des îles et d’acier qui luit, c’est une très petite guillotine qu’il a fabriquée, en rêvant, dans ses loisirs.
Tour à tour, sur la mignonne bascule, il met l’églantine, la rose-thé, la rose moussue ; l’une après l’autre, sous le couteau qui glisse et qui tranche, les fleurs, séparées de leurs tiges, tombent dans le sable de l’allée.
Il les ramasse et les regarde longtemps.
Il va vers le fond ombreux du jardin, là où ne passe personne, creuse du doigt dans la terre une petite fosse, y met toutes ensemble les trois suppliciées, les recouvre de sable et de feuilles d’acacia.
Puis, il s’agenouille et pleure jusqu’au soir sur la tombe des roses coupables.
LE NARCISSE
I
Il y avait une grande désolation dans tout le royaume parce que la fille du roi allait mourir de faim ? Quoi ! de faim ? Une princesse ? N’y avait-il donc plus de bétail dans les prairies, de gibier dans les forêts, de légumes dans les champs, ni dans les vergers, de fruits ? ou n’y avait-il plus de cuisiniers dans les cuisines ? Quelle catastrophe était survenue ? Comment se pouvait-il faire qu’une si noble personne n’eût pas même ce qui manque rarement au paysan dans sa chaumine, au mendiant dans sa hutte, – un morceau de pain ? Eh ! si, elle avait autant de pain que l’on en peut souhaiter, des gâteaux aussi, les plus sucrés du monde ; il lui aurait suffi de faire un signe pour qu’on mît sur la table, devant elle, les viandes les plus savoureuses, les plus délicates venaisons, et des petits pois frais comme des gouttes de rosées, et des pêches de velours violet et des oranges d’or. Mais elle ne pouvait pas manger, cette princesse, les vivres dont se sustentent les hommes et les femmes ; les fées, penchées autrefois vers son berceau, avaient décidé qu’elle se nourrirait uniquement des fleurs nouvellement écloses ou des papillons qui se posent dessus. Or, depuis deux semaines, une telle bourrasque, dans ce royaume, ravageait les jardins, rompait et renversait les serres, qu’il était absolument impossible de trouver un pétale d’églantine ou un calice de cactus. Non, dans les parterres, pas une jacinthe, pas un jasmin, pas une marguerite, pas une gueule-de-loup, pas une tulipe en apparat d’infante, ni, dans les haies, une branche d’épinier fleuri. Pour ce qui était des papillons, il y avait beau temps que les rafales les avaient tous emportés, là-bas, on ne savait où, vers des pays inconnus où ils tombaient maintenant, peut-être, tristes et morts, comme des débris de flocons. De sorte que la princesse était dans le plus pitoyable état que l’on puisse imaginer ; elle était plus pâle que les plus pâles fleurs dont une seule aurait suffi à la sauver ; elle mourrait, certainement, si son jeûne se prolongeait pendant quelques heures encore ; et, comme elle avait un assez mauvais caractère même quand elle mangeait à sa faim, vous pensez les querelles qu’elle faisait à ses demoiselles d’honneur lorsque celles-ci entraient dans la chambre princière, sans lui apporter la plus petite fleurette des champs ou des bois.
II
J’ai dit, – et j’ai eu raison de le dire, – que tout le royaume était dans la désolation à cause de la mort prochaine de la princesse. Vous n’auriez pas reconnu le roi tant il avait grisonné en quelques jours ; et les ministres, les chambellans, les majordomes faisaient pitié à voir, parce qu’il serait vraiment malséant à des majordomes, à des chambellans, à des ministres, de montrer de la belle humeur quand le chef de l’État a lieu d’être chagrin.
Mais le plus sincère, le plus violent désespoir était dans le cœur d’un petit page ! car, depuis longtemps il adorait, sans espérance, la princesse ; la pensée qu’elle serait une personne morte le plongeait dans de telles détresses qu’il aurait fait connaître la miséricorde aux tigres des bois et aux roches des monts s’il y avait eu là, pour le voir, des roches et des tigres. Ce n’était pas qu’il eût à se louer de la clémence de la princesse ! Bien au contraire. Aucune parole ne saurait donner l’idée des cruautés dont elle avait usé à l’égard de ce petit page, qui était à son service. Dès qu’il soupirait, elle riait. Dès qu’il s’approchait d’elle, le soir, pour lui rendre quelque office, elle ne se détournait pas, ce qui eût été charitable, mais elle le regardait dans les yeux, s’asseyait, lui disait : « Bien, bien, venez, c’est l’heure de dormir, retirez-moi donc mes bas, je vous prie », puis elle s’éloignait en se moquant, avec ses demoiselles, qui ne manquaient pas de rire, cruelles aussi. Mais elles étaient excusables, n’étant pas aimées de ce pauvre garçon ! Tant de barbarie ne l’empêchait pas d’être le plus tendre des amoureux ; si vous étiez venu lui dire que la princesse n’était pas aussi douce que les agnelles des prés, il se serait fâché tout rouge ; et vous auriez eu affaire à lui.
Dès qu’il apprit que la fille du roi dépérissait à cause de la bourrasque qui avait enlevé toutes les fleurs avec leurs papillons, il n’hésita pas un instant. Il se mit à courir à travers le royaume, cherchant des roses, des lys, des marguerites, n’importe, pour le repas de celle qu’il aimait. Mais il n’en trouvait pas ! Il continua d’en chercher. Quelqu’un dit à la princesse : « Votre Altesse sait-elle que le petit page est parti dans l’espérance de vous cueillir un déjeuner. » Elle sourit, avec dédain. Il semblait qu’elle déjeunerait avec regret des fleurs que lui apporterait le pauvre garçon, et elle dit : « Ah ! que j’ai faim ! » Lui, cependant, il parcourait tout le pays, en quête de floraisons ! et il descendit dans les ravines, et il monta les plus âpres côtes, et il espérait que peut-être il trouverait, entre deux roches, près des glaciers, la fleur mystérieuse des Alpes, toute petite et toute bleue, qui eût empêché de mourir celle dont il était épris ! Mais non, même sur les plus hautes cimes, même dans les creux les plus profonds, pas une fleur ! tant la tempête avait été formidable et acharnée ; il revint de tous ses efforts avec l’angoisse de l’insuccès. « Je l’avais bien prévu, dit la princesse ; il est vraiment ridicule que l’on confie à de tels enfants le soin des personnes royales. »