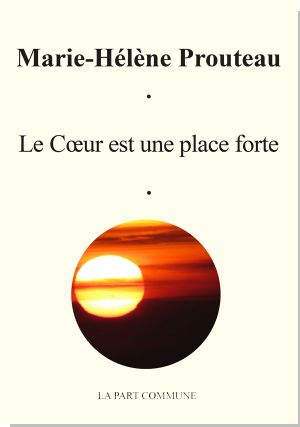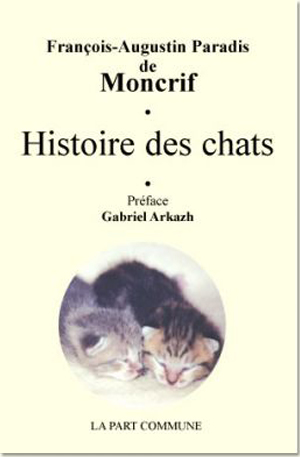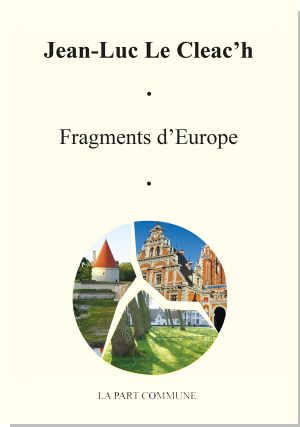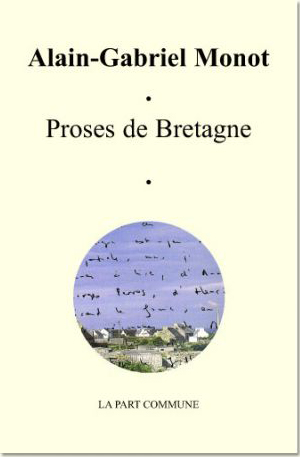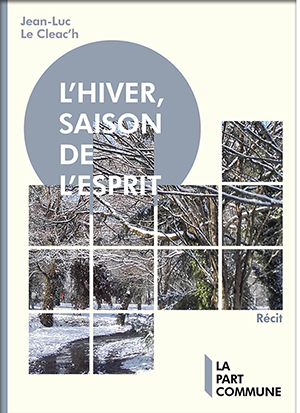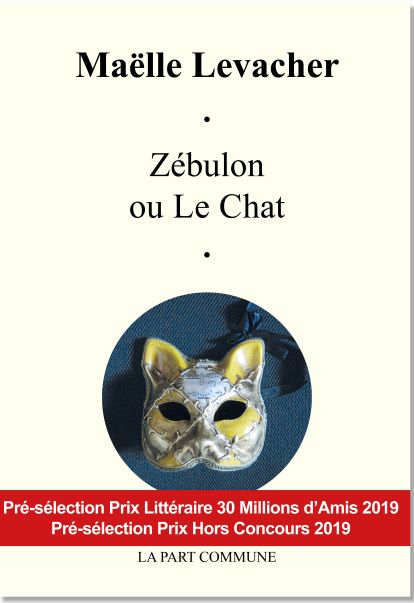Le vieux livret
Ce qui reste de lui. Ce livret revenu de la guerre, posé là sur la table d’écriture. Ses feuillets fatigués ont la douceur du chiffon. Sa couleur beige ocre aimante le regard. Papier jauni par les années. Marbré de taches brunes comme du sang séché. Ça fait penser au rouge argile d’une antique tablette. Ces pages vacantes, aphones, une impossible énigme. Il n’y a pas d’affectations, il n’y a pas d’états de service. Curieusement, tout y manque. La mention de la blessure que Guillaume a reçue en 1916. Celle des batailles, la Bataille des Frontières. Les terribles combats de Maissin, Ardennes belges. 4782 combattants tués Français et Allemands. L’Artois. L’Argonne. La Somme, Verdun. La Marne. Le vieux livret est résolument vide.
Objet-souvenir d’un grand-père, mort à ma naissance. Un rien de regret qui insiste, inconsolé, de n’avoir pas connu enfant, un geste, rien que pour moi, sa main aimante posée sur l’épaule. Reste le livret conservé par grand-mère. Comme une relique. À côté des lettres échangées avec son fils mort à la guerre.
C’est pareil à une photo de Robert Doisneau. Une scène en noir et blanc au cœur de sa petite maison, comme un cercle de tendresse. Toutes les deux devant la vitrine en bois blanc. Fouillis de napperons de dentelle et belle carafe. Cette vitrine ! Pas de médaillons ni de mèches de cheveux, les souvenirs, ici, sont d’une autre nature. Elle y a rangé délicatement le livret. Comme on manipule un corps blessé. Ce qui est gardé derrière la vitrine, on n’y doit pas toucher. Jamais. Injonction sévère dans le regard, sous les sourcils froncés. On se souvient longtemps. De ses mains refermant lentement la porte de la vitrine. On devine une émotion profonde. Le front contre la vitre, on est plein de songe. Une part de mystère est là qui demeure en suspens. De ces mondes qu’on voudrait connaître.
Jamais l’enfant n’oubliera le livret militaire. Elle y a logé son rêve.
Le silence est là. Juste ces mots entendus : Le mal que c’est, la guerre. Du coin de l’œil, elle la voit lisser la couverture du livret. Délicatement. Une onde de surprise la traverse. Quelle guerre ? Étrange comme ça chevauche le temps, la guerre. Comment y échapper ? De quoi s’y perdre. Oncle Paul, engagé à dix-neuf ans, mort pour la France, à la Libération de Mulhouse, 1944. La guerre, jamais on ne serait quitte avec elle ? À tout moment, elle reprend son travail de sape.
L’enfant sait l’histoire de ce jeune oncle qui n’eut pas la chance de vieillir. De Guillaume, elle connaît peu de choses. Sa photo de soldat du régiment de Brest. Et ce livret retrouvé en Belgique qui vient de débouler, ce jour de 1961, sans crier gare. Alors que grand-père est mort depuis des années. Ça tombe sur la famille avec la fulgurance d’une météorite. Drôle de vertige. Il y a quelque chose d’insaisissable dans ce morceau de vie arraché à la guerre. Tout flétri encore de poussière. On pose des questions. Peut-être existe-t-il des miettes de guerre ?
La voix grand-maternelle arrive au travers d’une ouate épaisse. Ses mots disent l’incroyable découverte d’un ouvrier quarante-sept ans après. En train de restaurer le presbytère de Maissin. 430 livrets perdus dans la bataille puis cachés au grenier du curé. Faire le mort tout ce temps ? Tenir deux guerres, ce n’est pas rien, se dit l’enfant. Tout ce temps dans le secret, c’est ça ? L’autre vie, là-bas aux provinces lointaines.
À se demander comment c’est possible qu’il n’y ait aucune lettre de Guillaume, aucun journal de guerre quand on la voit, elle, grand-mère qui aime tant écrire.
Ce bloc de silence, ça a toujours intrigué. Si empli de voix qu’il semble fait de plein de présences. Ce silence au carré, celui du livret et celui de Guillaume. C’est ça peut-être, le plus étonnant qui enclenchera le rêve.
Sur un vieil atlas elle a montré les cartes, les noms des villes traversées par les soldats. Longues cargaisons de la guerre vers Sedan. On repère la frontière. La Wallonie. Quel est donc ce pays ?
La litanie des villes inconnues, chasses et abbayes, enchante. Fays-Les-Veneurs, Villance, Anvoy, Rossignol, Paliseul. Paliseul, à ce nom, le cœur s’émerveille. Un poème appris à l’école, du poète des Ardennes, Au pays de mon père on voit des bois sans nombre.
Elle l’a récité dans sa tête. Si sombres, ces bois où luisent parfois des yeux de loups. Une image s’est fixée dans sa sensibilité d’enfant. Mêlée à ces autres vers de lui, les sanglots longs des violons de l’automne. Guillaume, avant la bataille, barda au dos, abordant les profondeurs inconnues des sapinières wallonnes. Le cœur resté accroché aux forêts océanes, à leurs chaos de rochers, entre terre et mer.
C’est le temps de la curiosité à lire les livres de classe. Récits de « tocsin », de « mobilisation générale », de « tranchées ». L’entaille de ces mots, matière noire qu’on épèle, le cœur se décroche.
L’espoir fou de saisir sa silhouette fantôme cent fois recomposée. Juste un instant, l’image à Brest. Guillaume, place de la gare haut perchée au-dessus de la rade. En capote bleue. C’est le départ. Elle imagine. Il regarde une dernière fois la mer. Dans sa tête adolescente, il se métamorphose parfois en un poilu étrange. Celui reproduit dans le Lagarde et Michard. Le tableau de Gromaire longuement regardé. Il n’a plus rien alors de la photo sépia de la vitrine, cheveux bruns et moustache d’homme jeune. Métamorphosé en bloc bleuâtre, pétrifié dans sa capote de soldat, il est absolument terrifiant.
Dans ces pays elle va songeuse. Désormais, elle arpente un autre paysage, entre l’histoire et la rêverie. De ces signes imprimés en elle, quelque chose s’est tramé : l’invention d’un grand-père.
En compagnie de ses images qui, parfois le soir, surgissent dans la gravité secrète des traces.
Reste, parmi celles-ci, la silhouette de Guillaume qui se retourne. Dans son regard, la lumière qui monte en mille éclats de l’immense rade. Le cœur serré de quitter les siens, elle, le gamin et celui qui va naître. Il garde en lui l’odeur des chevaux du côté des granges. Le vent qui, par l’ouest au verger, vient affoler les rangs de pommiers en fleurs. Le frisson des avoines qui annonce l’été. Dans quelques minutes le train va démarrer. C’est comme ça pour tant d’hommes mobilisés dans les casernes froides. Partis de leur hameau, ignorant la danse avec la mort qui les attend. Une vision minuscule se glisse, Guillaume tendant l’oreille aux cris des mouettes qu’il voit piquer dans les flots. Là où il va, c’est bien connu, les oiseaux ne sont plus de la partie.
Reste l’image de Guillaume, lèvres serrées sur ses quatre années de guerre. Il laisse derrière lui sa vie de paysan sans blason. De plain-pied avec la terre. Pour d’étranges territoires. Quel est donc ce pays si près de l’enfer ? La vie y a déserté le ciel. Il n’y a plus de rires aux fontaines. Plus de chuchotis d’ailes. Plus de nuits inquiètes pour la jument malade. Plus de pensée heureuse dans le calme de la grande cuisine paysanne. Lui, carré, costaud, habitué à la mort des bêtes, giclées de sang et râles d’agonie, qui est resté sans les mots pour dire les corps mutilés, les poumons brûlés des copains de tranchée. Ni pour dire la force de ce bras lancé contre son semblable allemand. Insoupçonnée. Tous deux dans le trou d’obus, c’est lui ou moi qui l’égorge de la lame de la baïonnette. Les yeux, le visage, la terreur de l’un et de l’autre.
Pauvre pion devenu démon. Sait-on comment on revient des plus profonds abîmes ? Et de l’ordre implacable de la tuerie ?
Je caresse la matière de ces pages. Les feuilleter avec précaution, ne pas les tourner trop vite. Elles risqueraient de tomber en poussière. Les années ont passé. On n’a plus beaucoup de temps tous les deux. Maintenant que les circonstances familiales m’amènent à me séparer du vieux livret, vient l’idée de retrouver ce qui a été perdu. Le chemin qui fut le sien, qui sait, les présences qui l’habitent. Avancer pour cela dans la fréquentation des livres et des archives.
Août 1914. Le départ du 19è, le régiment d’infanterie de Brest. Au bout c’est la gare, par la rue du Château, la voie connue des soldats du 19è, rebaptisée Avenue Roosevelt. Et la vaste place qui porte alors un autre nom. Son nom aujourd’hui place du 19e R.I. Dans ce changement, s’entend l’immensité des sacrifices.
Combien de soldats tués ? On ne sait pas.
Plus on avance dans la lecture des documents, plus le nombre submerge. Inconcevable. Le désir d’une pause parfois. Ce doit être ça, ce rêve, le même qui revient souvent ces temps-ci. Celui d’un pigeon-voyageur dans l’armée de Prévert. Il porte toujours le même message : paix. Mais n’arrive jamais à le remettre à temps au destinataire. Comme si l’inconscient faisait la nique à l’Histoire.
Étrange objet, le vieux livret. Simple accessoire, fait pour la guerre il est resté « à l’arrière », aux côtés des civils belges. De quoi a-t-il été le témoin dans son grenier ?
N’est-il pas de ces choses singulières qui portent plusieurs mondes ? La guerre. La paix. L’Ouest aux stèles bleues. Les collines de Wallonie. La mort. La vie et son bruit qui repart. Petites chroniques de la paix captées du fond du presbytère. Les choses domestiques, les rires d’enfants dans les maisons voisines. Le cri du rémouleur. L’aboiement des chiens. Les saisons de neige, d’airelles et de myrtilles dont il n’était pas familier. Toujours les chrysanthèmes, aux jours de novembre gris de givre, près des stèles de haute mémoire. Les ombres des veuves vêtues de sombre, refaisant les mêmes chemins que leurs hommes.
La guerre, l’Occupation, vingt ans après, qui font retour. Doublon et interférence des infamies, des douleurs. On rajoute des noms sur la pierre du monument. Les heures oisives à la maison du curé, rumeurs de fête à la maison d’à côté, longues tables dressées en plein air. Le jardin bourdonnant de guêpes. Le tressaillement de la vie. Celle d’avant. Mais plus rien désormais n’est comme avant. Un brin de nostalgie, le cœur accordé aux lointains de sel et de vent. Là-bas entre presqu’îles et abers. Et, des années plus tard, le retour en ses terres Atlantique. Gardant souvenance du silence de la terre wallonne. Du malheur de la terre wallonne. Au bord des vastes nécropoles.
Au cœur de ces pages du livret, le silence.
Des couches de silence. Celui du jardin de Maissin où il fut perdu au milieu des combats. Celui des civils belges, si éprouvés par ces années d’occupation, qui ont gardé enfouies leurs larmes. Comme si le livret était devenu le veilleur par-dessus le mur, qui entend tout, qui note tout de ces grandes douleurs. N’a-t-il pas recueilli les récits chuchotés de bouche à oreille ? Des voix au village d’humbles gens et de jeunes filles. Des voix oubliées de l’Histoire. Il y a celle, poignante, de Sara qui m’habite :
Tu ne peux pas imaginer ce que c’était. Rouges les uniformes français, rouge le sang des blessures sur les vêtements, rouge le sang qui coulait depuis ce cimetière où un mètre d’embaïonnettés des deux camps gisaient les uns sur les autres. Rouge le ruisseau qui en dégoulinait jusqu’au village.
C’est une histoire de livret perdu. Une histoire de revenance. À vrai dire, cette perte-là, cela ne semble pas grand-chose, comparée aux pertes du grand massacre. Incommensurables, celles-là.
Que me dit le silence du vieux livret resté cloîtré dans le fatras des balles Lebel, des bandes molletières, des shakos de Ulhans, des plaques, des gamelles rouillées, des cartouchières et des clairons ? Lui qu’une main a sorti de son coin de jardin ensemencé de sang noir, comment saisir ses non-dits ?
Cette planque dans le secret du presbytère, est-ce un caprice du hasard ? Ou une ruse de l’Histoire qui ferait son pied de nez ? Comment savoir ? C’est le message laissé par Guillaume sur son champ de guerre. Revenu de la pire adversité, le vieux livret dessine une sorte de pacte entre lui et moi. On dirait qu’il en a conscience lui aussi. Il y a comme des chuchotements qui s’échappent de ses feuillets.
Le temps est venu de sortir de sa poussière ce revenant à l’étrange vitalité. D’écouter ses mur-mures. Souffles, voix d’ombres, mots criés dans le vide.
Sa langue est difficile et se parle à voix si basse. Il faut tendre l’oreille.