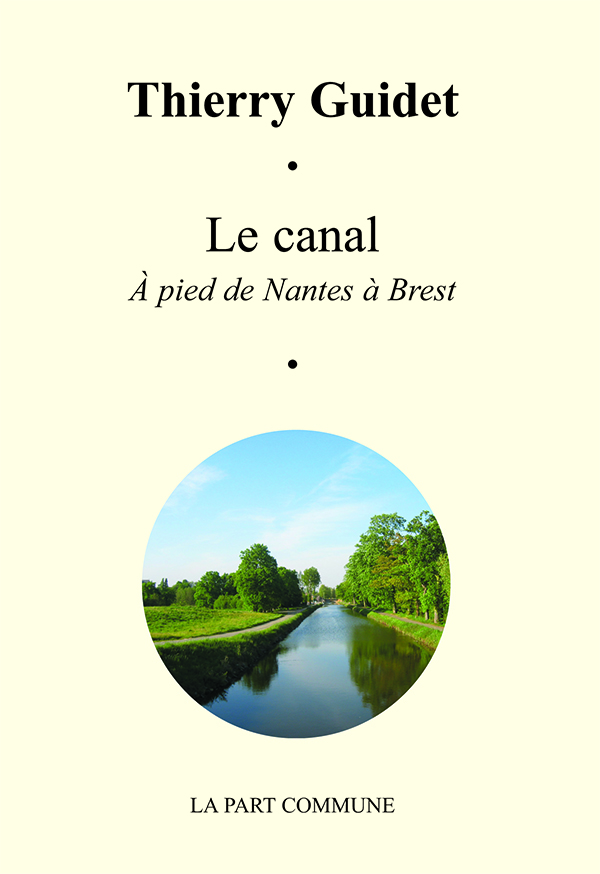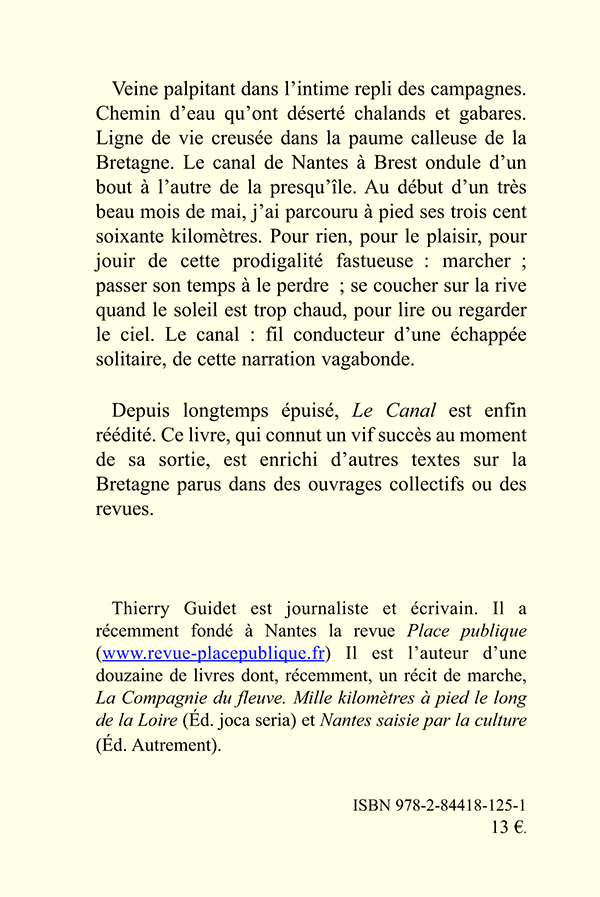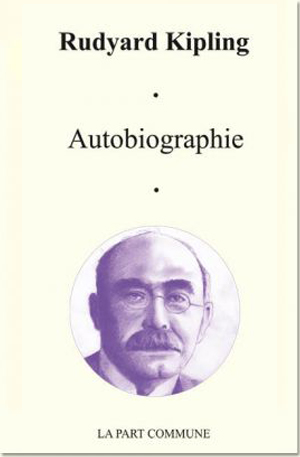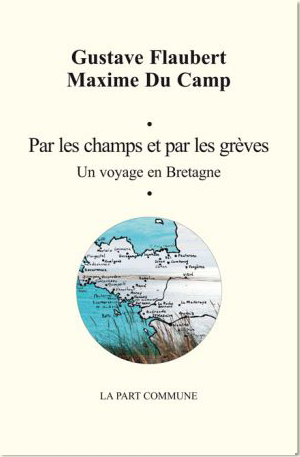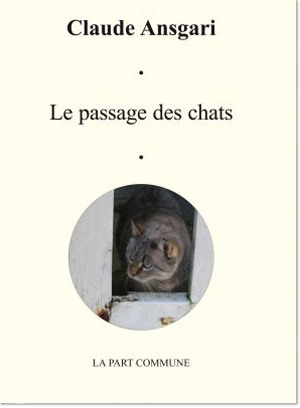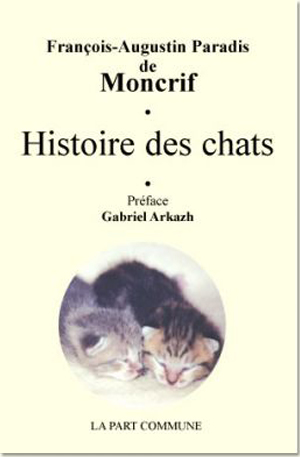Jeunes feuillages, promesses des fruits, aubes encore fraîches. Printemps, joli mois de mai, printemps de la vie qui vous jette hors d’haleine sur les chemins. On pourrait en jouir comme un animal de sa course puis de son repos dans l’ombre, au pied d’un arbre. On pourrait marcher sans arrière-pensées, sans autre projet que de mettre un pied devant l’autre, sans souci du lendemain, sans attaches.
Pourtant, on a pris un carnet qui sera bientôt gondolé, taché de sueur, et un crayon. Le soir, au gîte, chaussures ôtées, pied posés sur le froid du carrelage où ils dessinent une marque humide, on écrira, on tentera de fixer quelques infimes événements du jour, on figera une pensée, un état d’âme. Parfois même, sur le motif, on cessera de marcher pour griffonner, debout, quelques lignes, capter, manquer quelque chose du tremblement de l’instant.
Et ces pages donneront parfois un livre, écrit comme on noue un mouchoir pour se rappeler quelque chose d’important, mais qui ne devait pas l’être tant que cela, sinon, bien sûr, on ne risquerait pas d’oublier. Écrit comme on prend une photo qu’on laissera dans une boîte ou bien dans un album et qu’on retrouvera des années plus tard, un dimanche après-midi d’hiver. Il arrivera qu’on ne sache plus qui figure sur la photo, quand on l’a faite et où. Il arrive aussi qu’on se perde soi-même et que les clichés, les mouchoirs, les récits de voyage vous soient petits cailloux blancs dans la forêt où les chemins se nouent. Donc, on écrit pour se retrouver.
Commenter les gestes de l’amour redouble le plaisir. Parler du goût du vin, de sa couleur, de ses arômes et même, presque indicible, de la sensation qu’il a laissée sur la surface de la langue et dans toute l’intimité de la bouche, attise la jouissance. Se remémorer le chemin suffit à vous mettre des fourmis dans les jambes. On écrit donc pour revivre la sensation enfuie. On écrit par regret du plaisir éteint, pas tant dans l’espoir de le ranimer que pour réveiller la douce douleur du jamais plus.
On écrit par nostalgie, ce sentiment moqué par les contemporains, mais qui, pourtant, est bien le rapport au temps le plus humain qui soit. Ce qui a été n’est plus, mais rien ni personne ne peut faire que cela n’ait pas été et ne subsiste, sur le mode d’un écho assourdi, audible pour soi seul. Pourquoi ne serait-il pas permis de trouver à hier un goût plus suave qu’à ce soir ?
Aussi hésite-t-on quand un éditeur vous demande de republier un livre écrit depuis bientôt vingt ans. On tarde à répondre. Faut-il encadrer une photo jaunie, gratter une cicatrice bien refermée ? Faut-il le crier sur les toits que le chemin ressemblait au bonheur, que vos enfants étaient encore des enfants, que le monde était jeune ? Et claironner que vous étiez immortel en ce temps-là, et vos parents, et vos amis aussi ? Il vous suffit de l’avoir écrit une fois, même si c’était entre les lignes, et que vous ne saviez pas ce que vous viviez ni ce que vous écriviez. Et puis on relit, on s’impatiente de quelques maladresses, mais revoici les aubes encore fraîches, les jeunes feuillages, les promesses de mai, la poussière du chemin, l’immobilité de l’eau. On dit oui à l’éditeur qui vous a offert ce voyage dans le temps. Et l’on rassemble quelques textes, rédigés depuis, en résonance, croit-on, avec ce récit d’une marche de douze jours dans le secret d’un vieux pays. Où il est question d’eaux dormantes, de jardins clos, de vies interrompues, de profils perdus et de vins à venir.
Si l’on ne s’était promis de ne (presque) rien changer au livre, on le reprendrait bien au début. Sur la page blanche, on écrirait : « Il était une fois ». Il était une fois un homme plus jeune qu’à présent, qui descend du train en gare de Nantes. Il était une fois un chien blond, bouclé, aujourd’hui enterré au jardin, entre le tas de bois et le tilleul. Il était une fois une pluie tiède tombant sur les magnolias dans une ville encore à inventer. Il était une fois des fermes et des hameaux qui portaient des noms de femmes aux flancs fertiles. Il était une fois un monastère comme une clairière de silence à la moitié du chemin. Il était une fois un pays, rêvé les yeux ouverts, épelé pas à pas dans la touffeur de mai.
Le canal (A pied de Nantes à Brest)
Veine palpitant dans l’intime repli des campagnes. Chemin d’eau qu’ont déserté chalands et gabares. Ligne de vie creusée dans la paume calleuse de la Bretagne. Le canal de Nantes à Brest ondule d’un bout à l’autre de la presqu’île. Au début d’un très beau mois de mai, j’ai parcouru à pied ses trois cent soixante kilomètres. Pour rien, pour le plaisir, pour jouir de cette prodigalité fastueuse : marcher ; passer son temps à le perdre ; se coucher sur la rive quand le soleil est trop chaud, pour lire ou regarder le ciel. Le canal : fil conducteur d’une échappée solitaire, de cette narration vagabonde.
Format : 12 x 17
Nombre de pages : 128 pages
ISBN : 978-2-84418-125-1
Année de parution : 2007
13,00 €
| Poids | 101 g |
|---|---|
| Auteur |
Guidet Thierry |
| Éditeur |
Collection La Part Classique |