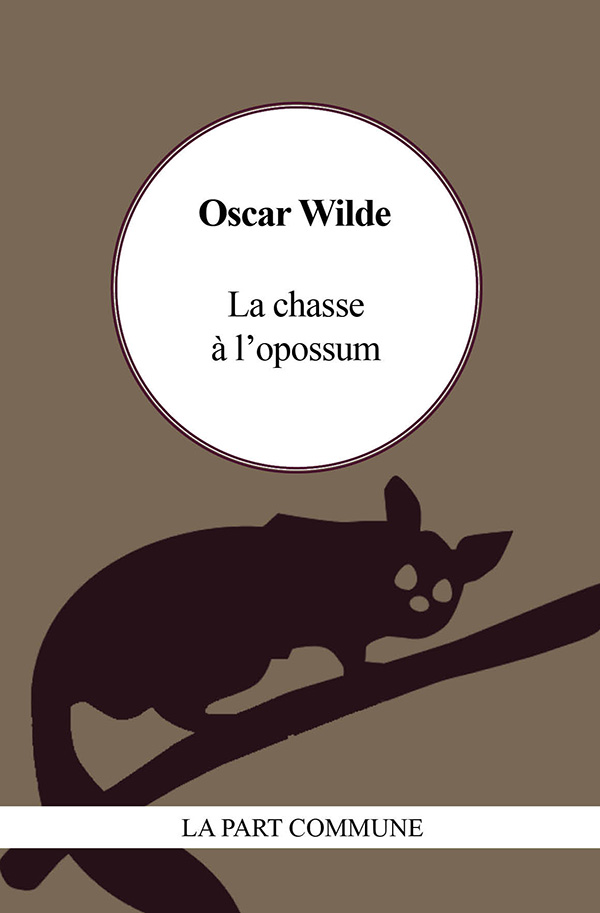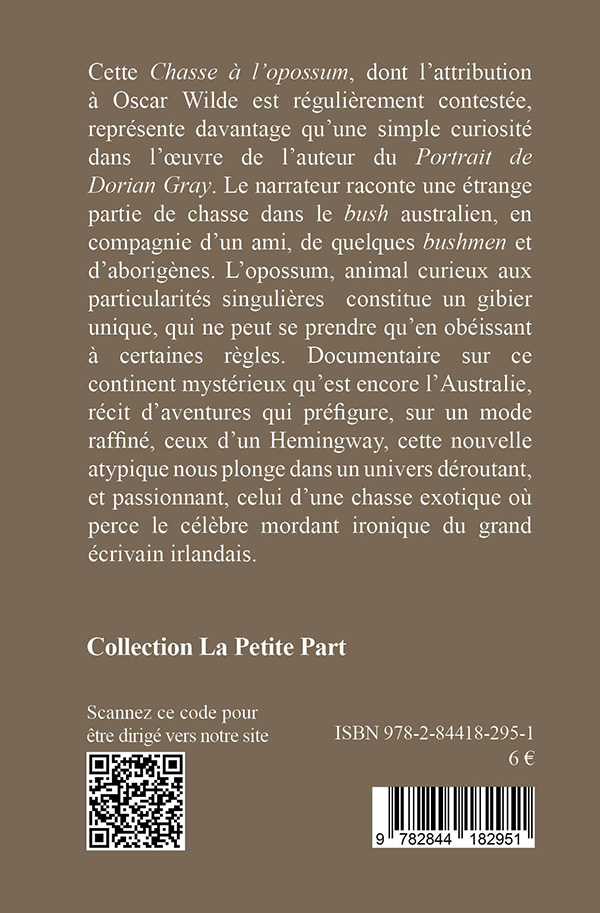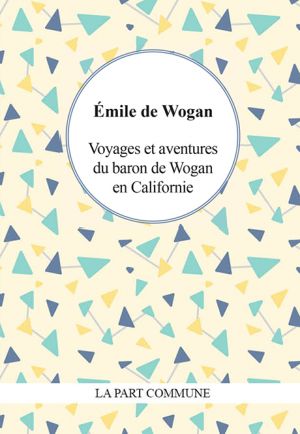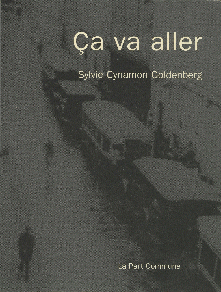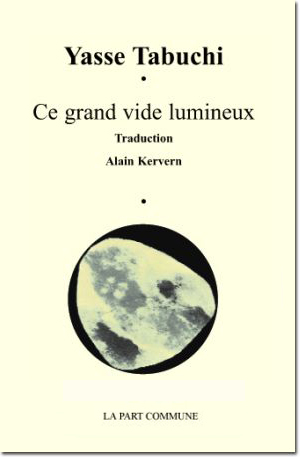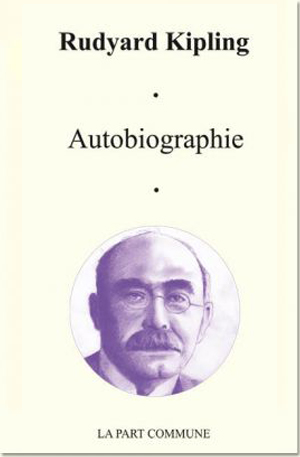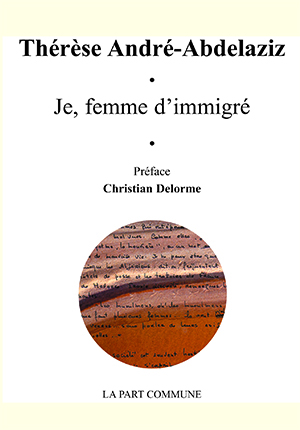Grande fut ma surprise, un matin en me réveil-
lant, d’entendre les chevaux piaffer sous mes fenêtres ; j’allais m’enquérir de la cause de ces préparatifs inusités, quand ma porte s’ouvrit et livra passage à mon ami Robert, équipé pour la chasse.
– Allons, paresseux ! me dit-il en riant ; dépêchons, il est temps de partir.
– Partir ?… où allons-nous donc ?
– Faire une tournée de chasse dans l’ouest.
Cinq minutes plus tard, j’étais dans la cour. Deux bushmen tenaient en main quatre chevaux sellés : de rudes hommes, ces
serviteurs de Robert ; des gaillards à figure rébarbative, ornée de longues barbes incultes, coiffés de vieux feutres déformés, vêtus d’une grosse chemise de laine rouge, de culottes de toile et de grandes bottes de cuir fauve. Pour compléter le costume, chacun d’eux portait à la ceinture un gros revolver, un couteau de chasse, et, en bandoulière, une lourde carabine.
Quelques minutes plus tard, nous galopions dans la plaine, suivis d’une légère voiture appelée buggy, conduite par un cuisinier nègre, et contenant les provisions. Devant nous gambadaient Néro et Trim, deux braques dressés spécialement à la chasse de l’opossum.
Ceci, cher lecteur, se passait en Australie, il y a maintenant cinq ans.
Les hasards de ma vie aventureuse m’avaient conduit à Sidney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud ; j’allais quitter cette ville pour me rendre à Melbourne quand,
la veille de mon départ, je rencontrai Robert, un ami d’enfance que je n’avais pas vu depuis notre sortie du collège.
– Je t’emmène, me dit-il, après m’avoir donné une vigoureuse accolade.
– Où cela ?
– Chez moi, à Robertville, sur les bords du Macquarie.
Je me laissai facilement entraîner, et, huit
jours plus tard, j’étais installé dans la demeure de mon ami, Robert, qui avait perdu
ses parents très jeune, était venu chercher fortune en Australie ; il s’était livré à l’élevage du bétail, modestement d’abord, mais chaque année augmentant le nombre de ses troupeaux et l’étendue de ses pâturages. Maintenant, soixante bushmen gardaient dans des plaines immenses ses innombrables troupeaux de bœufs et de moutons ; Robert était devenu un des plus riches éleveurs de la contrée…
Sa maison, une coquette demeure entourée de logements plus petits pour ses serviteurs, s’élevait non loin de la rivière, dans un bouquet d’eucalyptus et de fougères arborescentes.
J’y étais depuis quinze jours et je songeais au départ, quand la partie de chasse organisée par mon ami vint déranger tous mes projets.
Cependant, nous galopions toujours dans une plaine magnifique, où l’herbe poussait haute et drue ; de temps à autre, nous apercevions un troupeau de moutons gardés par un bushman à cheval ; il accourait bride abattue pour saluer le maître, et lui donner des nouvelles des bêtes.
À midi, nous fîmes halte dans une ferme appartenant à un Irlandais, M. O’Ryan, qui vivait là avec, Mme O’Ryan, son épouse, et une
douzaine de bambins plus frais, plus roses et plus blonds les uns que les autres.
Après un repas copieux et une heure de repos, nous reprenions notre course à travers une contrée fertile et boisée, mais absolument déserte.
– Nous ne verrons plus de maisons avant le retour, m’avait dit Robert en quittant la ferme de O’Ryan ; c’est le dernier établissement dans cette direction.
En revanche, le pays devenait plus accidenté ; çà et là, des rochers se dressaient dans les touffes de mimosas et les hautes fougères ; la plaine suivait un plan incliné, maintenant très sensible, et une ligne sombre de montagnes s’élevait devant nous, coupant l’horizon.
À cinq heures, nous étions au pied de ces collines, que les Australiens appellent Ranges, et nous nous arrêtions définitivement en face de hauts rochers, que recouvrait une végétation vigoureuse.
Un des bushmen, envoyé en éclaireur, alla visiter une anfractuosité de la roche, qui, du point où nous étions, semblait l’entrée d’une grotte ; mon ami voulait que nous installions là notre campement.
De loin, sur nos chevaux, nous voyions l’homme s’avancer avec précaution ; tout à coup, il s’arrêta et considéra longuement un objet placé à ses pieds.
Après un instant, il revint à nous.
– Eh bien ? demanda Robert.
– Pas moyen de camper là, répondit le bush-
man ; c’est un vrai charnier ; il y a de nombreux ossements, et entre autres un grand squelette…
– Quelque kanguroo blessé par un chasseur maladroit, qui sera venu mourir dans cette caverne, interrompit l’autre bushman. Campons dans le bois, Monsieur, cela vaudra mieux.
Et rentrant sous bois, nous gagnâmes une clairière, qui fut choisie à l’unanimité pour
y établir notre camp. Les bushmen débarrassèrent les chevaux de leurs selles, les entravèrent en leur attachant un pied de derrière au pied de devant du même côté, afin de leur permettre de marcher sans cependant pouvoir s’éloigner ; Tom, le nègre, commença les apprêts du repas.
Après le dîner, Robert et moi, étendus sur une couverture au pied d’un grand eucalyptus, fumions tranquillement en parlant de la France, de nos amis communs ; et, ma foi, en nous rappelant nos jeunes années et ceux que nous avions connus et aimés, nous n’étions pas loin de nous attendrir ; je jugeai utile de donner un autre tour à la conversation.
– Me diras-tu maintenant, Robert quel genre de gibier nous venons chasser dans ces solitudes ?
– Oui, mon ami, j’ai voulu te procurer le plaisir d’une chasse à l’opossum.
– Maigre proie, si j’en crois ce que j’ai lu dans les livres d’histoire naturelle.
– On chasse ce que l’on peut, mon cher.
– Il est certain qu’en fait de gibier, l’Australie laisse à désirer.
– Tu as raison, et il faut avouer, reprit Robert en riant, que c’est un singulier pays que l’Australie, cette grande île aussi vaste qu’un continent, placée aux antipodes de l’Europe et qui simule en bien des points un monde renversé. Quand je pénétrai pour la première fois dans l’intérieur, que je visitai les régions qui forment la limite de cette province, je restai positivement ébahi devant ces arbres géants dont les cimes touffues ne donnent pas d’ombre, parce que leurs feuilles sont verticales ; devant ces fougères énormes qui forment de véritables bois. Mais c’est surtout la faune de cette contrée qui renversa toutes mes notions d’histoire naturelle.
– Figure-toi, dans les plaines, des bandes de kanguroos qui procèdent par bonds au, lieu de courir et emportent leurs petits dans une poche ; des autruches, qu’ils nomment ici émeus, couvertes de poils, au lieu de porter des plumes comme leurs congénères d’Afrique ; sur le bord des rivières et des lacs, des mammifères amphibies, avec un corps de loutre et un bec de canard ; c’est
l’ornithorynque. Dans les forêts, des perroquets gros comme des serins, criards et bavards, et sur les arbres, des quadrupèdes, des opossums.
La Chasse à l’opossum
Cette Chasse à l’opossum, dont l’attribution à Oscar Wilde est régulièrement contestée, représente davantage qu’une simple curiosité dans l’œuvre de l’auteur du Portrait de Dorian Gray. Le narrateur raconte une étrange partie de chasse dans le bush australien, en compagnie d’un ami, de quelques bushmen et d’aborigènes. L’opossum, animal curieux aux particularités singulières constitue un gibier unique, qui ne peut se prendre qu’en obéissant
à certaines règles. Documentaire sur ce continent mystérieux qu’est encore l’Australie, récit d’aventures qui préfigure, sur un mode raffiné, ceux d’un Hemingway, cette nouvelle atypique nous plonge dans un univers déroutant, et passionnant, celui d’une chasse exotique où perce le célèbre mordant ironique du grand écrivain irlandais.
__________________________________________________________________________________________________
Format : 10,5×15
Nombre de pages : 48 pages
ISBN : 978-2-84418-295-1
Année de parution 2017
6,00 €