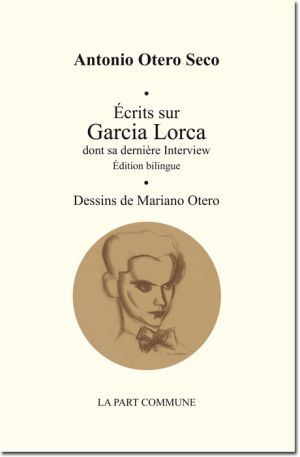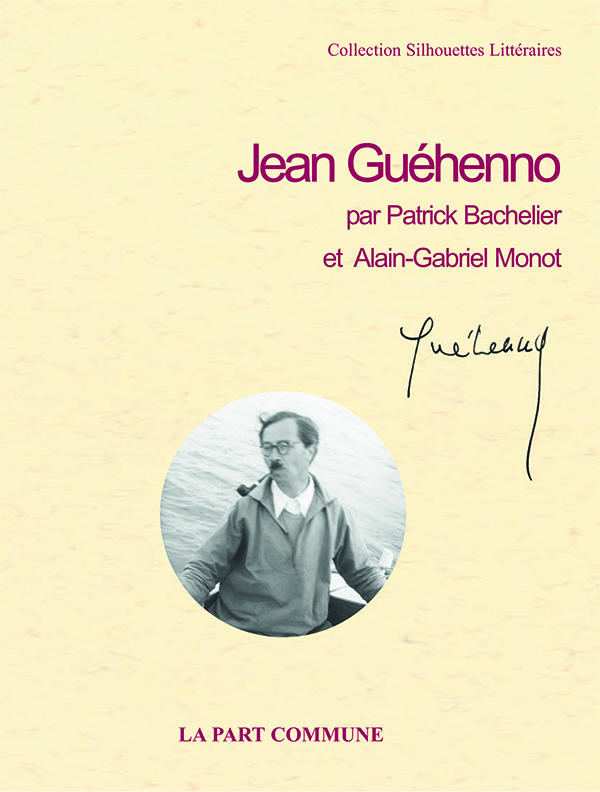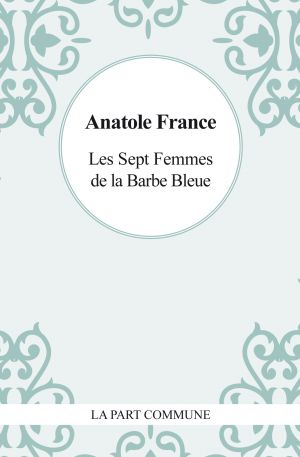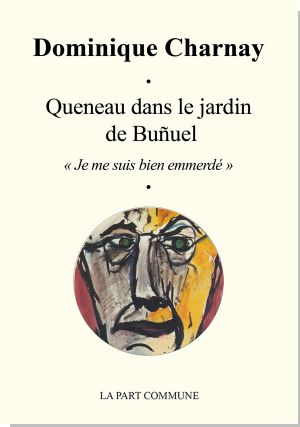Philosophe, poète, théologien, Jules Lequier a consacré sa vie à une énigme métaphysique, un mystère chrétien : l’existence humaine comme libre arbitre. Disparu en février 1862 sans avoir laissé de consignes relatives à ses papiers et ne s’étant jamais résolu à publier le moindre texte de son vivant, on ne trouva dans sa maison, au lendemain de sa mort, que les fragments d’une œuvre en gestation depuis plusieurs années.
Un halo de mystère entoura les fragments de Lequier pendant quelque temps, jusqu’à ce qu’en 1865, le philosophe Charles Renouvier (1815-1903) décide d’éditer à compte d’auteur certains fragments de son défunt ami, sous le titre de La recherche d’une première vérité. Il distribua une centaine d’exemplaires de l’ouvrage à ses proches, ainsi qu’à certaines personnes susceptibles d’y reconnaître la marque d’un grand génie1. D’autre part, en guise de reconnaissance envers celui qu’il considérait comme son maître, Renouvier inséra de nombreux fragments de Lequier dans ses ouvrages personnels et fit ériger une petite statue sur la tombe de Lequier dans le cimetière du village de Plérin (département des Côtes-d’Armor, anciennement dénommé Côtes-du-Nord). Cette statue, œuvre d’un certain Elmerich, représente le philosophe dans une posture mélancolique. Sur son socle est gravé le message suivant :
Ce monument a été élevé à la mémoire d’un ami malheureux et d’un homme de grand génie, en 1868, par Renouvier.
Ses œuvres : La Feuille de Charmille, La Recherche d’une première vérité, Le dialogue du prédestiné et du réprouvé, Abel et Abel.
Jules Lequier, né à Quintin en 1814, décédé à Plérin en 1862.
Priez pour lui.
Jules Lequier naît à Quintin, dans l’Argoat des Côtes-d’Armor, le 29 janvier 1814. Il est le fils d’un père scientifique, Jean Joseph Léquyer, médecin, auteur d’une thèse sur le pouvoir de la nature dans la guérison des maladies. Sa mère, Céleste Marie Eusèbe Digaultray, âme pieuse et charitable, a connu Jean Joseph Léquyer à l’hôpital de Quintin quelques années auparavant, alors qu’elle prodiguait des soins à de pauvres malades. Vingt ans après la naissance de leur fils, en février 1834, lors d’une audience publique demandée par le père de l’intéressé, le Tribunal civil de Saint-Brieuc ordonnera une rectification pour cause « d’erreur peut-être préjudiciable au sieur Léquyer fils » de l’orthographe de son nom sur son acte de naissance.
à Saint-Brieuc, où se déroule l’enfance de son fils unique, Jean Joseph Léquyer jouit de la réputation d’honnête et bon médecin. Propriétaire d’une parcelle de terrain dans le centre de la préfecture des Côtes-du-Nord, il possède aussi une propriété sur la côte briochine, Plermont (contraction de « Plérin-Mont »), où la petite famille vient passer ses vacances. Situé dans la proche campagne de Plérin, à quelques encablures de la Manche, le romantique lieu-dit des Villes Gaudu, où se trouve Plermont, est très isolé. Seuls quelques mendiants, réclamant l’aumône, passent de temps à autre sous les fenêtres du jeune Lequier. Ce hameau couronne un des nombreux mamelons verdoyants qui avoisinent la côte briochine, aux pieds desquelles serpentent des petits ruisseaux bordés de haies de saules, d’aubépines et d’églantiers sauvages. Pour y accéder, été comme hiver, il faut, depuis le lieu-dit de Clairefontaine, patauger dans un unique chemin creux et défoncé. à marée haute, la mer, que l’on distingue entre les branches des pins maritimes qui bordent la côte, laisse entendre la douce mélodie des vagues s’étalant sur la grève des Rosaires. Pour se rendre sur cette immense bande de sable située en contrebas de Plermont, Lequier n’a qu’à emprunter un sentier taillé entre les bruyères et les ajoncs. Là, sur sa gauche, se trouve la cave de la fée Margot. Dans cette petite cavité creusée par le ressac de la mer, l’enfant aime passer ses après-midi à jouer parmi les rochers. D’autres fois, le jeune Jules se contente de la campagne avoisinant Plermont, autre terrain de jeu riche et varié. Dans La Feuille de Charmille, hymne à l’enfance et à la nature qui s’éveille, Lequier immortalise cette enfance champêtre.
ô charme des souvenirs ! La terre s’embrasait aux feux du printemps et la mouche vagabonde bourdonnait le long des allées. Devant ces fleurs entr’ouvertes qui semblaient respirer, devant cette verdure naissante, ces gazons, ces mousses remplies d’un nombre innombrable d’hôtes divers ; à ces chants, à ces cris qui tranchaient par intervalles sur la sourde rumeur de la terre en travail, si continue, si intense, et si douce qu’on eût cru entendre circuler la sève de rameau en rameau et bouillonner dans le lointain les sources de la vie, je ne sais pourquoi j’imaginais que depuis ma pensée jusqu’au frémissement le plus léger du plus chétif des êtres, tout allait retentir au sein de la nature, en un centre profond, cœur du monde, conscience des consciences, formant de l’assemblage des faibles et obscurs sentiments isolés dans chacune d’elles un puissant et lumineux faisceau.
Lors d’une belle journée printanière, le petit Jules, alors seul dans le jardin de Plermont, est soudainement prit d’un sentiment jusqu’alors inconnu, lui faisant interrompre ses jeux. Au moment de saisir une feuille dans la haie d’un arbuste, l’enfant est émerveillé par son pouvoir souverain de saisir ou de ne pas saisir cette feuille.
Un jour, dans le jardin paternel, au moment de prendre une feuille de charmille, je m’émerveillais tout à coup de me sentir le maître absolu de cette action, toute insignifiante qu’elle était. Faire, ou ne pas faire ! Tous les deux si également en mon pouvoir ! Une même cause, moi, capable au même instant, comme si j’étais double, de deux effets tout à fait opposés ! Et, par l’un ou par l’autre, auteur de quelque chose d’éternel, car quel que fût mon choix, il serait désormais éternellement vrai qu’en ce point de la durée aurait eu lieu ce qu’il m’aurait plu de décider. Je ne suffisais pas à mon étonnement ; je m’éloignais, je revenais, mon cœur battait à coups précipités.
Démiurge dans son jardin, Lequier décide de saisir la feuille. Aussitôt, le bruit causé par son geste effraye un petit oiseau jusqu’alors niché au pied de la haie, qui, apeuré, s’envole. Une fois dans les airs, l’oiseau est pris dans les serres d’un épervier.
A l’image de cet oiseau s’échappant de la haie, la vie de Lequier bascule, de l’idée peut-être naïve d’une liberté souveraine, à l’angoissante idée d’une implacable nécessité.
C’est moi qui l’ai livré, me disais-je avec tristesse : le caprice qui m’a fait toucher cette branche, et non pas cette autre, a causé sa mort. Ensuite, dans la langue de mon âge (la langue ingénue que ma mémoire ne retrouve pas), je poursuivais : Tel est donc l’enchaînement des choses. L’action que tous appellent indifférente est celle dont la portée n’est aperçue par personne, et ce n’est qu’à force d’ignorance que l’on arrive à être insouciant.
Ces premières lignes de La Feuille de Charmille, illustrant la découverte spontanée du libre arbitre, illustrent aussi la découverte d’une culpabilité originelle. Car l’homme, à l’image de l’enfant responsable de la mort du petit oiseau, ignorant la portée de ses actes, est, selon Lequier coupable d’un usage aveugle de sa liberté. Afin d’éviter la propagation du mal, consécutive de cette ignorance, une justification philosophique du libre arbitre est nécessaire. Ce désir de justification, né de cet épisode de culpabilité enfantine, accompagnera Lequier sa vie durant.
L’enchaînement des événements naturels qui succède à la saisie de la feuille de Charmille, émoustillant l’imagination de l’enfant, va faire succéder au sentiment de culpabilité le sentiment d’une terrible angoisse. Cet émoi existentiel, ressenti avec la même intensité que Lequier par son contemporain danois Sören Kierkegaard (1813-1855) et conceptualisé au siècle suivant par Jean-Paul Sartre (1905-1980), émerge d’une vision déterministe du monde, dans laquelle le libre arbitre se trouve annihilé. Cette terrible idée d’une nécessité universelle régissant le grand tout ; s’immisçant des moindres parcelles de la nature à toutes les régions de la pensée de l’enfant, a des conséquences désastreuses sur ses convictions les plus intimes. L’impossible intellection de l’ensemble des causes et des conséquences de ses gestes lui fait douter de la propension qu’à l’homme à véritablement connaître. Dans cette perspective, toute tentative de réflexion se trouve réduite à n’être qu’une illusion, et l’homme, le complice de cette illusion qui le berce. Sur le plan éthique, l’homme n’ayant plus à se poser la question des conséquences de ses actes, systématiquement nécessaires, se trouve dépossédé de la responsabilité de ses choix. Dans ce monde nécessaire, le bien et le mal deviennent des concepts vides, « deux fruits nés de la même sève sur la même tige ».
Cependant, coup de théâtre philosophique, Lequier se révolte. Il lui faut sortir de cette idée d’une nécessité universelle, car cette situation, propice à une inaction déraisonnable, n’est pas tenable. L’unique issue de La Feuille de Charmille est un pari philosophique : contre l’angoissante idée d’un déterminisme universel, il faut parier sereinement pour la croyance en l’excellence du libre arbitre.
Soudain je la relevai. Ressaisissant la foi en ma liberté par la liberté même, sans raisonnement, sans hésitation, sans autre gage de l’excellence de ma nature que ce témoignage intérieur que se rendait mon âme créée à l’image de Dieu et capable de lui résister, puisqu’elle devait lui obéir, je venais de me dire, dans la sécurité d’une certitude superbe : Cela n’est pas, je suis libre.
à l’âge de dix ans, Lequier entre en classe de septième au collège communal de Saint-Brieuc. Il s’agit d’une sorte de petit séminaire, ayant pour principal un abbé, chanoine honoraire, et des ecclésiastiques pour professeurs. Il restera dans cet établissement jusqu’en 1829, y recevant une éducation classique et catholique, complétée au foyer paternel par les exemples de piété et de dévouement de sa mère et de leur servante, Marianne Feuillet (une bretonne originaire de Lanfains, une commune avoisinant Quintin). Lequier commence à briller dans les études à partir de l’année scolaire 1827-1828, pendant laquelle il obtient le premier prix de version grecque et des premiers ou seconds accessits en thème grec, en latin et en excellence. Il obtiendra par la suite des résultats analogues, qui feront la fierté du médecin briochin.
Les préceptes et l’esprit du catholicisme, alors omniprésent dans cette région de la Haute-Bretagne, imprègnent la sensibilité du futur philosophe. La messe est célébrée tous les dimanches et certains jours de fêtes sont l’occasion de grands rassemblements silencieux, comme le soir de la Saint-Jean, où a lieu une procession, suivie d’un feu de joie, autour duquel les enfants s’émerveillent. Outre la prééminence des croyances religieuses, perdurent de nombreuses superstitions païennes liées à la peur de la mort, et les longues veillées d’hiver, que l’on passe auprès de l’âtre, sont l’occasion pour les anciens de conter aux enfants des légendes bretonnes. On parle d’intersignes, annonciateurs d’une mort proche, de la figure de l’Ankou, ouvrier de la mort, on se remémore de mythiques apparitions de noyés. Lequier ressent dans l’isolement des landes de Plermont un climat envoûtant, similaire à celui ressenti par Chateaubriand dans les landes environnantes du château de Combourg. Cependant, contrairement au célèbre écrivain des Mémoires d’Outre-tombe, qui su tirer bénéfice de son enfance bretonne pour entrer dans la postérité,
« Lequier respira une atmosphère qui dans son enfance sera pour lui enchanteresse et finira par devenir vénéneuse».
Son enfance bretonne a inspiré à Lequier un conte breton, intitulé La fourche ou la quenouille ou Les sept frères. Il s’agit d’une œuvre de jeunesse qui n’a jamais fait l’objet d’une publication. Malgré des emprunts évidents au folklore breton,
La fourche ou la quenouille est une peinture originale des mœurs locales de la Bretagne natale du philosophe. Les personnages du conte (le fermier Marc et sa femme Marguerite, le recteur, le meunier, le tailleur) ainsi que les lieux où se déroule l’action sont fortement inspirés de personnes et de lieux qui lui furent familiers. Ces éléments, romancés pour les besoins du conte, permettent de se faire une idée du climat dans lequel le philosophe a été élevé et de l’influence qu’ont exercé sur sa sensibilité certaines personnes et certains lieux. Fait unique dans l’ensemble de l’œuvre inachevée, on trouve dans ce texte une référence explicite à la grève des Rosaires, où Lequier aimait se promener de jour comme de nuit. Malheureusement, comme la plupart des textes de Lequier, ce conte nous est parvenu à l’état fragmentaire et reste inachevé.
Pendant les vacances, quand il séjourne à Plérin, Lequier entraîne régulièrement une petite bande à sa suite dans la campagne de Plermont ou du côté de la cave de la fée Margot. Déjà très doué pour inventer et raconter des histoires, tous tombent sous le charme du futur philosophe. Ce dernier étonne par sa bonne humeur et par sa grâce. Sa verve d’esprit fait de lui un génie précoce, exerçant une indéniable fascination sur ses proches. Parmi ces enfants du pays, il y a les deux frères épivent, et plus particulièrement Louis épivent (1805-1876), de neuf années son aîné, qui finit ses études au collège de Saint-Brieuc quand Lequier y commence les siennes. Louis épivent entrera par la suite au séminaire et deviendra, adulte, curé de la paroisse de Saint-Brieuc, puis évêque de Dax. Partageant avec Lequier une même religiosité, il exerce alors une influence déterminante sur la sensibilité du philosophe, éveillant en lui un penchant pour l’étude des grandes questions théologiques.
Vous rappelez-vous ? Vous rappelez-vous la Ville-Guy. La rencontre, une nuit, de mon Père et de Pierre Saint. Une nuit que M. Pierre Saint m’a raconté tant de fois. Le noyer. Les veillées. La prière du soir. Vous rappelez-vous comme nous aimions à parler des pèlerins d’Emmaüs… ô tardi corde ad credendum.
Et nos promenades, pendant lesquelles je disais avec vous quelque chose du bréviaire. Et mes questions, mes embarras obstinés sur le libre arbitre et la grâce ? Et les mauvais vers de l’écolier à son ancien maître bien-aimé. Et vos lettres, attendues toujours avec tant d’impatience et de joie. Et votre voyage à Paris pendant que j’étais à l’école Polytechnique ? Et plus tard, quand je vous retrouvais, quand je m’avisais de vous reconquérir, vous savez ? Ut qui diligit…