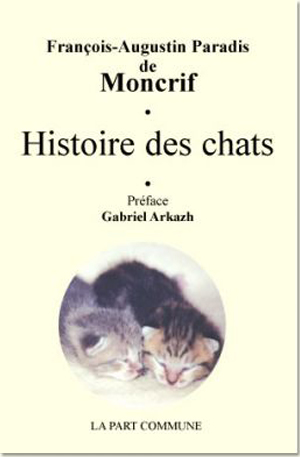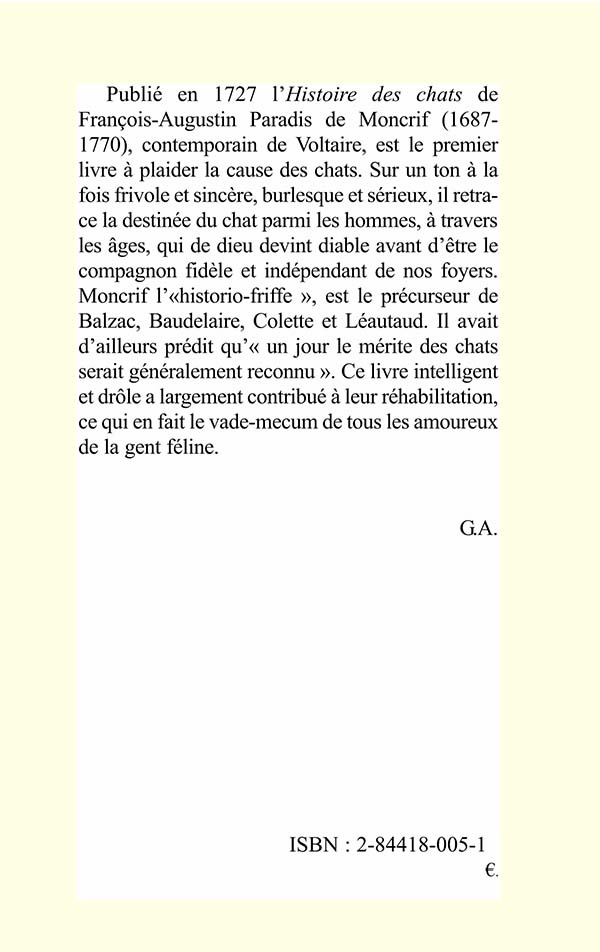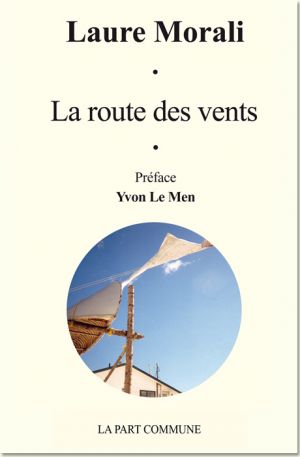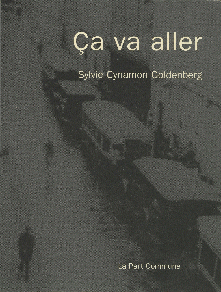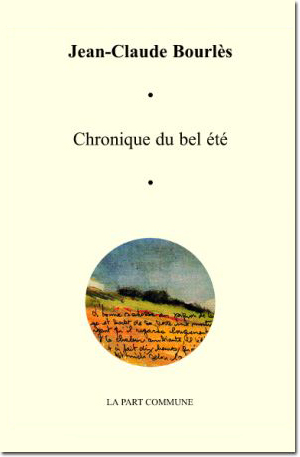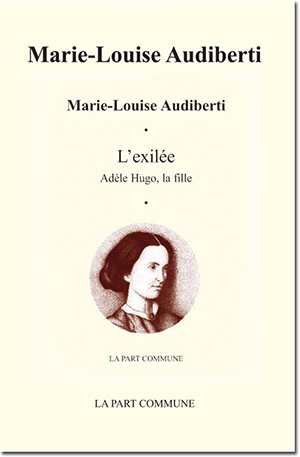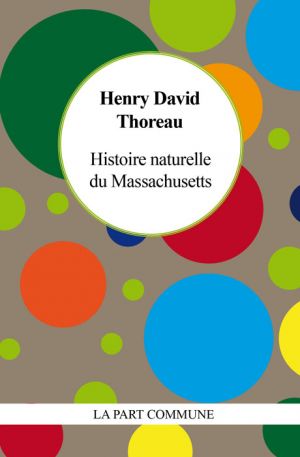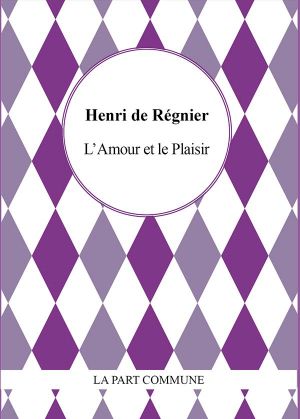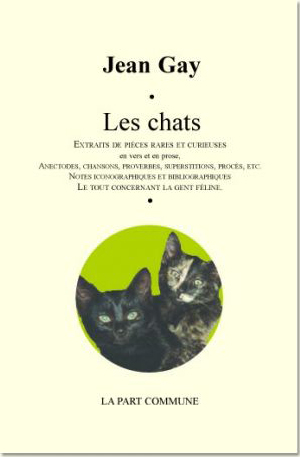Troisième lettre
Notre ouvrage s’avance, madame ; bien des personnes sensées en ont senti l’utilité et m’ont secouru de leurs lumières ; sérieusement je crains que la dame d’avant-hier ne se soit évanouie de bonne foi : ce n’est presque plus le bon air, que de jouer de certaines frayeurs ; ainsi, bientôt on ne songera pas à avoir peur des chats. Les femmes n’adoptent guère de ridicules, que ceux qui portent avec eux un caractère d’agrément ; leur vanité est à cet égard bien plu sensée que la nôtre.
Mais serait-ce assez pour nous que de voir l’antipathie pour les chats s’effacer ? Ne faudrait-il pas que tous les yeux fussent ouverts sur leur mérite ?
Ne reviendrez-vous point, heureux siècle d’Astrée,
Jours de paix, de plaisirs, ivresse du bonheur,
Où l’amour une fois jurée
Pour jamais régnait dans un cœur ;
Où l’épouse tendre et chérie
Ne connaissait de sort plus doux
Que de passer toute sa vie
Entre son chat et son époux ?
Mais ne nous arrêtons point, madame, à des idées trop flatteuses ; passons à bien des vérités historiques que nous avons encore à faire valoir.
Les Arabes adoraient un chat d’or ; ils avaient une si grande opinion des chats, qu’ils ne purent jamais se résoudre à leur croire une origine semblable à celle des autres animaux.
Ils singularisèrent celle-ci par une fable qui acquit bientôt parmi eux l’autorité de l’histoire : les rats, selon cette fable, s’étaient multipliés dans l’arche et rongeaient sans aucune discrétion la pâture des autres animaux. Noé résolut de les détruire, et, se trouvant auprès du lion, il lui donna un soufflet : ce soufflet causa au lion un éternuement, et de l’éternuement sortit un beau chat, le premier chat qui sot venu livrer la guerre aux souris.
Ce merveilleux événement n’est, comme vous le voyez, madame, que médiocrement développé par l’auteur arabe ; il n’explique point par quel motif Noé se détermina à souffleter le lion par préférence ; mais nous retrouvons heureusement cette même fable rendue avec plus de clarté dans une des lettres persanes ; voici comment elle est contée. Il était sorti du nez du cochon un rat qui allait rongeant tout ce qui se trouvait devant lui, ce qui devint si insupportable à Noé, qu’il crut qu’il était à propos de consulter Dieu encore ; il lui ordonna de donner au lion un grand coup sur le front, qui éternua aussitôt, et fit sortir de son nez un chat.
Les circonstances de cette fable, heureusement restituées par l’auteur des Lettre persanes, prouvent bien avec quel choix et quelle finesse il sent les traits propres à jeter de vrais agréments dans un ouvrage ; et ce fragment de l’histoire des chats n’a pas peu contribué ; sans doute, au succès d’un livre aussi généralement applaudi. Et les Perses, madame (on sait que c’était un peuple éclairé), croit-on qu’ils n’avaient par une haute estime des chats ? Il n’y a qu’à lire ce qui se passa sous le règne d’un de leurs plus illustres rois ; il s’appelait Hormus ; tranquille dans le sein de la paix, ce monarque apprit qu’une armée de trois cent mille hommes, commandée par le prince Schabé-Schah, son parent, faisait une invasion dans son empire ; il assembla ses ministres ; et tandis qu’ils délibéraient sur une conjoncture si pressante, un vieillard vénérable se présenta et parla ainsi : « Roi, l’armée du rebelle peut être détruit en un seul jour, et vous avez dans vos Etats le héros auquel cette victoire est réservée ; vous le connaîtrez entre vos capitaines par une distinction aussi rare qu’avantageuse ; mais, pour ne pont vous paraître suspect dans ce que j’avance, il faut que je vous rappelle les services que j’ai rendus au roi Nourchivan, votre illustre père. Ce fut à moi que ce monarque confia le soin d’aller demander de sa part au Khacan des Turcs une de ses filles en mariage ; je fus introduis dans le palais des princesses ; elles me parurent toutes extrêmement belles, et j’aurais été bien embarrassé à me déterminer, si j’avais cru que la beauté uniquement dût fixer mon choix ; mais je voulais que ce fussent les qualités du cœur et de l’esprit qui emportassent la balance. Je demandai au Khacan la liberté de demeurer quelque temps à sa cour, afin de pouvoir connaître le caractère des princesses ses filles. Elles marquaient toutes un égal empressement de devenir épouses du roi de Perse, et j’examinais secrètement les différents ressorts qu’elles faisaient pour m’engager à leur donner chacune la préférence ; une seule (et c’est elle qui est devenue la reine votre mère), une seule, dis-je, ne mit en usage que la même conduite qu’elle avait toujours gardée ; c’était une grande douceur dans le caractère, un goût toujours le même pour ses devoirs, un certain agrément dans l’esprit, qui la faisait aimer de tout ce qui approchait d’elle. Enfin, pour fixer mon choix, elle ne voulut paraître que ce qu’elle était, et je crus reconnaître à cette marque le vrai caractère de la vertu. Je la demandai au nom de mon roi ; et l’empereur son père, suivant l’usage de ses Etats, avant le départ de la princesse, fit faire son horoscope par les plus habiles astrologues ; ils s’accordèrent tous en une circonstance : ils prédirent qu’elle aurait un fils qui surpasserait en renommée tous ses ancêtres ; que ce prince serait attaqué par un des rois du Turkestan, sur lequel il remporterait une victoire entière, s’il était assez heureux de trouver un de ses sujets qui eût la physionomie d’un chat sauvage. » Ce récit achevé, le vieillard, qui avait la science des sages, disparut comme un éclair.
Le roi ne songea plus qu’à chercher le héros qui devait sauver ses Etats. Le vieillard n’avait pont déclaré son nom, ni donné aucune lumière sur le séjour qu’il habitait ; mais la ressemblance avantageuse du chat de fit bientôt reconnaître dans la personne de Baharam, surnommé Kounin. Il était de la race des princes de Rei et gouvernait pour lors la province d’Adherbigan. Hormus le pressa de prendre le commandement de son armée et resta surpris merveilleusement, lorsque Baharam ne choisit que douze mille hommes pour combattre les trois cent mille rebelles ; cette troupe, animée par le présage admirable dont leur était la physionomie de leur général, vainquit l’armée
ennemie ; Baraham tua de sa main le prince Schabé-Schah et fit prisonnier son fils ; ainsi la victoire la plus digne d’illustrer la Perse peut être regardée comme l’ouvrage des chats. Quand Sannachérib, roi des Arabes et des Assyriens, perdit cette célèbre bataille contre le roi d’Egypte, aurait-il éprouvé ce grand revers s’il avait eu la précaution d’avoir des chats dans son armée ? Il était campé près de Peluse, lorsqu’une nuit des rats champêtres, s’était jetés dans son camp, rongèrent les arcs et ce qui servait à tenir les boucliers ; Sethon, qui régnait alors en Egypte et qui n’avait qu’une poignée de soldats, attaqua dans cette conjoncture les troupes de Sannachérib, qui, se trouvant sans armes, n’eurent d’autres ressources que la fuite ou la captivité : que le roi des Assyriens eût été secondé par quelque chat, il faisait la conquête de l’Egypte.
Si tous les historiens célèbres ne se sont pas attachés également à rapporter les événements merveilleux occasionnés par les chats, on découvre du moins que tous avaient pour eux en général une estime marquée. Lucien, dans son dialogue de l’assemblée des dieux, en examinant les animaux honorés en Egypte, tourne en ridicule les singes, les cynocéphales, les sphinx ; mais il garde sur les chats un silence respectueux : cette retenue dans un philosophe aussi cynique ne peut être regardée que comme un véritable éloge ; et ce n’est pas la seule occasion où les chats aient été ménagés avec beaucoup d’égards. On empêchait avec son, chez les Romains, que les chiens n’entrassent jamais dans les temples d’Hercule ; le sacrifice aurait été interrompu et les mystères profanés. Ceux qui avaient porté cette loi avaient prévu, sans doute, que les chats qui, par leur souplesse, se font un passage aux lieux mêmes où les chiens ne peuvent aborder, pourraient aisément se produire dans ces temples ; les chats cependant n’étaient point délignés dans cette loi exclusive. Quelle preuve plus manifeste que la présence des chats n’était jamais regardée qu’en bonne part dans les plus augustes assemblées, nous les avons déjà fait voir à la place d’honneur dans les festins de l’Egypte, mangeant et faisant les délices de la table par le charme de leur voix : cette circonstance de leur triomphe, qui paraîtra peut-être la plus difficile à croire, trouve cependant encore une preuve bien claire dans ce que Plutarque dit au sujet des cigales qu’il appelle musiciennes. Il prétend qu’elles étaient estimées comme telles par Pythagore, et que c’et en faveur de leur musique qu’il avait défendu qu’on gardât dans les maisons des nids d’hirondelles, parce que ces oiseaux mangent les cigales. On ne contestera point, je crois, à Phythagore d’avoir été le plus délicat connaisseur en musique qu’ait eu l’Antiquité. Quelqu’un qui entend le concert des astres, qui sent si la planète de la terre produit par son mouvement une tierce ou une octave exacte avec le son que forme la planète de Vénus, en doit être cru quand il déclare que les cigales sont musiciennes ; et en bonne foi, si leur chant est mélodieux, il faudrait être de bien mauvaise foi, si leur chant pour disputer aux chats le même avantage. On conviendra du moins que la voix des chats est plus éclatante ; et d’ailleurs nous distinguons bien mieux la variété et le dessein de leur chant ; il est si simple et si agréable, que les enfants, à peine sortis du berceau, le retiennent et se font un plaisir de l’imiter. Mais nous avons, madame, dans une fête donnée à la cour de Louis XI, une musique auprès de laquelle un concert de chats devient la chose du monde la plus simple…