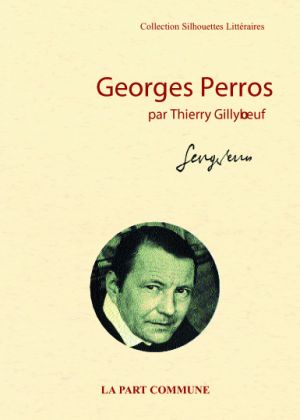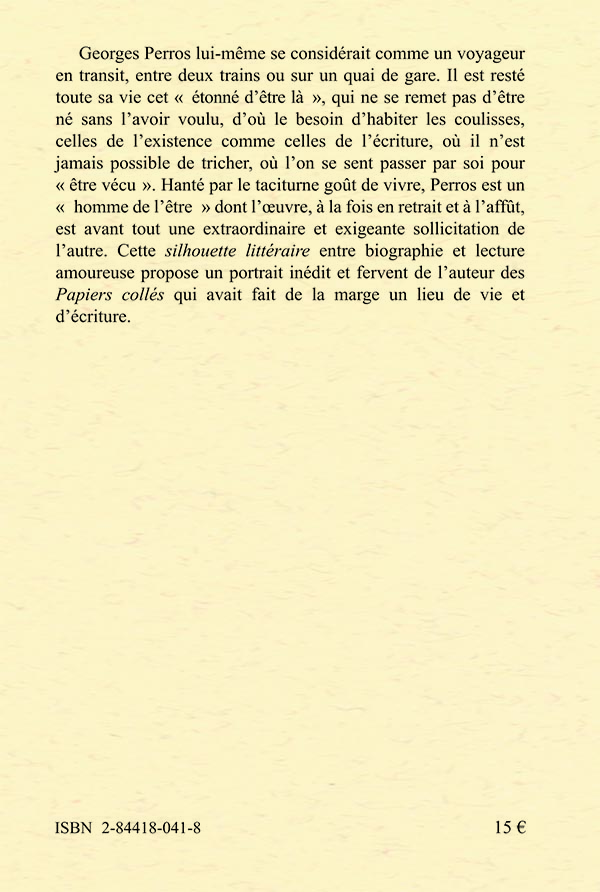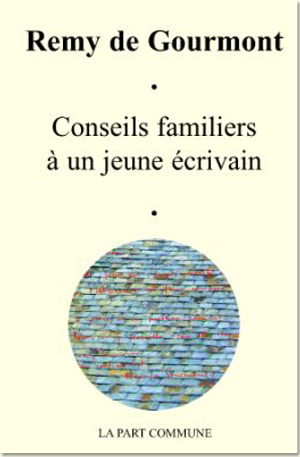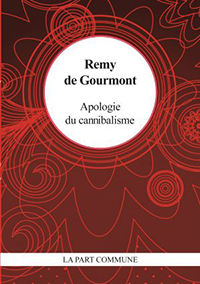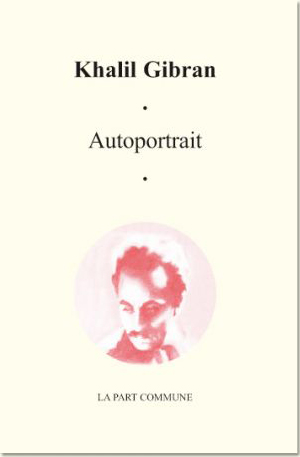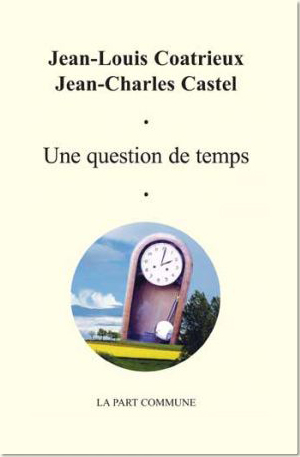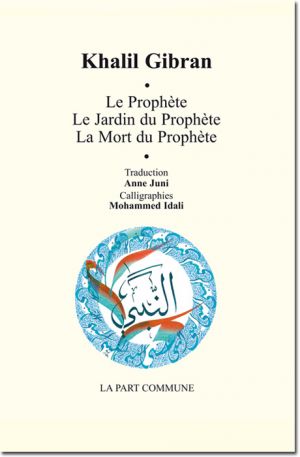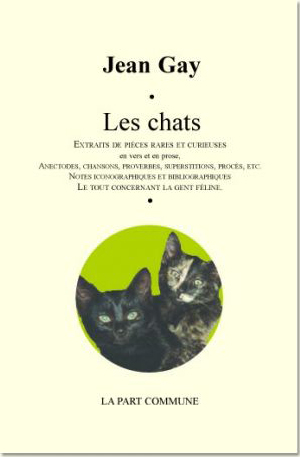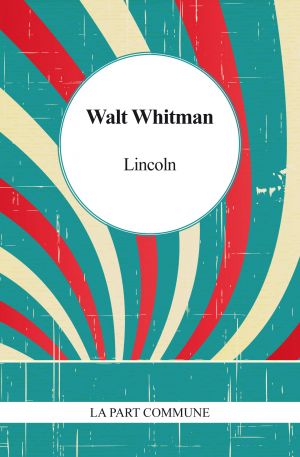Georges Perros affirmait écrire dans les marges d’un livre impossible qui annulerait la distance entre la vie et l’homme. Se pourrait-il que ce « livre impossible » ne fût pas seulement idéal littéraire mais territoire de l’homme. Ainsi, l’œuvre de Georges Perros, tissée avec son moi intime, apparaîtrait comme le négatif, au sens photographique du terme, d’une vie qu’il disait ordinaire, mais dont il consent pourtant à révéler et partager, avec une fraternelle exigence, la miraculeuse richesse. Il voulait pourtant faire de sa vie un désert ; mais elle est le matériau primitif de son œuvre, tant il sut la peupler de sa solitude en se plaçant au bord des hommes et de l’écriture :
Sans la littérature, on ne saurait ce que pense un homme quand il est seul.
Selon la très belle formule de Gilles Plazy, Georges Perros est un merveilleux « alchimiste de l’ego », pour qui tout ce qu’il vit doit être l’objet d’une élaboration dans son langage. À ce titre, l’œuvre entière de Perros est un exercice de style autobiographique, ou pour reprendre une expression de Serge Doubrovsky : une « autofiction ». Mais sur un air de fugue :
Ce que j’écris est à lire dans un train, par un voyageur qui s’ennuie, et qui trouve sur la banquette, oublié, un de mes bouquins.
Georges Perros lui-même se considérait comme un voyageur en transit, entre deux trains ou sur un quai de gare. Il est resté toute sa vie cet « étonné d’être là », qui ne se remet pas d’être né sans l’avoir voulu, d’où le besoin d’habiter les coulisses, celles de l’existence comme celles de l’écriture, où il n’est jamais possible de tricher, où l’on se sent passer par soi pour « être vécu ». Hanté par le taciturne goût de vivre, Perros est un « homme de l’être » dont l’œuvre, à la fois en retrait et à l’affût, est avant tout une extraordinaire et exigeante sollicitation de l’autre.
Georges Poulot est né le 31 août 1923 à Paris, dans une mansarde de la petite rue cachée Claude-Pouillet :
Je suis né ça me va très bien
dans une rue sans envergure
elle est dans Paris cherchez-la
entre le Parc Monceau […]
et la place de Clichy
Son père est inspecteur dans une compagnie d’assurances du côté de la rue Taitbout :
Que me reste-t-il de mon père
sinon certains gestes que j’ai
ou que je me surprends d’avoir
un timbre de voix un accent
qui m’empêche d’être vivant
sans faire acte d’hérédité
Sa mère, originaire de Fruges, est fille de paysans du Pas-de-Calais où elle passa toute son enfance. Mais si elle est trop attachée à Paris – celui des grands magasins populaires et du Louvre – pour en repartir, elle avait conservé l’habitude de boire « son café / à la mode ch’timi le sucre / dans la bouche pas dans la tasse ».
Prématuré à sept mois et demi, il a un frère jumeau qui meurt avant même d’avoir vécu :
De cet étonné d’être là
il avait sept mois et demi
(Ah ce mois et demi me manque
Je suis l’homme d’un courant d’air
[…] qui se noyait dans la cuvette
il pesait moins de trois kilos
il était condamné à mort
au reste l’est-il pas toujours
comme mort son frère jumeau
avant même d’avoir vécu
dont sa mère garde le souvenir d’un beau bébé, tandis que Georges Perros dit avoir adopté dès sa naissance « ce physique de chat de gouttière ». S’il affirme ne pas regretter ce frère fugitif qu’il imagine volontiers studieux, réalisant la brillante carrière dans les Ponts et Chaussées que son père avait espérée pour lui, il se rêve « une sœur quasi parfaite, qui eût été [s]on bâton de jeunesse, [s]on épaule familière, [s]on plus chaud regard, [s]a jalousie ; […] une sœur obscurément anarchiste, et ne retenant ses impulsions que pour calmer son grand frère un peu fou. »
Pourtant, Georges Perros restera hanté toute sa vie par ce drame initial du jumeau disparu, dont il pense avoir pris la place. Ce mal-être qui nourrira toute son œuvre, ne serait-il pas inhérent au sentiment d’être un « usurpateur » ?
Sensation, désagréable, d’être vivant comme un intrus. D’occuper le terrain à la place d’un autre, que j’aurais tué.
Il ne cessera de se chercher un frère élu, qui sera tour à tour Gérard Philipe, Gilbert Minazzoli ou Michel Butor…
Portant en lui un jumeau mort-né il a conçu une synthèse une troisième personne « il » prenant la place de ce dieu en creux un homme autre en ce lieu Douarnenez dont on dit qu’il signifie en breton terre de l’île de l’«il » mais aussi île d’être île de la terre.
Il connaît une enfance chétive et douillette d’enfant unique dans le quartier des Batignolles, entre la Plaine Monceau et la Butte Montmartre, quartier dont il conservera toujours une pointe d’accent de titi parigot. Sa mère qui avait rêvé d’une fille, s’ingéniait à lui friser les cheveux, à lui mettre des barrettes et à l’habiller de mignons costumes velours, et d’aller ainsi « chaque jour exhiber sa chère créature au parc Monceau », où il jouait « au défunt cerceau » entre deux rangs de gouvernantes étrangères.
Il passe ses vacances dans le pays maternel, à Courrières où les corons lui font forte et durable impression, « vésuves d’une triste terre ». Son grand-père l’emmène sur son cheval, dans les champs où le blé est bleu car « tout a la couleur du ciel / quand notre œil est en nouveauté ». De retour à Paris, il va souvent à Belleville retrouver son grand-père paternel qui dans un quartier à bougnats et petits bistrots, a son atelier où il travaille, en blouse blanche, la porcelaine, et dont il pense avoir hérité « ce goût de la bohème / qui saute une génération ». Il partage avec ses parents une mansarde comprenant une grande pièce et une minuscule cuisine, tandis que dans le couloir étincelait un poignard ramené du Cameroun par un oncle. Paris lui est ville de province, où l’on « peut passer sa jeunesse / dans trois rues qui se jouent du coude / sans savoir qu’à deux pas de là / le monde entier refait ses comptes ». De fait, Georges Perros n’aura connu du grand Paris, pendant ses dix premières années, que son petit quartier quotidien qui s’arrêtait à l’angle de la rue Legendre où il allait à l’école. Sans doute est-ce une des raisons pour lesquelles, bien des années plus tard, il décidera de quitter cette ville dont l’inlassable complexité lui est devenue étrangère et invivable, tant elle est éloignée de ce côté provincial qui lui était cher et qu’il aimait retrouver, reconnaître dans l’œuvre de ce merveilleux « piéton de Paris » que fut Henri Calet.
Enfant chétif, il est souvent le souffre-douleur de sa classe, réalité qu’illustre une anecdote récurrente :
Je me souviendrai toute ma vie, sinon toute ma mort, d’une récréation à l’école de mon quartier. […] Trois de mes collègues de classe m’avaient coincé et déshabillé. Et de tirer et de chewingumer mon petit Jésus. Pourquoi ? Je n’étais pas le chouchou de l’instituteur. J’avais plutôt envie d’être aimé que d’être détesté. […] Mais il faut croire qu’on me sentait à la fois très faible et très agressif.
Cette enfance « tout à fait banale » faite d’angles, de bruits et d’odeurs, Georges Perros tentera de la rétablir, de la retrouver – de la recréer aussi – quand bien même la psychanalyse n’y pourrait trouver grand-chose à prendre :
Il me semble que ce qui donne à cette écriture – prose ou poésie – bien au-delà de sa force corrosive, de son mouvement de constante remise en question des valeurs, du penser facile, son cœur tragique protégé par la rapidité, les sarcasmes ou le ton familier, c’est la lutte de l’enfant toujours présent, pour le droit d’être ce qu’il est, c’est-à-dire vivant…