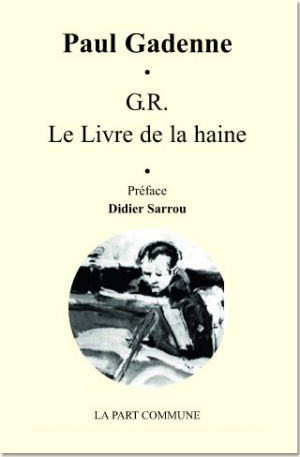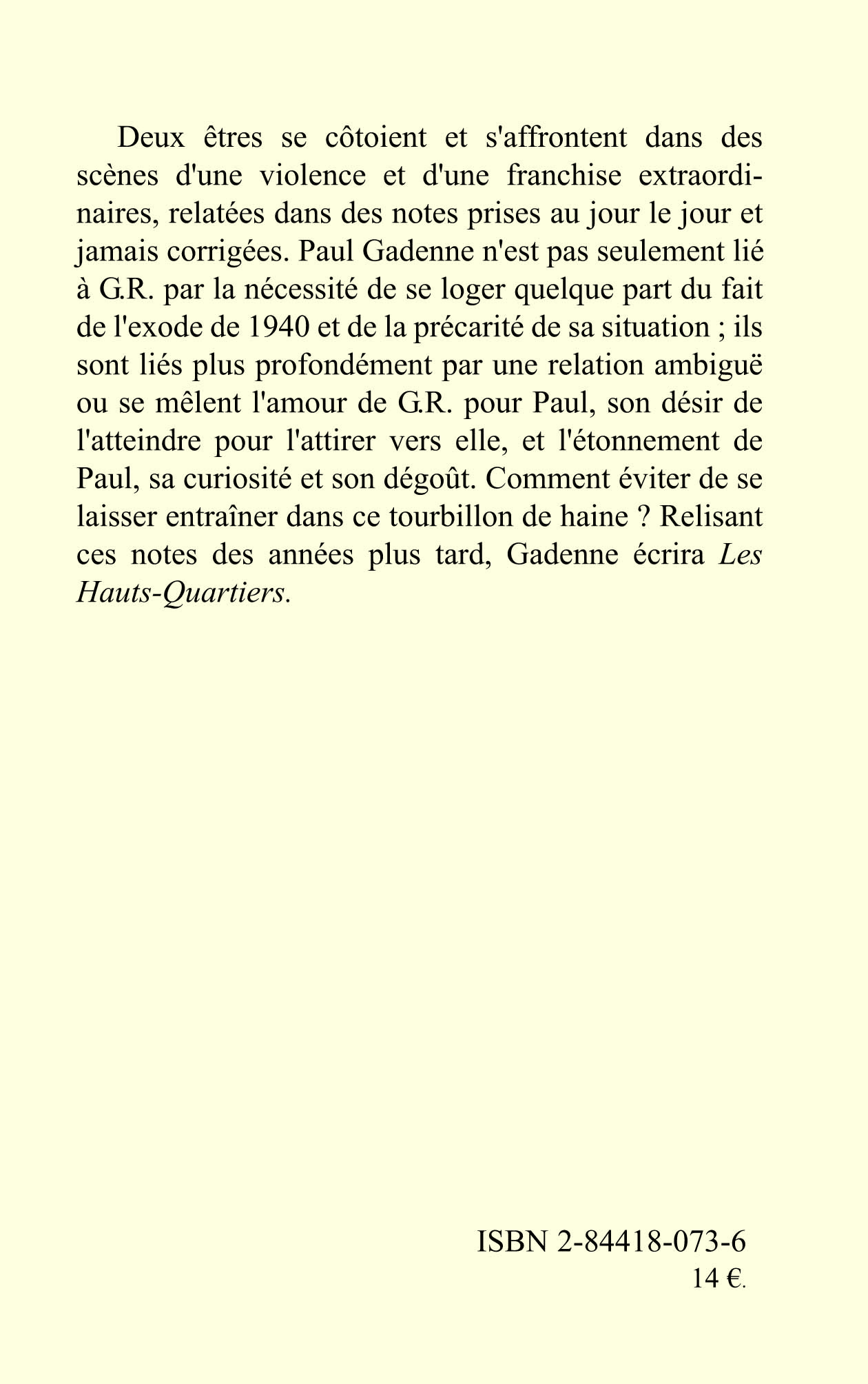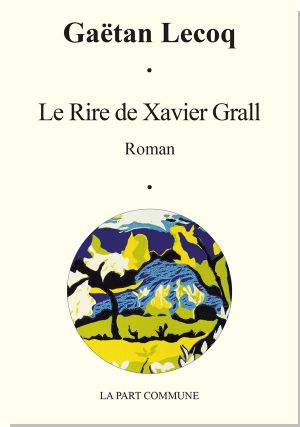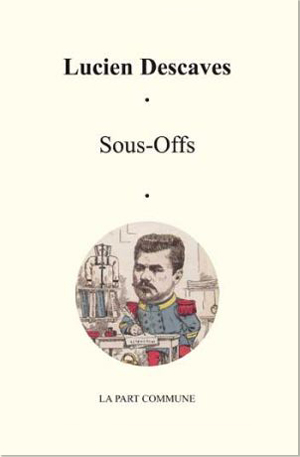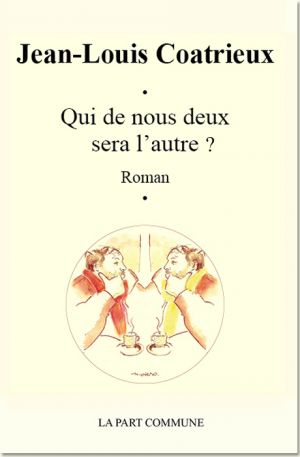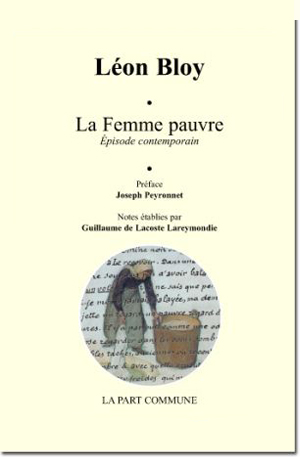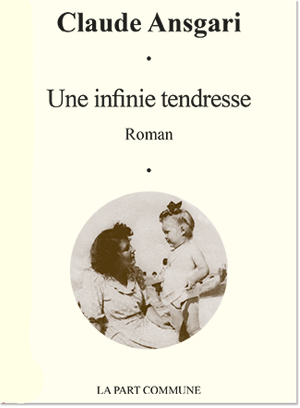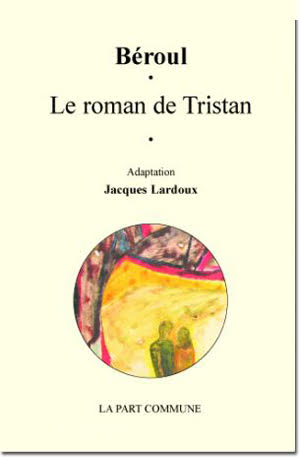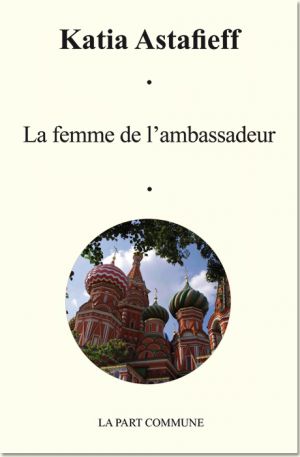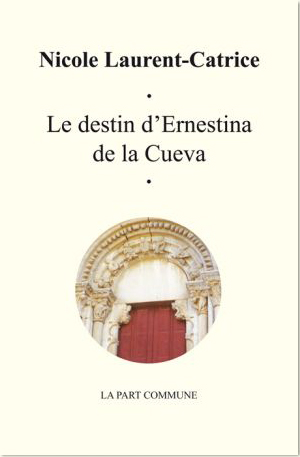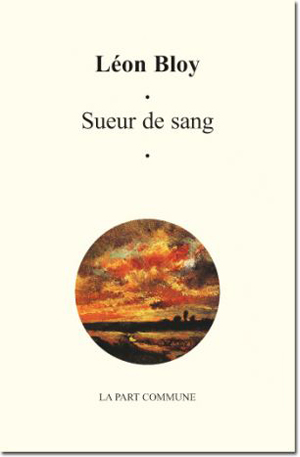C’est curieux comme elle (G.R.) fait penser à Massube.
Hier assise près de moi dans le fauteuil elle me reproche pour la millième fois de « flirter » avec Mlle J.
– Comment ? lui dis-je. Qu’appelez-vous flirter ?
– Vous avez une façon de vous comporter avec elle… des regards.
– Des regards ?
– Oui des regards… On dirait une limace.
Stupeur. Silence.
– Un regard qui lèche… dit-elle après une seconde d’hésitation. C’est affreux.
Avant-hier, au moment où nous partions pour Biarritz, G.R. arrive en disant que les Allemands sont là, et qu’il ne faut pas sortir. Il pleuvait à verse. Nous sortons et S.J. me prend par le bras. Atmosphère lugubre. Nous faisons quelques achats à la petite épicerie et allons chez elle. Au retour, étant sur la route, j’aperçois G.R. à la fenêtre. Je suis surpris d’apprendre en rentrant qu’elle s’est retirée dans sa chambre avec une « forte migraine » (ceci pour ne pas nous voir : quand elle a vu que je revenais avec S., elle a dit à ma sœur : Je ne paraîtrai pas au repas). Un peu plus tard je la trouve dans la chambre de ma sœur, par terre sur un édredon. Elle me dit : « Que voulez-vous, je n’ai plus de chambre. » C’est ridicule. Je l’emmène sur mon lit et vais dîner. J’évite d’aller la voir pendant le repas, parce que je sais qu’il y aurait une scène. Elle revient quand nous avons fini et va manger à la cuisine. Elle m’expliquera cela plus tard en me disant qu’« il lui a été odieux » de me voir revenir avec S.J.
Plus tard elle donnera toutes sortes de versions de cet épisode, en en parlant à M.-A. en particulier, à qui elle dira : « Mlle J. l’a forcé à sortir sous une pluie d’orage, pour son caprice. » (alors que nous avons rendez-vous à Biarritz à
7 h. et qu’elle, G., est venue me trouver au moment où nous partions en me disant : Les Allemands sont sur la route – ou plutôt en me le laissant entendre par beaucoup de circonlocutions vaines et irritantes, comme : On s’attend à quelque chose, etc. – alors que cette arrivée était prévue depuis trois jours (Elle avait commencé par dire : J’ai aidé à habiller les Polonais). Alors pourquoi avoir parlé tantôt des Allemands, tantôt de la pluie, alors qu’il s’agissait simplement de m’empêcher d’aller à Biarritz avec Mlle J. ? Chose que nous aurions pu très bien faire, car nous sommes revenus de chez S.J. à 8 h. et rien ne s’était produit.
Ceci se passait la veille de la signature de l’armistice avec l’Italie, et c’est dans la nuit, à 4 h., que le feu a cessé sur tout le front.
Je reproche beaucoup à G.R. d’avoir créé de la discorde entre nous en un jour semblable – et j’étais triste le soir en voyant partir S.J. dans cette nuit hostile, au sens le plus étymologique du mot. La voir partir pour cette solitude. G. m’a paru cruelle ce soir-là. C’est le même soir qu’elle lui a dit : « Ne venez pas demain parce que j’ai les Léon. » Ce qui était un comble.
J’ai su depuis qu’elle avait invité les Léon à dessein, pour avoir un prétexte pour éloigner Mlle J. à qui elle avait dit qu’elle n’avait pas assez de vaisselle ! Elle a ajouté : « Ils viendront s’établir ici en permanence parce qu’ils ne veulent pas voir les Allemands. »
Telle fut cette journée du 24, si extraordinaire sous son ciel d’orage. J’attendais toujours M.-A. et ses enfants, mais elle ne vient pas.
Le soir G. vient sur mon lit et me fait une scène. Cela dure jusqu’à minuit.
Nous avions dit : « Mardi nous sortirons » Mais la veille au soir en revenant, S.J. me dit dans le sentier : « Dieu sait si nous nous reverrons jamais ! » et nous envisagions la perspective d’être bloqués chacun de notre côté.
Mais le mardi on apprit que l’armistice était signé et que tout était fini.
Aussi j’allai la rejoindre l’après-midi à 7 h. sous un beau ciel, et nous cueillîmes des hortensias dans le jardin. Puis nous fîmes le thé. Je la laissai le soir et revins seul.
Mercredi matin S. vient travailler. G. m’appelle dans la matinée dans la cuisine pour me dire qu’elle ne désirait pas que Mlle J. restât à déjeuner. Il n’en était pas question, mais il me fut désagréable de lui faire cette « commission » et je vis que S. était triste. Le repas fut morne. Le fait qu’Andrée* était mêlée à toutes ces histoires médiocres m’était très désagréable.
S. était sur le point de partir lorsqu’Andrée vient nous dire que Colette* est tombée en sortant d’une épicerie et qu’un soldat a dû la ramener sur le dos. Elle est étendue sur le petit lit de la chambre où travaillait S., très pâle, le visage crispé, et de temps en temps la douleur lui arrache un cri, une larme. Un médecin militaire vient pendant que je fais ma toilette. Mais pendant qu’il est là je n’entends que la voix de Mlle R. Quand le médecin part cela recommence. J’entends cette phrase : « Puisque le médecin a dit que tu ne devais pas avoir mal, c’est que tu ne dois pas avoir mal. » Puis elle claque les portes.
(Début : L’enfant glisse sur une peau de banane en descendant les marches de l’épicerie, etc.)
J’entre et je vois S. penchée sur Colette et encadrant le petit visage de ses mains. Elle regarde Colette quelques secondes au fond des yeux, et Colette s’endort. « Comment avez-vous fait ? demande Andrée à S. Quelle recette avez-vous pour endormir la douleur des enfants ? »
Je dis qu’il faut aller tout de suite à l’hôpital pour faire une radio dès le début de l’après-midi. Je sens que G.R. brûle du désir d’y accompagner Andrée, par pure curiosité (une petite partie de campagne, en somme). Je pense qu’Andrée sera peut-être mieux avec moi dans ces conditions. à 2 h. nous allons à l’hôpital, mais G. veut à tout prix sortir avec nous. Heureusement elle nous quitte en route.
Nous laissons Colette à l’hôpital. Je vais téléphoner à Michel et reviens à 6 h. M.-A. est là depuis une heure (je dis ce qu’il en est. G.R. me prend le bras d’une manière grotesque et me fait presque tomber dans le fauteuil), livrée sans défense aux entreprises verbales de G.R. – qui, je le saurai plus tard, en a largement profité. Etrangement profité !
M.-A. me dit qu’elle fera une enquête sur les deux chirurgiens possibles, dont l’un est son cousin, puis je vais chez S.J. qui téléphone à Claire Lataste et à sa sœur Marie.
Le soir à 10 h., je suis dans le fauteuil un peu accablé par cette journée. G. se précipite tout à coup à mes pieds en me disant : « Vraiment vous supportez si mal ce différend entre Mlle J. et moi ? » Heureusement je suis dispensé de lui répondre car j’entends une voix qui m’appelle au dehors. C’est S.J. Elle a tout arrangé. Le Dr Lataste viendra demain voir Lafourcade et l’on transportera Colette à la clinique. Nous conversons sur la route. S. me dit que c’est peut-être plus grave qu’on ne pense.
Comme je dis ce matin que le ciel est trop bleu parce que les hommes sont trop méchants, G. me cite la Genèse (sur la faute). Elle prétend que Saint Paul dit que la nature a participé à la chute, et qu’elle n’a plus son rayonnement ni son innocence d’autrefois, pour me prouver que ça doit être comme ça. Et je sens qu’elle est bien déterminée à ce que ce soit de plus en plus comme ça. C’est ce qui est horrible, cette approbation qu’elle donne toujours au mal qu’elle fait…