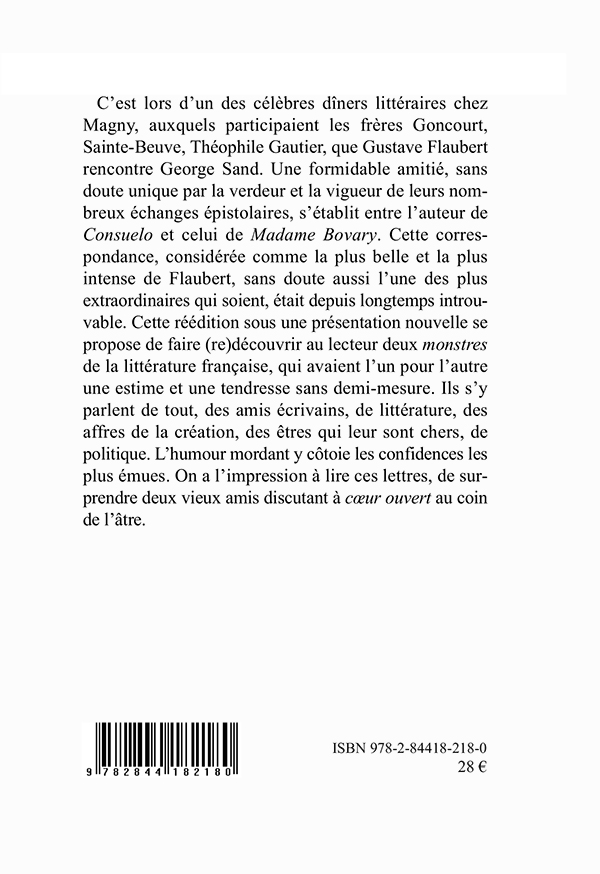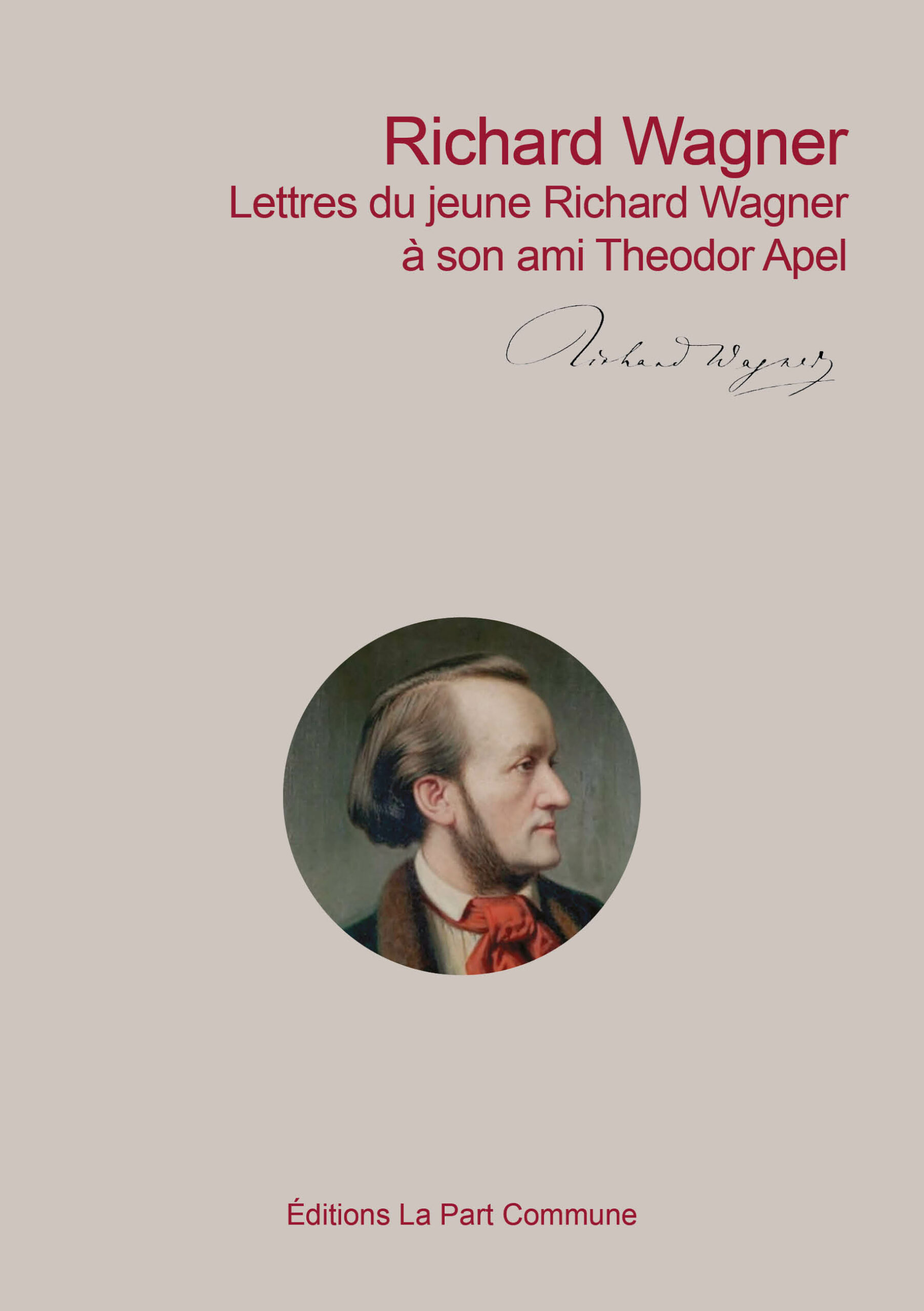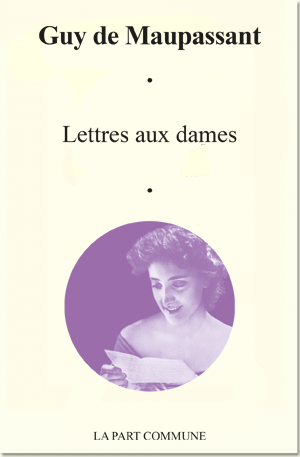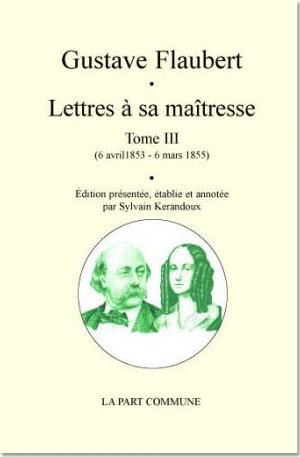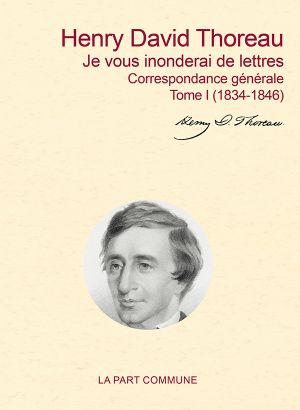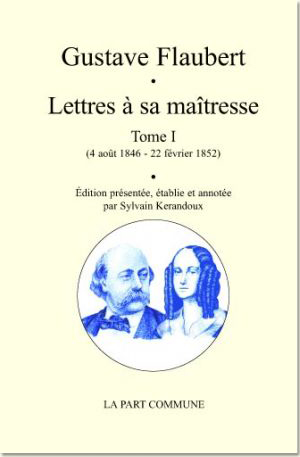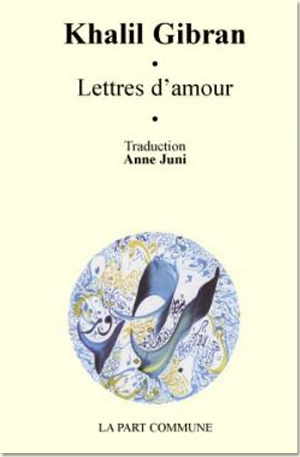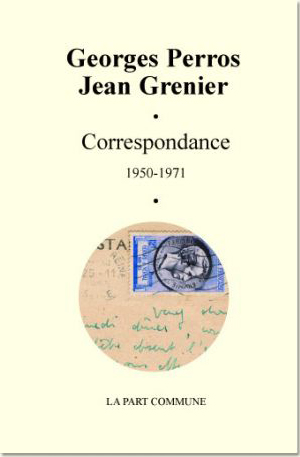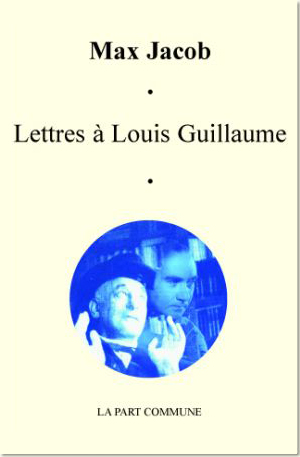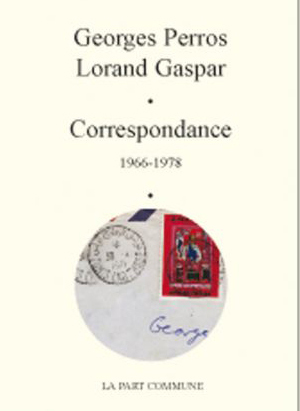Nohant, 28 janvier [18]63
Mon cher frère,
Il ne faut pas me savoir gré d’avoir rempli un devoir. Toutes les fois que la critique fera le sien je me tairai, parce que j’aime mieux produire que juger. Mais tout ce que j’avais lu sur Salammbô avant de lire Salammbô était injuste ou insuffisant. J’aurais regardé le silence comme une lâcheté, ou comme une paresse, ce qui se ressemble beaucoup. Il m’est indifférent d’avoir à ajouter vos adversaires aux miens – un peu plus, un peu moins…
J’ai à vous demander pardon d’une critique assez puérile à propos du Défilé de la hache. Si je l’ai laissée c’est qu’une réserve ajoutait à la sincérité de mon admiration.
Nous nous connaissons bien peu. Venez donc me voir quand vous aurez le temps. Ce n’est pas loin, j’y suis toujours, mais je suis âgée, n’attendez pas que je sois en enfance.
Tirez-moi d’intrigue. J’ai reçu en septembre une plante sèche intéressante dans une enveloppe anonyme. C’est votre écriture à ce qu’il me semble aujourd’hui. Mais c’est invraisemblable, d’où sauriez-vous que je m’occupe assez minutieusement de botanique ?
Ce que je garde, moi, de vos remerciements, c’est le ton de l’amitié et cela, je sais que je le mérite.
Tout à vous
G. Sand.
*
Lecture de Salammbô
Oui,mon cher ami, j’aime Salammbô, parce que j’aime les tentatives et parce que… j’aime Salammbô. J’aime qu’un écrivain, lorsqu’il n’est pas forcé par les circonstances ou entraîné par son activité à produire sans relâche, mette des années à faire une étude approfondie d’un sujet difficile, et le mène à bien sans se demander si le succès couronnera ses efforts. Rien n’est moins fait pour caresser les habitudes d’esprit des gens du monde, des gens superficiels, des gens pressés, des insouciants en un mot, c’est-à-dire de la majorité des lecteurs, que le sujet de Salammbô. L’homme qui a conçu et achevé la chose a toutes les aspirations et toutes les ferveurs d’un grand artiste.
En a-t-il de la puissance ? Oui, je trouve ; je ne fais pas métier de juger, mais le droit de trouver, et je dis oui, cela est étrange et magnifique, c’est plein de ténèbres et d’éclats. Ce n’est dans le genre et sous l’influence de personne ; cela n’appartient à aucune école, quoi que vous en disiez. C’est marqué d’un cachet bien déterminé, et cela entre dans une manière qui est toute une personnalité d’une étonnante énergie. Je sens donc là une œuvre complètement originale, et là où elle me surprend et me choque, je ne me reconnais pas le droit de blâmer.
En effet, est-on bien autorisé à étourdir d’avertissements et de conseils un homme qui gravit une montagne inexplorée ? Toute œuvre originale est cette montagne-là. Elle n’a pas de chemin connu. L’audacieux qui s’y aventure cause un peu de stupeur aux timides, un peu de dépit aux habiles, un peu de colère aux ignorants. Ce sont ces derniers qui blâment le plus toutes les hardiesses. Qu’allait-il faire sur cette montagne ? Qui l’y obligeait ? Qu’en rapportera-t-il ? À quoi bon gravir les cimes quand il y a plus bas de la place pour tout le monde, et des chemins de plaine si carrossables ?
Mais quelques-uns pourtant, parmi ces ignorants, aiment ces sommets, et, quand ils n’y peuvent aller, ils aiment ceux qui en reviennent. Je suis de ceux-là, moi. Je n’ai pas gravi l’Himalaya, mais j’ai vu sa tête dans mes rêves, et, loin de blâmer ceux qui l’ont touchée, j’écouterais leurs récits jusqu’à demain matin.
L’Himalaya, ici, c’était quelque chose d’évanoui et de conjectural. Carthage au temps d’Hamilcar ; Carthage, dont on sait à peine l’emplacement aujourd’hui, il fallait la faire revivre jusqu’à la réalité du roman historique ! C’est donc une relation de ce voyage dans le passé qui m’arrive, à moi tranquillement assis dans une petite serre chaude, et cela arrive sous le nom fantastique de Salammbô. Oui-da ! un nom carthaginois ! C’est loin, Carthage ; le passé encore plus. Je suis bien sûr de n’y jamais aller. Le sujet ne peut pas être bien gai, ni bien doux ! Certes, ce n’est pas Boucher qui aurait choisi pour sujet les scènes d’amour de ce temps-là, et l’intérieur de ces personnages ne doit rappeler en rien un tableau de Greuze. Il faut donc que j’oublie Greuze, Boucher et ma petite serre chaude, et que je m’attende à voir des mœurs barbares et des hommes atroces, puisque j’aperçois dans le lointain des dieux Kabyres. Je n’en sais pas bien long, mais je sais qu’il y aura des sacrifices humains, des tortures, des épouvantes, toutes choses qui, adoucies et enjolivées, ne seraient plus ce qu’elles ont dû être. Ce livre-là doit être terrible s’il est bien fait. Le lirai-je ? Je suis aussi libre de ne pas le lire que de n’aller pas à Carthage si je n’ai pas le courage d’y aller. C’est si discret, un livre ! C’est muet, cela dort dans un coin ; cela ne court point après vous. C’est autrement modeste que la musique, qu’il faut entendre, bonne ou mauvaise, et même que le tableau qui flambe ou qui grimace sur la muraille. – Vous voulez absolument le lire ? Donc, vous voulez aller à Carthage… Eh bien ! vous y voilà. Vous ne vous y plaisez guère ? Je le comprends. Vous avez peur, dégoût, vertige, indignation ? Donc, le voyage a été fait. Le narrateur n’a pas menti, et si les cheveux vous dressent à la tête, c’est qu’il est à la hauteur de son sujet, c’est qu’il est de force à vous dépeindre vigoureusement ce qu’il a vu.
Mais vous avez le cœur sucré, comme disent nos paysans d’ici. Il vous fallait du bonbon et on vous a donné du piment. Vous pouviez rester à votre ordinaire : que diable alliez-vous faire à Carthage ?
J’ai voulu y aller, moi, je ne me plains de rien. Je me suis embarqué de ma petite serre chaude dans le cerveau de l’auteur. C’est aussi facile que d’aller dans la lune avec le ballon de la fantaisie ; mais, en raison de cette grande facilité et de cette certitude d’arriver en un clin d’œil, je ne me suis pas mis en route sans faire mes réflexions et sans me préparer à de grands étonnements, à de grandes émotions peut-être. J’en ai eu pour mon argent, comme on dit, et maintenant, je pense comme tous ceux qui descendent les hautes cimes : je me dis que je ne voudrais pas retourner y finir mes jours, mais que je suis fort aise d’y avoir été.
C’était monstrueux, cette Babylone africaine, ce monde punique, atroce, ce grand Hamilcar, un scélérat, ce culte, ces temples, ces batailles, ces supplices, ces vengeances, ces festins, ces trahisons ; tout cela, poésie de cannibales, quelque chose comme l’enfer de Dante.
À propos, mon cher ami, vous avez fait ce voyage-là ? Qu’est-ce que vous en dites, de l’enfer du Dante ? Il paraît que la chose a quelque valeur et n’a pas manqué d’un certain succès dans son temps, puisque cela dure encore ? Le sujet n’est pas joli, cependant, et le poëte ne sacrifiait point aux Grâces. Dites-moi que c’est un paltoquet et n’en parlons plus. Je vous pardonnerai de proscrire Salammbô.
Moi, je ne sais pas si l’on ne peut pas comparer. La forme de Flaubert est aussi belle, aussi frappante, aussi concise, aussi grandiose dans sa prose française que n’importe quels beaux vers connus en quelque langue que ce soit. Son imagination est aussi féconde, sa peinture est aussi terrible que celle du Dante. Sa colère intérieure est aussi froide de parti pris. Il n’épargne pas davantage les délicatesses du spectateur, parce qu’il ne veut point farder l’horreur de sa vision. Il est formidable comme l’abîme.
Mais vous me dites : Ce n’est point là l’histoire telle que je la connaissais. Ce monde atroce n’a jamais existé. Cette couleur est forcée. L’homme n’a pas été si puissant pour le mal.
Hélas ! quant au dernier point, je crois que vous vous trompez bien, et qu’il est dans la fatalité de tous les cultes d’engendrer les forfaits. Sans remonter jusqu’aux dieux Kabyres, la douce loi du Christ n’a-t-elle pas enfanté l’inquisition et la Saint-Barthélemy ?
Quant à la couleur locale, il est d’usage de la recomposer par les forces de la logique d’induction. C’est avec des fragments incomplets que la paléontologie a reconstruit des mondes plus anciens que le monde punique. Ceci exige de grandes études que tout le monde n’est pas en état de vérifier, et ni vous ni moi ne pouvons nous permettre de dire que l’auteur de Salammbô a forcé ou atténué sa peinture. Il nous faudrait peut-être, à nous comme à lui, une dizaine d’années consacrées à en étudier l’objet et les moyens.
D’ailleurs, cette vérification n’a rien à faire avec la question d’art. Est-ce de la belle et bonne peinture ? Voilà ce dont il s’agit et ce que tout le monde est appelé à juger. Je ne crois pas que l’on puisse nier la beauté de la couleur et du dessin. Faut-il vous rappeler qu’on peut, comme les maîtres espagnols, faire de la peinture admirable avec des sujets atroces ?
Elle est un peu chatoyante, cette peinture, j’en conviens. Toute chose a son défaut, si réussie qu’elle soit. Il y a peut-être trop de lumière répartie avec une égale richesse sur tous les détails. La composition trop brillante devient confuse par moments. L’œil se fatigue, et l’effet général s’obscurcit tout à coup, comme ces paysages africains dont Fromentin a exprimé en peu de mots et d’une manière saisissante, l’intensité de rayonnement produisant la sensation du noir. C’est que, de même que Fromentin se sentit un jour complètement aveugle, Flaubert, regardant son sujet par l’œil de l’imagination, s’est ébloui pour avoir trop vu. Je ne hais pas ces défauts qui sont l’abus d’une force. Défauts, oui, mais excès d’une grande faculté comme tous les défauts des maîtres : défaut du Dante particulièrement.
Quand à l’histoire, vous dites avec raison que le roman doit en conserver l’esprit. Eh bien, l’histoire fait planer sur l’obscurité, sur l’insuffisance de ses détails à l’endroit de ce monde évanoui, deux mots terribles : Culte des dieux Kabyres. – Notoriété proverbiale de la foi punique, synonyme de trahison. En voilà bien assez, selon moi, pour autoriser l’interprétation des choses et des hommes développée dans Salammbô.
Nos souvenirs classiques nous ont laissé dans l’es-prit comme une œuvre de titans, et nous avons vécu d’une notion de force extraordinaire, sans nous demander apparemment à quel prix ces forces d’expansion, de richesse, de commerce, de conquête et de domination étaient achetées dans l’antiquité sur le sol de l’Afrique. L’auteur de Salammbô nous le rappelle, et nous en voilà tout froissés, tout éperdus, comme s’il l’avait inventé ! Si nous sommes partis avec lui pour Carthage, croyant aller à Vaugirard, vous m’avouerez que ce n’est pas sa faute.
On ne doit point se courroucer contre les emportements de la fantaisie, et pourtant, dans Salammbô, il en est un que je regrette. L’épisode est aussi magnifiquement raconté que tous les autres, mais il trahit trop la fantaisie, qui, jusque-là, profondément habile, s’était fait accepter s’était fait accepter comme une réalité victorieuse de toute invraisemblance ; je veux parler du Défilé de la Hache, où nous quittons la couleur de l’histoire pour entrer dans le conte oriental à pleines voiles. Nous avons accepté le siège de Carthage et la rapidité de ces travaux de géants intra et extra muros. Mais ici on nous met aux prises avec la nature, et la nature ne se prête point aux suppositions. Il n’y a pas de sites inaccessibles à quarante mille hommes qui ont tous des armes pour entailler la roche quelle qu’elle soit, des cordes probablement pour leurs chariots, ou tout au moins des animaux dont la peau peut faire des courroies, mille engins pour fabriquer des crampons, enfin les simples moyens que quelques pauvres savants, aidés de quelques hardis montagnards, ont employé de tout temps pour escalader les sommets les plus effrayants de la terre, pour descendre ou remonter des abîmes encore vierges de pas humains. Ces quarante mille mercenaires, restes de l’armée qui déployait naguère tant d’audace et de prodigieuse invention pour prendre Carthage, sont démoralisés ici pour les besoins de la cause, car ils le sont au-delà de tout raisonnement. Hamilcar, qui ne daigne pas les écraser d’en haut, qui les sait trop stupides pour se creuser des escaliers dans une paroi quelconque du précipice, devient lui-même complètement fantastique et légendaire. C’est bien dans la couleur du temps où l’on racontait qu’Annibal perçait les roches avec du vinaigre ; mais la géologie ne connaît plus ces roches qu’on ne pouvait entailler ou briser autrement. Il ne s’en fait plus.
La légende est permise, mais l’art du conteur avait été, jusqu’à cette page, de la déguiser admirablement. On pouvait véritablement croire que tout ceci était arrivé. On ne le croit plus dès qu’on est entré dans ce défilé fabuleux ; mais que de qualités grandioses rachètent cet écart poétique ! Quel style sobre et puissant à contenir l’exubérance de l’invention ! Quel savant et persistant procédé pour présenter des images saisissantes avec des mots tout simples, mais dont la netteté d’appropriation ne souffre pas le moindre essai de dérangement et de remplacement pour la critique ! Quels personnages, même les moins montrés, ce procédé magistral vous incruste dans la pensée, éclairés d’un jour ineffaçable ! C’est comme un défi jeté à tous les procédés connus et à toutes les impuissances du langage, car il se sert rarement de la comparaison. Il la dédaigne ; il n’a besoin que du fait même pour en faire jaillir l’impression complète. – Allons, allons, mon ami, cet auteur-là est un malin, comme disent les enfants de Paris, et on le verra à l’œuvre, quoi qu’il fasse !
Janvier 1803.
2. Flaubert à Sand
[Paris, 31 janvier 1863]
Chère Madame,
Je ne vous sais pas gré d’avoir rempli ce que vous appelez un devoir. La bonté de votre cœur m’a attendri et votre sympathie m’a rendu fier. Voilà tout.
Votre lettre que je viens de recevoir ajoute encore à votre article et le dépasse, et je ne sais que vous dire si ce n’est que : je vous aime bien franchement.
Mr Aucante me demande pour vous un numéro de L’Opinion nationale. Vous le recevrez en même temps que ceci.
Ce n’est point moi qui vous ai envoyé au mois de septembre une petite fleur dans une enveloppe. Mais ce qu’il y a d’étrange c’est qu’à la même époque j’ai reçu de la même façon une feuille d’arbre.
Quant à votre invitation si cordiale, je ne vous réponds ni oui ni non, en vrai Normand. J’irai peut-être, un jour, vous surprendre, cet été. Car j’ai grande envie de vous voir et de causer avec vous.
Milles [sic] bonnes tendresses. Je vous baise les deux mains et suis tout à vous.
G[usta]ve Flaubert.
Boulev[ard] du Temple, 42, ou Croisset près Rouen.
P.S. Il me serait bien doux d’avoir votre portrait pour l’accrocher à la muraille dans mon cabinet, à la campagne où je passe souvent de longs mois tout seul. La demande est-elle indiscrète ? Sinon, mille remerciements d’avance. Prenez ceux-là avec les autres que je réitère.