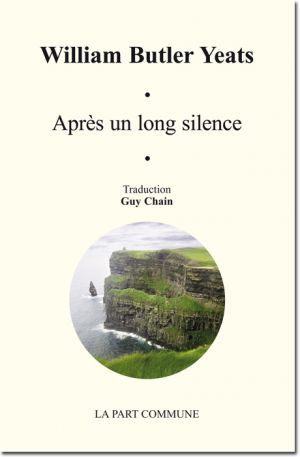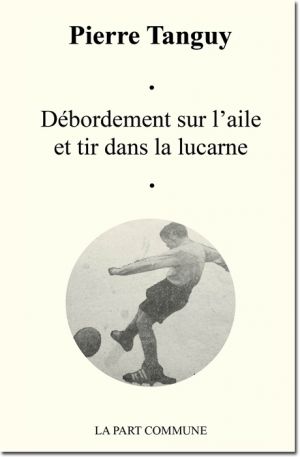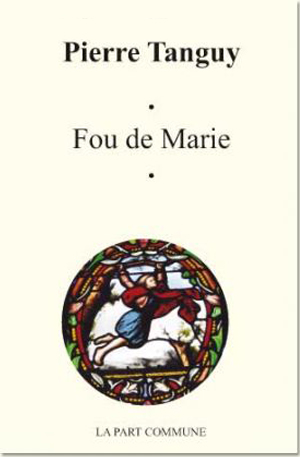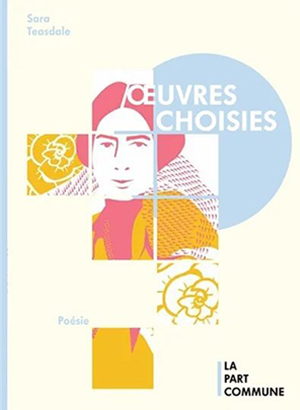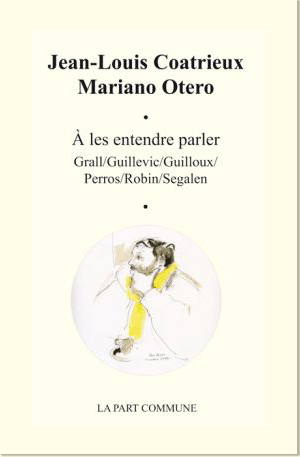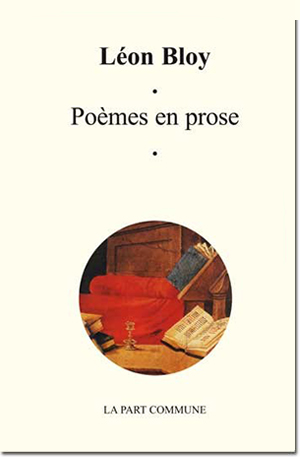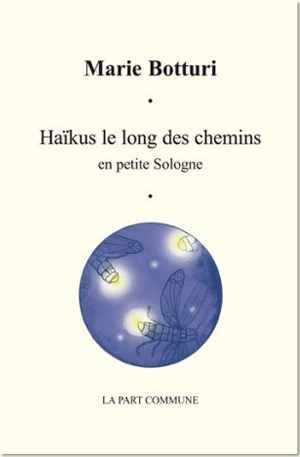LE SYMBOLISME DE LA POÉSIE
I
« Le symbolisme, tel que le voient les écrivains d’aujourd’hui, n’aurait aucune valeur si tous les grands écrivains imaginatifs ne le voyaient aussi, sous tel ou tel déguisement », écrit M. Arthur Symons dans Le mouvement symboliste en littérature, un livre subtil que je ne puis vanter comme je le voudrais, puisqu’il m’est dédié ; il poursuit en montrant comment nombre de profonds écrivains ont, au cours de ces dernières années, recherché une philosophie de la poésie dans la doctrine du symbolisme, et comment aussi, dans des pays où il est pratiquement scandaleux de rechercher la moindre philosophie de la poésie, de nouveaux auteurs les suivent dans leurs recherches. Nous ignorons ce dont parlaient entre eux les écrivains du temps jadis, et une facture, c’est tout ce qui nous reste des propos de Shakespeare, qui était à l’orée des temps modernes ; le journaliste est convaincu, semble-t-il, qu’ils parlaient de vin, de femmes et de politique, mais jamais de leur art ou, en tous les cas, jamais sérieusement de leur art. Il est sûr et certain que celui qui possédait une philosophie de son art ou une théorie sur la façon dont il devait écrire, n’a jamais créé une œuvre d’art, que ceux qui n’écrivent pas sans réfléchir en amont et en aval, comme lui-même rédige ses propres articles, n’ont aucune imagination. Il dit tout cela avec enthousiasme, parce qu’il en a entendu parler dans bien des dîners en ville, où tel ou tel a parlé, par inadvertance ou excès de zèle, d’un livre dont la difficulté offensait l’indolence, ou bien d’un homme qui n’avait pas oublié que la beauté est une accusation. Ces formules à l’emporte-pièce et ces généralisations, dans lesquelles un sergent s’est caché pour mettre bon ordre dans les idées des journalistes et, à travers elles, celles de tous à l’exception du monde moderne, ont créé à leur tour une forme d’oubli semblable à celle qui touche les soldats au combat, tant et si bien que les journalistes et leurs lecteurs ont oublié, entre autres, que Wagner avait consacré sept ans à ordonner et expliquer ses idées avant de commencer à composer cette musique qui lui est propre ; que l’opéra et, avec lui, la musique moderne sont nés de certaines conversations dans la demeure d’un certain Giovanni Bardi à Florence, et que la Pléiade a posé les fondations de la littérature française moderne grâce à un pamphlet. Goethe a déclaré qu' »un poète a besoin de toute la philosophie, mais qu’il doit l’écarter de son œuvre », bien que cela ne soit pas toujours nécessaire ; il ne peut pas savoir grand-chose aussi bien à propos de son œuvre que des eaux procréatrices de l’âme où est né le souffle ou des eaux souterraines qui constituent la vie des choses éphémères. Et il est pratiquement certain que, hors des frontières de l’Angleterre, où les journalistes sont plus puissants et où les idées sont moins abondantes qu’ailleurs, aucun grand art n’a fait son apparition sans aller de pair avec une grande critique qui en soit le chantre, l’interprète ou le protecteur ; c’est pour cette raison que le grand art, à présent que la vulgarité s’est armée et démultipliée, est sans doute mort en Angleterre.
Les écrivains et les artistes de toutes sortes, pour peu qu’ils aient eu un quelconque pouvoir philosophique ou critique, ou ne serait-ce même que parce qu’ils ont été des artistes réfléchis, possèdent une philosophie et une critique de leur art. Bien souvent, c’est cette philosophie ou cette critique qui a constitué leur meilleure source d’inspiration, qui a fait venir en plein jour un peu de vie divine et de la réalité enfouie, qui seules pouvaient faire taire dans les émotions ce que leur philosophie ou leur critique pouvait faire taire dans l’intelligence. Ils n’ont sans doute rien cherché d’autre de nouveau que de comprendre et copier l’imagination pure des premiers temps, mais parce que la vie divine livre bataille à notre vie extérieure et a besoin de changer d’armes et de gestes comme nous changeons les nôtres, l’inspiration est venue jusqu’à eux sous des formes belles et édifiantes. Le mouvement scientifique a apporté avec lui toute une littérature, qui tendait toujours à se perdre dans des contingences extérieures de toutes sortes : l’opinion, la déclamation, l’écriture pittoresque, la peinture par les mots ou ce que Mr. Symons a qualifié de tentative « pour construire avec des briques et du mortier à l’intérieur de la couverture d’un livre ». À présent, les écrivains ont commencé à s’arrêter sur les éléments d’évocation et de suggestion, sur ce que nous appelons le symbolisme chez les grands auteurs.
II
Dans « Symbolisme et Peinture », j’ai essayé de décrire les éléments du symbolisme que l’on retrouve dans la peinture et la sculpture, et j’ai un peu décrit le symbolisme en poésie, mais n’ai absolument pas parlé du symbolisme permanent et indéfini qui constitue la matière de tout style.
Il n’est pas de vers d’une beauté plus mélancolique que ceux qui suivent, dont Burns est l’auteur :
La blanche lune se retire derrière les ondes blanches,
Et le Temps se retire avec moi, Ô !
et ces vers sont on ne peut plus symboliques. Retirez-leur la blancheur de la lune et des ondes, dont la relation avec le retrait du Temps est trop subtile pour l’intelligence, et vous leur retirez toute leur beauté. Mais quand ils sont tous réunis – la lune, les ondes, la blancheur, le Temps qui se retire et le cri mélancolique – ils suscitent une émotion qu’aucune combinaison de sons, de couleurs et de formes ne saurait évoquer. Nous pouvons parler à son sujet d’écriture métaphorique, mais il est préférable de parler d’écriture symbolique, parce que les métaphores ne sont pas suffisamment profondes pour être émouvantes, quand elles ne sont pas des symboles ; quand elles sont des symboles, elles atteignent à la perfection, parce qu’elles sont ce qu’il y a de plus subtil, exception faite de la pureté du son, et c’est par elle que l’on réussit le mieux à comprendre ce que sont ces symboles. Si l’on commence une rêverie avec l’un de ces beaux vers dont on peut se rappeler, on s’aperçoit qu’ils sont pareils à ceux de Burns. Commençons par ce vers de Blake :
Les poissons folâtrant dans les vagues quand la lune gobe la rosée,
ou bien ces vers de Nashe :
La lumière éclatante a chu des cieux,
Les reines sont mortes, jeunes et belles,
La poussière a refermé les yeux d’Hélène ;
ou encore ces vers de Shakespeare :
Timon a bâti sa demeure éternelle
Sur les grèves de l’onde arrière,
Et qu’une fois le jour la vague turbulente
Viendra la couvrir de sa bouillante écume.
ou alors prenez un vers qui est assez simple, qui tire sa beauté de la place qu’il occupe dans la trame et voyez comme il danse à la lumière des nombreux symboles qui ont donné à l’histoire toute sa beauté, comme la lame d’une épée peut danser à la lumière de tours en flammes.
Tous les sons, toutes les couleurs ou toutes les formes – soit en raison de leur énergie décrétée soit en raison d’une longue association – font naître des émotions indéfinissables quoique précises ou, comme j’aime à le penser, font descendre parmi nous des puissances désincarnées, dont les empreintes qu’elles laissent dans nos cœurs ont reçu de nous le nom d’émotions. Et quand le son, la couleur et la forme entretiennent une relation musicale, une relation de beauté l’un avec l’autre, c’est comme s’ils ne faisaient qu’un son, qu’une seule couleur, qu’une seule forme et faisaient naître une émotion unique bien qu’elle soit composée de tout ce dont chacun d’eux est porteur. Il existe une relation identique entre toutes les parties d’une œuvre d’art, qu’il s’agisse d’une épopée ou d’un chant, et plus elle est parfaite, plus les éléments qui ont convergé pour lui donner cette perfection sont nombreux et différents, et plus l’émotion, la force, le dieu qu’elle convoque parmi nous est puissante. Parce qu’une émotion n’existe ou ne devient perceptible et active parmi nous qu’une fois qu’elle a trouvé son expression, par la couleur, le son, la forme ou les trois à la fois, et parce qu’il n’y a pas deux modulations ou combinaisons de ces éléments qui fassent naître la même émotion, les poètes, les peintres, les musiciens et, dans un moindre degré parce que leurs effets sont passagers, le jour, la nuit, l’ombre et les nuages, ne cessent de faire et défaire l’humanité. En effet, c’est uniquement ces choses-là, qui semblent inutiles ou très faibles, qui ont vraiment de la puissance, et toutes ces choses qui semblent fortes ou utiles – les armées, les rouages, les modes de l’architecture ou du gouvernement, les spéculations de la raison – auraient été un peu différentes si un esprit ne s’était pas abandonné à une émotion, il y a bien longtemps, comme une femme s’abandonne à son amant, et s’il n’avait pas créé entre les sons, les formes, les couleurs ou les trois à la fois une relation musicale, afin que leur émotion puisse vivre dans d’autres esprits. Un court poème lyrique fait naître une émotion et cette émotion en appelle d’autres qui se fondent entre elles pour créer un grand poème épique ; puis, parce qu’elle a toujours besoin d’un corps ou d’un symbole moins délicat, à mesure qu’elle gagne en puissance, elle finit par envahir, avec tout ce qu’elle a recueilli, les instincts aveugles de la vie quotidienne, où elle met en mouvement une énergie à l’intérieur d’autres énergies, de la même manière que l’on voit des anneaux imbriqués les uns dans les autres à l’intérieur du tronc d’un vieil arbre. C’est peut-être ce que voulait dire Arthur O’Shaughnessy quand il a fait dire à ses poètes qu’ils avaient construit Ninive avec leurs soupirs ; je ne suis jamais vraiment certain, quand j’entends parler d’une guerre, d’une agitation religieuse, d’une nouvelle industrie ou de tout ce qui peut remplir les oreilles du monde, que tout cela ne s’est pas produit à cause de l’air qu’un garçon de Thessalie a joué au pipeau. Je me souviens avoir demandé une fois à une voyante d’interroger l’un des dieux qui, croyait-elle, se trouvaient autour d’elle dans leurs corps symboliques, sur ce qui résulterait de l’œuvre charmante quoique éphémère d’un ami, et la forme a répondu : « Le massacre des peuples et la destruction des villes ». J’en viens à me demander si les évènements bruts du monde, qui semblent être la source de toutes nos émotions, ne font pas que réfléchir, comme autant de miroirs, les émotions qui naissent chez les hommes solitaires dans les moments de contemplation poétique, ou bien si l’amour lui-même n’est pas plus qu’une faim animale, n’étaient le poète et son ombre, le prêtre, car à moins de croire que les choses extérieures constituent la réalité, nous devons croire que ce qui est grossier est l’ombre de ce qui est subtil, que les choses sont sages avant de perdre la raison, et secrètes avant de se mettre à crier sur la place du marché. Dans leurs moments de contemplation, les hommes solitaires reçoivent l’élan créatif, suis-je enclin à penser, de la plus bas située des Neuf Hiérarchies, et font et défont ainsi l’humanité, voire le monde lui-même, car « l’œil déformant ne déforme-t-il pas tout ? »
Nos villes sont des fragments recopies de notre poitrine;
Et toutes les Babylones humaines tentent uniquement
De transmettre les grandeurs de son cœur babylonien.