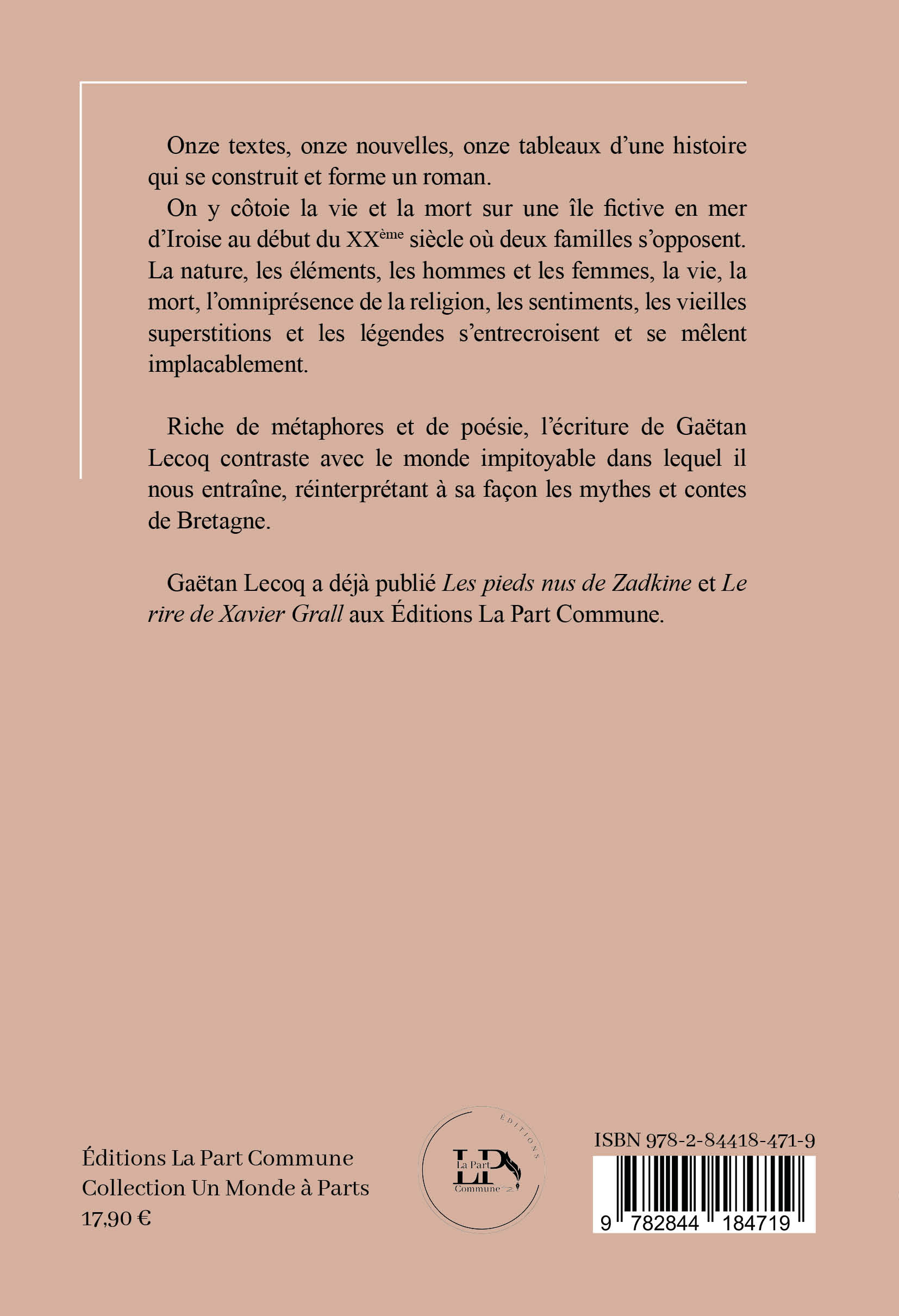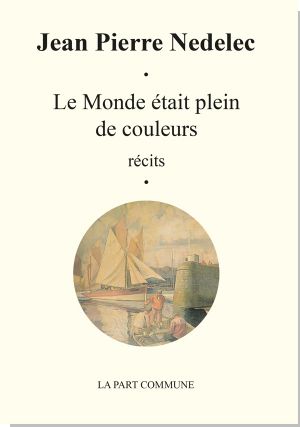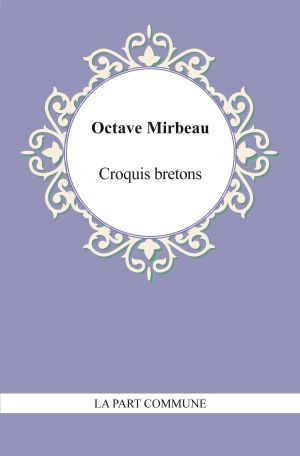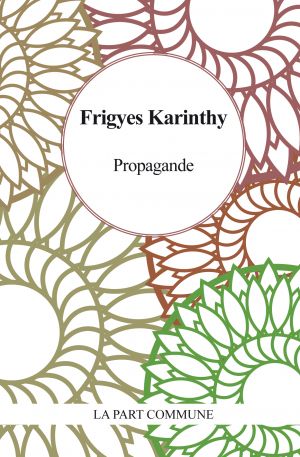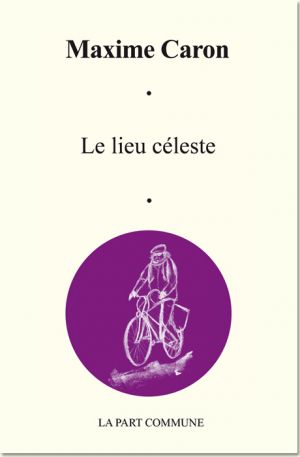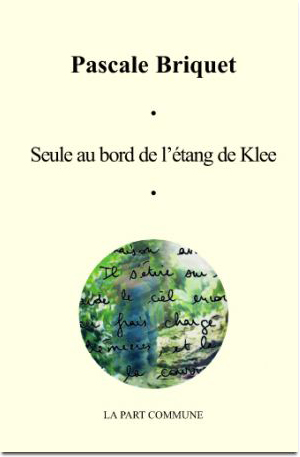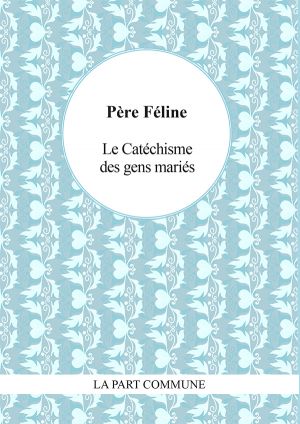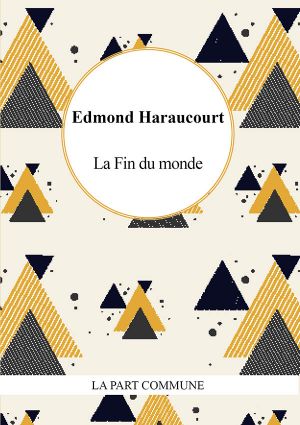L’aurore. L’océan gronde et s’engouffre à grands coups de tête sur la falaise de Kornôg. Nous sommes là, tous les trois, avancés aux deux pointes de l’île de Melenez et sur un îlot des Roches Noires. Prêts à affronter l’ouragan.
Témoins privilégiés de toutes les aventures marines des enfants de l’île, de leurs naufrages, de leurs joies et leurs peines, des caprices du vent sur la lande, de la fureur soudaine de l’océan, nous sommes aussi les veilleurs des matins d’émotion et des soirs glacés. Nous éclairons les chemins têtus qui se cachent entre les murets de pierre, sondons la surface des eaux piégeuses baignant l’île au gré de leurs humeurs. De nos postes, nous observons ce petit monde et voyons tout, connaissant chacune et chacun. Ils sont nos enfants.
La mer veut jouer des coudes, nous attaquer de front ou nous prendre à revers, agacée par les vents d’ouest, les plus fréquents, parfois porteuse de grain ou de tempête, parfois douce comme les agnelles du père Manac’h, mais nous ne craignons rien. Campés sur nos bases, le pied solide, le front haut, nous toisons quiconque s’approche et rien ne peut nous faire fuir ou nous déstabiliser, ne serait-ce d’un millimètre.
Cette nuit, un vent démoniaque s’est levé au loin, à l’ouest, il s’est formé comme une toupie dans le coeur nu de l’océan. Il a soufflé sur les flots, les excitant à mordre nos falaises, à secouer nos certitudes et le granit de notre socle, à courber le front devant sa majesté des ouragans. Nous avons senti le choc, pris des coups à l’estomac, vacillé l’espace d’un instant, mais nous ne sommes pas tombés. Nous tenons, coûte que coûte, pour la sécurité de chacun. Face au vent, nous dressons nos statures imposantes, allumons nos lanternes, guidons les marins dans le brouillard et la tempête. Le temps ne laisse pas de trace sur nous, sinon l’usure des marées, les rides de l’âge, nos visages façonnés par tant et tant d’assauts maritimes. Non, nous ne craignons rien. Nous veillons.
Au petit matin, un nuage opaque tire sa panse aux ras des flots aux abords de notre île où le baromètre s’affole. Chargé d’écume, le vent déboule sur les vagues, les fait frémir, les gonfle d’une sorte d’arrogance océane qui les pousse à s’engouffrer avec voracité entre les rochers. Il forcit avec les heures, fait geindre les failles, tressaillir les ports où, tremblant, les voiliers se font tout petits. Puis, pris d’une rage obscure, il secoue tout sur son passage : arbres, taillis, herbes folles, moutons et vaches, jusqu’au plus frêle des oiseaux, obligé de trouver un trou entre les pierres pour se terrer comme les hérissons et les lapins sauvages. Tel une horde de loups hurlants venue de l’ouest, le vent grossit, furibond, redoutable, noyant la ligne d’horizon entre océan déchaîné et ciel plombé. Aux abords de la Corniche et jusqu’à la pointe du Perron, sur toute la falaise de Kornôg, il se transforme en forcené déboulant bille en tête, attaque les parois rocheuses à grands coups d’épaule, secoue l’île comme s’il voulait la renverser, la forcer, l’envahir. En ouragan sauvage, il claironne aux oreilles des brandes, couche les derniers pins de la lande déjà tordus par des siècles de bourrasques, écrase genêts et ajoncs, s’engouffre dans le moindre interstice des maisons recroquevillées, serrées les unes contre les autres. Le vent mugit en s’insinuant sous les portes, les ardoises du toit ou aux jointures usées des fenêtres. Les poutres grincent, les volets claquent, chacun tremble. Redoublant d’énergie, les éclairs zèbrent à n’en plus finir le ciel de tourbe, illuminent la nuit brûlée et poisseuse où le vent s’affole, tonitrue, vocifère, bouscule jusqu’aux rochers les plus lourds, brise cheminées et ardoises. Quelques pierres volent. Puis, se retenant un court instant, comme pour prendre son élan, il halète et se déchaîne à nouveau. Le voilà qui se jette sur les rares humains qui s’aventurent encore dehors, renverse les chiens qui glapissent et s’enfuient, la queue entre les pattes. La foudre, à cet instant, évite les paratonnerres, s’insinue entre les arbres, scintille et gronde, en une longue crépitation électrique. Après quatre longues secondes suspendues d’un silence d’éther, en fracas rugissant, elle craque au-dessus de la pointe de la Corniche et tente de fracasser notre lanterne. En un instant, l’or et le sang brillent dans la nuit profonde, illuminent la terre et l’océan. Et tout s’éteint, laissant planer une odeur de soufre, de suie et de cuir brûlé. L’espace d’une minute, tout devient lugubre et sinistre, comme si le monde venait de disparaître. Alors nos optiques se rallument, tournent à nouveau sur leur axe, et éclairent comme il se doit tout l’océan et toute l’île. Comme à chaque tempête, nous faisons face, prêts à affronter les vents, la pluie ou la grêle, les traîtres tornades, la roche qui vibre à défaut de céder. Sur Melenez, le temps s’immobilise.
On devait, en ce jour triste, accompagner deux femmes jusqu’à leur demeure dernière. Mais personne ne prépare les convois, aucune chapelle n’allume ses cierges, aucun vicaire n’ose s’aventurer au dehors dans les
tourbillons du vent qui soulèveraient leur soutane, aucune pleureuse ne rejoint la maison des trépassées. Deux destins tragiques, deux femmes emportées dans la fragilité de leur maternité.
Adélie Goulven n’avait pas quarante ans. Usée par cinq grossesses, l’énergie de ses quatre garçons et les pleurs de sa petite Léa qui venait de naître. Fièvre puerpérale, agonie lente, médecin incompétent, voisines prévenantes mais impuissantes. Denez Goulven pleure son Adélie et, hagard, regarde cette petite créature qu’une nourrice appelée en renfort allaite. Comme elle tire sur ce téton ! pense-t-il. Si goulûment ! Elle survivra… Ses fils se chamaillent, se pincent, s’envoient des coups de pieds, tout empesés dans leurs costumes du dimanche, mais leur père ne les entend pas, ne les voit pas, il est ailleurs. Sainte-Blanche est en deuil en cet automne 1904, Sainte-Blanche et tout le sud de l’île qui est du clan Goulven.
Au nord de l’île, dans le village de La Louve, les bateaux du petit port se frottent les uns contre les autres. Ils ont été arrimés bien serrés pour éviter les paquets de mer qui s’engouffrent malgré la jetée bien dérisoire face à la tempête. Derrière les rideaux, Mathurin Kermorvan observe ses barques, vérifie que les amarres tiennent. Il sait que ses bateaux sont fragiles et il a d’autres ambitions que cette pêche côtière si réductrice. On parle de nouveaux bateaux en acier, des chalutiers solides qui remplaceraient à terme tous les bateaux de bois, les dundees de Melenez et les autres cotres, sloops ou barques, comme celles qui se balancent dangereusement sous ses yeux. Mais trêve de rêves ! Dans la petite pièce commune, sur la table familiale, allongée dans un cercueil de bois blanc, Marie-Annig, son épouse, repose, le visage encore bleu, mal camouflé par les soins d’une voisine. Elle s’est pendue avant-hier, dans la sous-pente à l’arrière de la maison. Elle aussi n’a pas résisté à cinq grossesses, ni à la brutalité quotidienne des femmes de marins. Le silence enveloppe les quatre garçons et la fille qu’elle a donné à Mathurin Kermorvan, enfants encore jeunes, tout étonnés de ce qui se passe, cherchant leur père du regard qu’il fuit. Aimé, le fils ainé, du haut de ses dix ans, s’approche du cercueil ouvert et, d’un geste timide, il replace une mèche de cheveux derrière l’oreille de sa maman. Voilà ! murmure-t-il pour lui-même en souriant malgré son chagrin. La Louve est en deuil comme tout le nord de l’île qui est du clan Kermorvan.
Chez nous, beaucoup croient que la mort a son messager. Dans nos contrées, îles ou côtes battues par les flots et même au profond des terres, dans les forêts de pierres et les chemins d’épines, on le nomme l’Ankou. Certains osent en rire, nous traitent d’arriérés, nous moquent, mais quand viennent les soirs de grands vents, quand la mer se déchaîne tellement qu’on ne s’entend plus respirer, l’Ankou traîne sa charrette sur nos sentiers rocailleux. Il guette le souffreteux, le moribond, vient souffler la bougie qui vacille sur le coeur de la grandmère fragile ou chercher l’âme de la petite fille fiévreuse et vomissant. Avec son sourire de cadavre, son chapeau, sa faux immense, il vient frapper aux portes des nouveaux appelés, les saisit aux épaules en un cliquetis d’ossements et son souffle de marbre les pétrifie dans l’instant. Nous l’avons vu errer sur la lande, attendre son heure à l’entrée des villages, avec son haleine de brume, aiguisant sa faux glacée, le grincement de sa charrette comme unique avertissement : Tiens-toi prêt, me voilà, il est temps !
Demain, deux convois iront, chacun de son côté, déposer ces femmes en terre.
A Sainte-Blanche, Adélie aura le grand convoi mortuaire avec corbillard à quatre roues, tiré par deux chevaux noirs, baldaquin orné d’un dais noir à légers galons blancs, franges et tresses noires. La grande croix d’argent de l’église Notre-Dame-d’Iroise sera portée par Lucien, l’aîné des fils Goulven du haut de ses dix ans, et derrière le grand corbillard, marchera le recteur de Melenez en chasuble blanche avec son étole violette, le vicaire de Sainte-Blanche et des enfants de choeur en aube et surplis. Plus loin, la famille, les amis, toute la communauté de l’île suivront. Adélie aura des funérailles très chrétiennes.
A La Louve, Marie-Annig Kermorvan sortira en catimini de son logement sur la charrette à bras d’Abel Caradec, le vieux forgeron, entouré d’un simple drap noir. Il n’y aura pas le faste de Sainte-Blanche, ni même le moindre vicaire, ou une simple croix. Les voisines et les amies serreront quand même dans leurs mains leur chapelet de corail, pour forcer le Seigneur par quelques prières pour cette pauvre suicidée. Les enfants, perdus devant cet impensable départ, suivront en reniflant, soutenant comme ils pourront ce père étrangement tassé sur lui-même, si malheureux, si blessé.
Derrière les croisées, les regards se feront plus appuyés. Dans les cortèges, on se dévisagera, on se comptera, on cherchera des indices. De vieilles rancunes remonteront sans doute à la surface, des souvenirs heureux aussi. On tâchera de comprendre l’inconcevable, on fouinera, on échafaudera de stériles explications qui feront longtemps murmurer au coin du feu dans les maisons basses, alimenteront les soirées trop longues et les rencontres entre deux ruelles où s’élaboreront tant de scénarii à en faire frémir plus d’un.
Depuis tant de temps, nous en avons vu passer des convois mortuaires, nous avons accompagné bien des deuils. Il ne sert à rien de remuer les histoires mal cicatrisées, il y aura toujours des femmes et des hommes qui souffriront, tous logés à la même enseigne. Et puis, un jour, ce sera le tour de celle qui pleurait hier, le lendemain, la mort touchera l’épaule de celui qui souriait sous cape.
En disparaissant, ces deux femmes auraient-elles ouvert la voie à tous les débordements, aux cris, aux larmes, à toutes les haines, autorisant les coeurs écorchés à se libérer de leur retenue naturelle ? Est-ce que, malgré elles ou grâce à elles, se révéleront d’autres sentiers plus secrets : le chemin étroit du pardon, celui de la découverte des autres, du soleil qui tend les bras, des carrefours de rencontre où certains coeurs se remettent à battre, maladroits et sincères ? Leur empreinte imprégnera-t-elle la vie durablement, changera-t-elle d’autres destins ?
Il faudrait parfois entrer au secret des maisons, éclairer les sentiments, les songes, les non-dits parfois, les non-dits surtout. Nous n’avons pas cette fonction, nous n’en avons qu’une bien troublante envie. Exigence de vérité, dirions-nous pour nous défendre de vouloir glisser nos lueurs nocturnes par tous les interstices des chaumières, chaque recoin des chambres, chaque soupir autour d’une table. Recherche d’éclaircissement afin d’illuminer coeurs et âmes, d’ouvrir enfin les portes de la parole. Nous sommes prêts à tout.
En ce jour funeste, à l’heure où le soleil, timide après la tempête, daignera plonger dans la mer, nous rendrons notre hommage lumineux aux deux femmes si tôt disparues. Nommonsles, pour ne pas les oublier : Adélie et Marie-Annig.
Mais nous resterons inquiets pour nos îliens car aujourd’hui, le sang et l’or ont agacé bien des coeurs troubles. Nous voudrions tant percer le brouillard qui noie chaque jour nos côtes, afin de trouver un indice, une piste qui, enfin, tranquilliserait les âmes et les coeurs. Nous n’avons qu’une crainte ou, plutôt, une sorte de pressentiment : malgré notre lumière éclairant l’océan, balayant les nuits de Melenez, le temps ici paraît s’obscurcir. Alors, les années, dans cette ambiance, vont nous paraître terriblement longues.
Des Nouvelles de Melenez
Onze textes, onze nouvelles, onze tableaux d’une histoire qui se construit et forme un roman.
On y côtoie la vie et la mort sur une île fictive en mer d’Iroise au début du XXème siècle où deux familles s’opposent. La nature, les éléments, les hommes et les femmes, la vie, la mort, l’omniprésence de la religion, les sentiments, les vieilles superstitions et les légendes s’entrecroisent et se mêlent implacablement.
Riche de métaphores et de poésie, l’écriture de Gaëtan Lecoq contraste avec le monde impitoyable dans lequel il nous entraîne, réinterprétant à sa façon les mythes et contes de Bretagne.
Gaëtan Lecoq a déjà publié Les pieds nus de Zadkine et Le rire de Xavier Grall aux Éditions La Part Commune.
___________________________________
Format : 14×20,5
Nombre de pages : 140 pages
ISBN : 978-2-84418-471-9
17,90 €