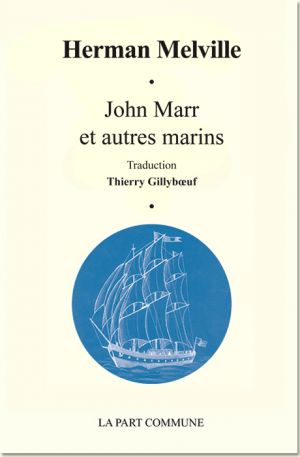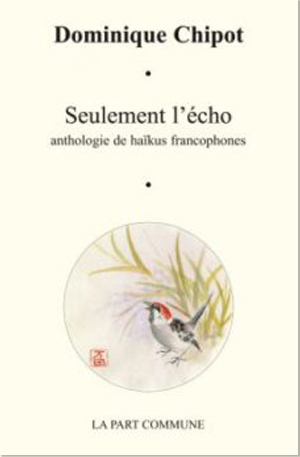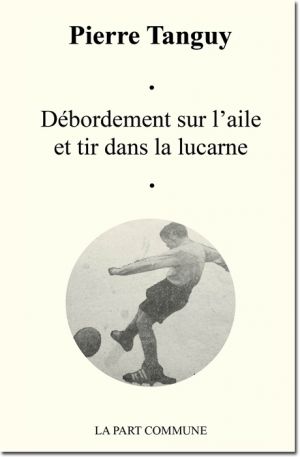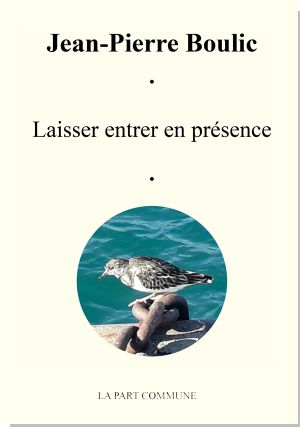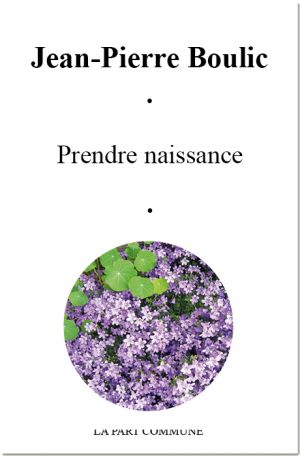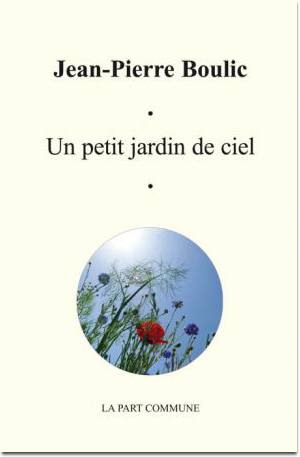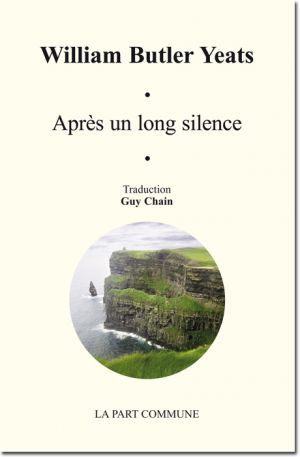À la fin du siècle dernier, John Marr, né en Amérique de mère inconnue, qui avait été marin depuis sa plus tendre enfance jusqu’à l’âge adulte sous différents pavillons, mais qu’une blessure reçue au cours d’un abordage avec des pirates des Keys faisait boiter, a fini par se consacrer à terre à des activités moins mouvementées. Son goût de l’itinérance acquise en mer y débarque avec lui.
Au terme de divers transbordements, tout d’abord comme artisan voilier de port en port, puis après s’être hasardé à l’intérieur des terres comme charpentier, il s’établit, en cette qualité, aux alentours de l’an 1838, sur ce qui était alors une prairie marquant la frontière des territoires de l’Ouest, parsemée çà et là de petits bosquets de chênes et de quelques maisons en rondins plus éparses encore, formant une petite colonie venue tout récemment de nos premiers États de l’intérieur. Ici, mettant un terme à ses itinérances, il se marie.
Peu de temps après, une fièvre, véritable fléau des colonies fraîchement établies sur des terres encore vierges, dont les colons étaient, tôt ou tard, assurés d’endosser la livrée cireuse, emporte sa jeune épouse et son enfant en bas âge. Dans un unique cercueil, assemblé de ses propres mains, ils sont mis en terre au terme d’une cérémonie sommaire – un autre tertre, quoique plus petit, dans l’immense prairie, non loin de ceux qu’avait érigés une race mal connue pour y laisser ses poteries et ses ossements, une seule et même argile, sous une étrange terrasse de forme serpentine.
Avec son air paisible et honnête, son teint hâlé, ses sourcils sombres, ses yeux qui pouvaient s’adoucir ou bien lancer des éclairs, sans jamais se durcir, mais laissaient parfois apparaître une profonde mélancolie, cet homme sans aucun lien d’aucune sorte avait des affections qui, une fois placées, ne pouvaient en être délogées ni portées sur un objet de substitution. Parvenu au mitan de sa vie, il décide de ne jamais quitter le sol qui abrite en son sein les seuls êtres qui lui aient été liés par l’amour familial. Il cède sa maison de rondins à un nouvel arrivant, trop heureux de la recevoir, et s’y installe avec eux.
Bien que le temps émousse l’intensité de son deuil, il continue d’endurer le vide qui s’est fait dans son cœur. S’il le pouvait, il le comblerait en resserrant ses liens avec des gens dont il envisage de partager le sort jusqu’au bout, liens qui viendraient s’ajouter à ceux qui se tissent entre ceux qui travaillent chaque jour ensemble aux champs et finissent tout naturellement par s’entraider. Mais sans que la faute en incombe à qui que ce soit, cela lui est impossible.
Pour que des hommes simples nouent des liens plus familiers, il leur faut s’entretenir de sujets touchant à leur expérience de la vie. Mais qu’il s’agisse de personnes ou de faits, on ne peut pas toujours parler du présent et encore moins spéculer sur le futur ; il faut recourir au passé qui, chez la plupart des hommes, où il constitue la contribution que chacun apporte à un héritage commun, fournit à la plupart des natures pragmatiques les bases d’une communion de sentiments.
Mais le passé de John Marr différait de celui des autres pionniers. Leurs mains s’étaient posées sur les bras de la charrue, les siennes sur la barre du gouvernail. Ils ne connaissaient que leurs semblables et leurs propres us et coutumes ; le monde bigarré lui avait été en partie révélé. Ainsi, inévitablement limités par leur faculté d’entendement et, partant, leur capacité à comprendre autrui, ce groupe d’émigrants sédentaires, laboureurs héréditaires du sol, sut que l’océan, dont ils avaient entendu parler par leurs pères, était devenu pour eux, à présent qu’ils s’étaient enfoncés davantage à l’intérieur des terres, à peine plus qu’une vague rumeur entretenue par la tradition.
C’étaient des gens rassis, rassis par accoutumance à des épreuves monotones, ascétiques par nécessité autant que par prévention morale ; presque tous sincèrement religieux, quoique de façon étriquée. Ils se montraient bons au besoin, à leur manière, mais pour un homme habitué jadis – comme John Marr l’avait immanquablement été lors de ses précédents séjours sans feu ni lieu – aux soirées passées à chanter, fumer et boire dans les arrière-salles de tavernes offrant des plaisirs à bon compte, le temps d’un soir, dans certaines vieilles villes portuaires accueillantes, et encore davantage à la camaraderie en mer des marins de la même bordée, il manquait quelque chose. Ce quelque chose, c’était la bonne humeur, la fleur de la vie jaillie de la joie qui lui est plus ou moins inhérent. Leur sort ne pouvait l’apporter à ces rudes travailleurs accablés par la malaria – ces hommes qui ne connaissaient jamais de répit – et ils étaient trop intègres pour feindre ce qu’ils ne ressentaient pas vraiment – ils n’étaient absolument pas doués pour cela et n’en avaient nulle envie. À l’épluchage du maïs, la moins austère de leurs réunions, le marin au cœur solitaire cherchait à tromper la tristesse de ses propres pensées et, dans une certaine mesure, à distraire les leurs en abordant des sujets éloignés des soucis et des épreuves qu’ils traversaient personnellement ; il se lançait assez naturellement dans une histoire ou une scène maritime, mais se repliait bientôt sur lui et gardait le silence, faute d’encouragements à poursuivre. Une fois, lors d’une de ces réunions, un homme d’un certain âge – un forgeron et un ardent prédicateur lors des assemblées dominicales – lui dit honnêtement : « Mon ami, nous ne connaissons rien à tout cela par ici ».
Une telle insensibilité chez ses semblables qui s’étaient tenus à l’écart de toute vie factice et qui par leur métier – en ces temps où les machines n’offraient guère de secours – se trouvaient, pour ainsi dire, proches parents de la Nature, semblait à John Marr ne faire qu’un avec l’apathie de la Nature elle-même telle qu’elle lui apparaissait ici dans une prairie où personne d’autre que les défunts bâtisseurs de tertres n’avait encore laissé de trace durable.
John Marr et autres marins
Publié en 1888, trois ans avant sa mort, et après douze années de silence, John Marr et autres marins est l’avant-dernier recueil de Herman Melville. Inédit en français dans son intégralité, le recueil mélange deux récits où prose et poésie se répondent, quelques très longs poèmes (parmi les plus longs qu’il ait écrits), et un ensemble de courts poèmes dont il a le secret. Tous tournent, comme le suggère le titre, autour de la mer et constituent, en quelque sorte, le chaînon manquant entre Moby Dick et Billy Budd. Ils se nourrissent de la propre expérience de Melville et font remonter des souvenirs personnels dans des textes aux accents vibrants d’humanité et de déréliction. Car c’est cette fraternité humaine, dont il porte la nostalgie, qu’exalte Melville, par opposition à la nature inhumaine de la mer.
Format : 12 x 17
Nombre de pages : 144 pages
ISBN : 978-2-84418-324-8
Année de parution : 2016
14,00 €
| Poids | 101 g |
|---|---|
| Auteur |
Melville Herman |
| Éditeur |
Collection La Part Classique |