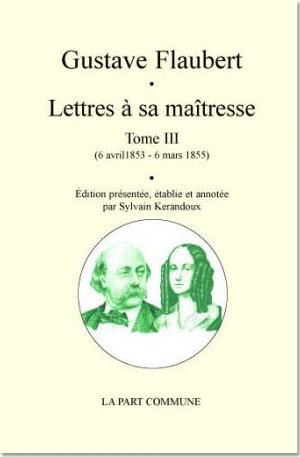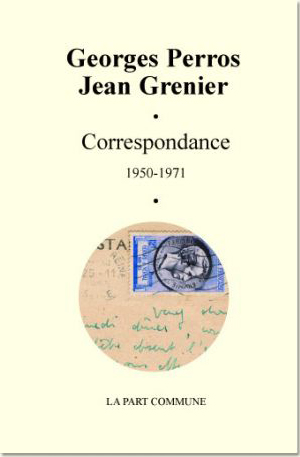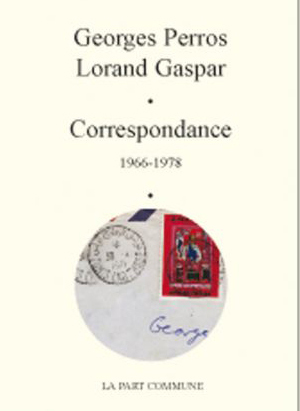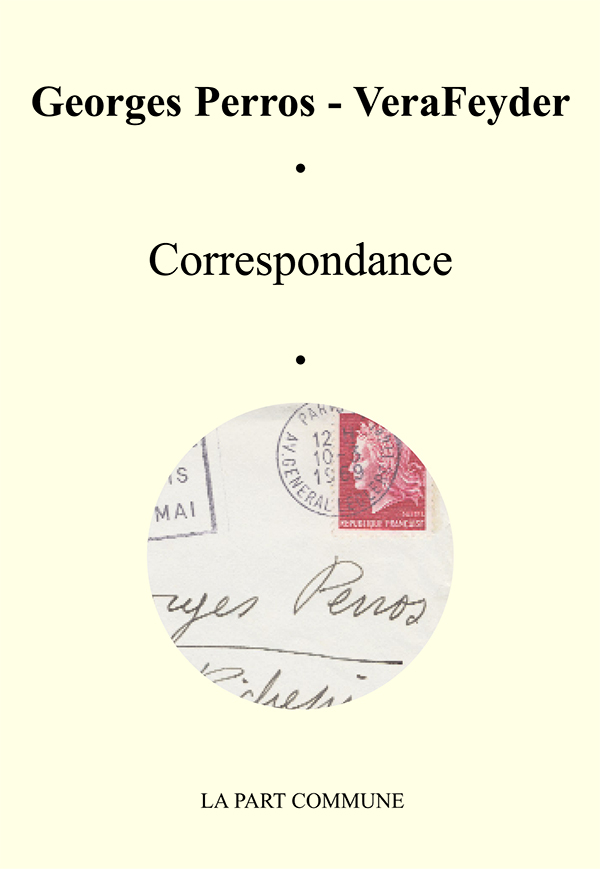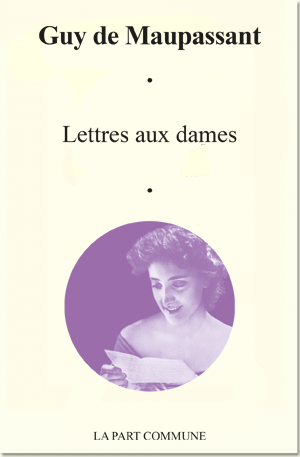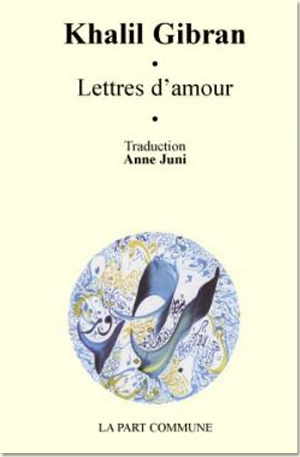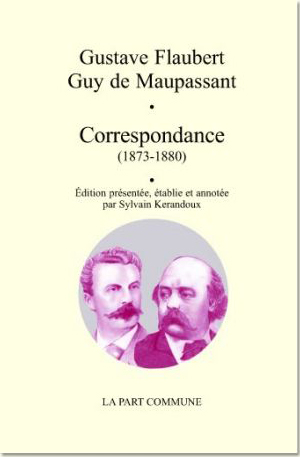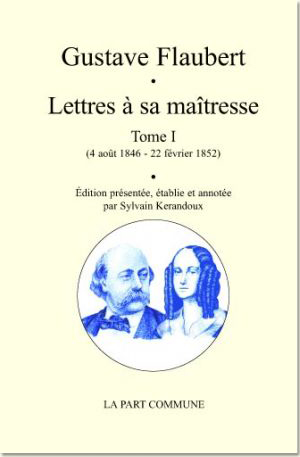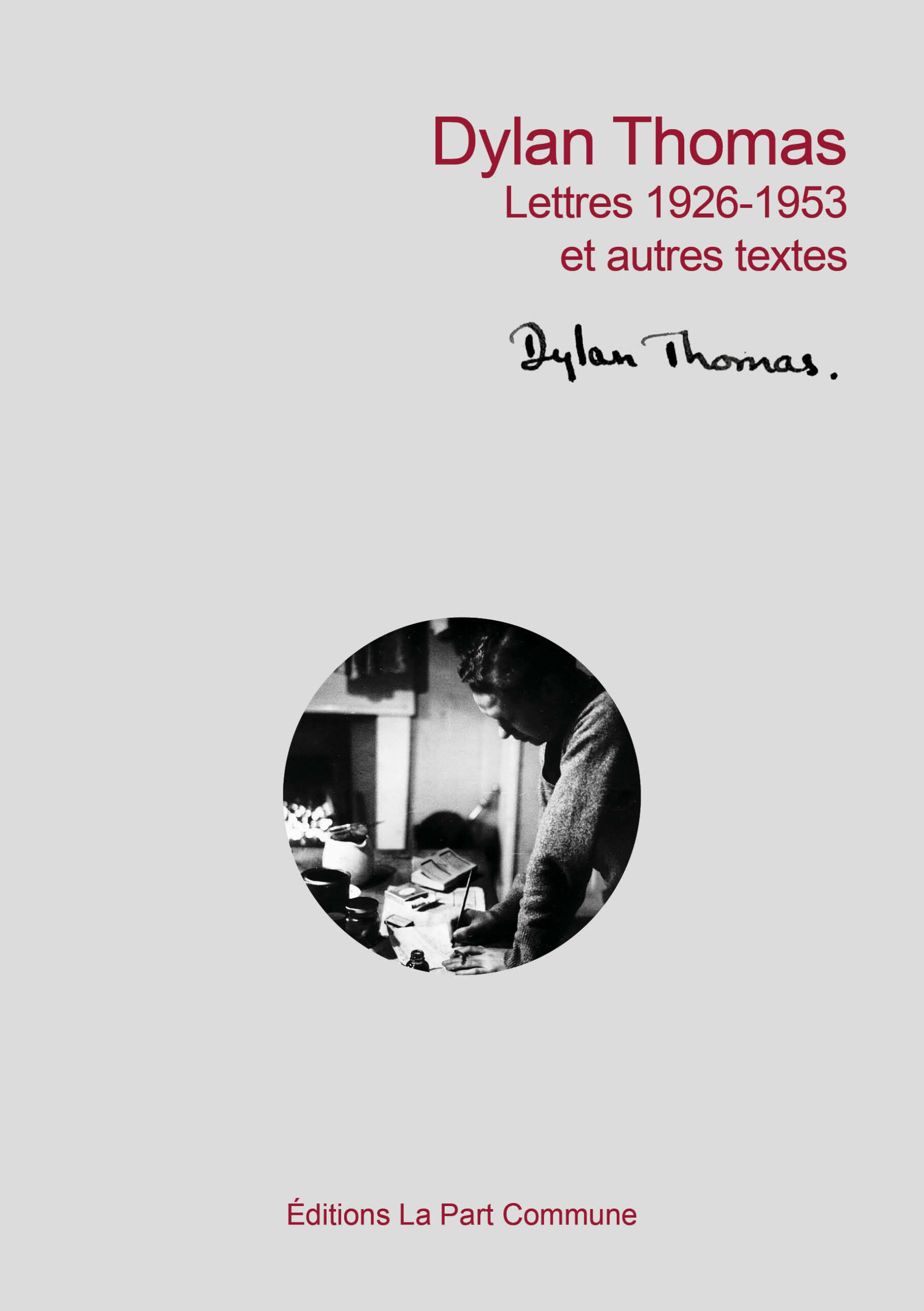Lettre 199
[Croisset] Mercredi soir, minuit [6 avril 1853].
Voilà trois jours que je suis à me vautrer sur tous mes meubles et dans toutes les positions possibles pour trouver quoi dire ! Il y a de cruels moments où le fil casse, où la bobine semble dévidée. Ce soir pourtant, je commence à y voir clair. Mais que de temps perdu ! Comme je vais lentement ! Et qui est-ce qui s’apercevra jamais des profondes combinaisons que m’aura demandées un livre si simple ? Quelle mécanique que le naturel, et comme il faut de ruses pour être vrai ! Sais-tu, chère Muse, depuis le jour de l’an combien j’ai fait de pages ? Trente-neuf. Et depuis que je t’ai quittée ? vingt-deux. Je voudrais bien avoir enfin terminé ce satané mouvement, auquel je suis depuis le mois de septembre, avant que de me déranger (ce sera la fin de la première partie de ma seconde). Il me reste pour cela une quinzaine de pages environ. Ah ! je te désire bien, va, et il me tarde d’être à la conclusion de ce livre, qui pourrait bien à la longue amener la mienne. J’ai envie de te voir souvent, d’être avec toi. Je perds souvent du temps à rêver mon logement de Paris, et la lecture que je t’y ferai de la Bovary, et les soirées que nous passerons. Mais c’est une raison pour continuer, comme je fais, à ne perdre pas une minute et à me hâter avec une ardeur patiente. Ce qui fait que je vais si lentement, c’est que rien dans ce livre n’est tiré de moi ; jamais ma personnalité ne m’aura été plus inutile. Je pourrai peut-être par la suite faire des choses plus fortes (et je l’espère bien), mais il me paraît difficile que j’en compose de plus habiles. Tout est de tête. Si c’est raté, ça m’aura toujours été un bon exercice. Ce qui m’est naturel à moi, c’est le non-naturel pour les autres, l’extraordinaire, le fantastique, la hurlade métaphysique, mythologique. Saint Antoine ne m’a pas demandé le quart de la tension d’esprit que la Bovary me cause. C’était un déversoir ; je n’ai eu que plaisir à écrire, et les dix-huit mois que j’ai passées à en écrire les 500 pages ont été les plus profondément voluptueux de toute ma vie. Juge donc, il faut que j’entre à toute minute dans des peaux qui me sont antipathiques. Voilà six mois que je fais de l’amour platonique, et en ce moment je m’exalte catholiquement au son des cloches, et j’ai envie d’aller en confesse !
Tu me demandes où je logerai. Je n’en sais rien. Je suis là-dessus fort difficile. Cela dépendra tout à fait de l’occasion, de l’appartement. Mais je ne logerai pas plus bas que la rue de Rivoli, ni plus haut que le boulevard. Je tiens à du soleil, à une belle rue et à un escalier large. Je tâcherai de n’être pas loin de toi ni de B[ouilhet], qui part définitivement au mois de septembre. Il fera son drame à Paris ; je ne peux donc à ce sujet te donner aucune réponse nette. Je sais très bien les rues et quartiers dont je ne veux pas, voilà tout. Hier j’ai reçu le Livre Posthume avec cette inscription « Souvenir d’amitié ». Je lui ai de suite répondu un mot pour le remercier en lui disant que, quant à porter un jugement dessus, je m’en abstenais, parce que j’avais peur qu’il ne se méprît sur ma pensée, ne pouvant en quelques lignes lui faire comprendre nettement mon opinion et que le dialogue serait plus commode pour cela. Donc, je lui ai ainsi rendu sa politesse sans me compromettre, ni mentir. S’il veut mon avis, et qu’il me le demande, je le lui donnerai net et sincèrement, je t’en jure bien ma parole ; mais il se gardera de l’aventure.
As-tu lu le dernier numéro de la Revue ? Il y a une note de lui qui vaut cinquante francs, comme dirait Rabelais. La Revue de Paris est comparée au soleil. C’est de la démence ! Et au bas du Livre Posthume, sur la page du titre même : « L’auteur se réserve le droit de traduire cet ouvrage en toutes les langues ». Il y a un article d’Hippolyte Castille sur Guizot, ignoble. Ne sachant comment l’éreinter, il lui reproche d’aller à pied dans les rues de Londres. Il l’appelle marcassin. C’est aussi bête que canaille. Quel joli métier ! Et des vers de M. Nadaud ! Ah ! quelle fange intellectuelle et morale !
J’ai lu Leconte. Eh bien, j’aime beaucoup ce gars-là : il a un grand souffle, c’est un pur. Sa préface aurait demandé cent pages de développement, et je la crois fausse d’intention. Il ne faut pas revenir à l’antiquité, mais prendre ses procédés. Que nous soyons tous des sauvages tatoués depuis Sophocle, cela se peut. Mais il y a autre chose dans l’Art que la rectitude des lignes et le poli des surfaces. La plastique du style n’est pas si large que l’idée entière, je le sais bien. Mais à qui la faute ? À la langue. Nous avons trop de choses et pas assez de formes. De là vient la torture des consciencieux. Il faut pourtant tout accepter et tout imprimer, et prendre surtout son point d’appui dans le présent. C’est pour cela que je crois Les Fossiles de B[ouilhet] une chose très forte. Il marche dans les voies de la poésie de l’avenir. La littérature prendra de plus en plus les allures de la science ; elle sera surtout exposante, ce qui ne veut pas dire didactique. Il faut faire des tableaux, montrer la nature telle qu’elle est, mais des tableaux complets, peindre le dessous et le dessus.
Il y a une belle engueulade aux artistes modernes, dans cette préface et, dans le volume, deux magnifiques pièces (à part des taches) : Dies irae et Midi. Il sait ce que c’est qu’un bon vers ; mais le bon vers est disséminé, le tissu généralement lâche, la composition des pièces peu serrée. Il y a plus d’élévation dans l’esprit que de suite et de profondeur. Il est plus idéaliste que philosophe, plus poète qu’artiste. Mais c’est un vrai poète et de noble race. Ce qui lui manque, c’est d’avoir bien étudié le français, j’entends de connaître à fond les dimensions de son outil et toutes ses ressources. Il n’a pas assez lu de classiques en sa langue. Pas de rapidité ni de netteté, et il lui manque la faculté de faire voir ; le relief est absent, la couleur même a une sorte de teinte grise. Mais de la grandeur ! de la grandeur ! et ce qui vaut mieux que tout, de l’aspiration ! Son hymne védique à Sourya est bien belle. Quel âge a-t-il ?
Lamartine se crève, dit-on. Je ne le pleure pas (je ne connais rien chez lui qui vaille le Midi de Leconte). Non, je n’ai aucune sympathie pour cet écrivain sans rythme, pour cet homme d’État sans initiative. C’est à lui que nous devons tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, et lui que nous devons remercier de l’Empire : homme qui va aux médiocres et qui les aime. B[ouilhet] lui avait envoyé Melaenis à peu près en même temps qu’un de ses élèves, à lui B[ouilhet], lui avait adressé une pièce de vers détestable, stupide (pleine de fautes de prosodie), mais à la louange du susdit grand homme, lequel a répondu au moutard une lettre splendide, tandis qu’à Bouilhet pas un mot. Tu vois pour ton numéro ce qu’il a fait ! Et puis, un homme qui compare Fénelon à Homère, qui n’aime pas les vers de La Fontaine, est jugé comme littérateur. Il ne restera pas de Lamartine de quoi faire un demi-volume de pièces détachées. C’est un esprit eunuque, la couille lui manque, il n’a jamais pissé que de l’eau claire.
Dans mon contentement du vol[ume] de Leconte, j’ai hésité à lui écrire. Cela fait tant de bien de trouver quelqu’un qui aime l’Art et pour l’Art ! Mais je me suis dit : À quoi bon ? On est toujours dupe de tous ces bons mouvements-là. Et puis je ne partage pas entièrement ses idées théoriques, bien que ce soient les miennes, mais exagérées. C’est comme pour le père Hugo, j’ai hésité à lui écrire, à propos de rien, par besoin. Il me semble très beau là-bas. Il m’avait mis son adresse au bout de son petit mot. Était-ce une manière de dire : « Écrivez-moi, ça me flattera » ? Mais cela m’attirerait tant de style pompeux en remerciement que tu me feras seulement le plaisir dans ta lettre de lui dire que je suis tout à son service, etc., qu’il envoie ses lettres à Londres. Je ne suis pas sûr si elle venait de D***. J’ai perdu l’enveloppe, mais je le crois.
Adieu, bonne, chère, tendre et bien-aimée Muse. Mille tendresses, caresses et amour. Je te baise tout le long du corps, bonne nuit.
Ton G.
Comme tu m’as l’air triste ! pauvre chère Muse ; ta lettre m’a navré. Je t’ai suivie dans toutes tes courses et la boue de Paris qui t’a trempé les pieds m’a fait froid au cœur. Quelle amère et grotesque chose que le monde ! Il y a quelques années, quand tu faisais des choses lâchées, molles, tu ne manquais pas d’éditeurs et maintenant que tu viens de faire une œuvre, car La Paysanne en est une, tu ne peux trouver avec, ni argent, ni publication même. Si j’eusse douté je doutais de sa valeur, tous ces déboires-là me confirmeraient encore plus dans l’opinion que c’est bon, excellent. Tu as vu ce que Villemain en a dit : pas une femme n’en serait capable. Ça a en effet un grand caractère de virilité, de force. Sois tranquille, ça fera son trou.
On se moque de toi indignement ; la lettre de Jacottet est menteuse depuis la première ligne jusqu’à la dernière. Quoique je sois peu au fait de la librairie, il me paraît absurde que 700 et quelques vers coûtent à imprimer 400 francs, quand un in-8° n’en coûte guère que 7 à 8 tout au plus. C’est une défaite, et avant que tu ne m’aies exprimé l’opinion de Pagnerre là-dessus, j’avais pensé comme lui. – Bouilhet a beaucoup vanté La Paysanne à M[axime]. Peut-être est-ce un tour pour que tu la leur donnes ? Mais cette supposition est bien cherchée. M[axime] a-t-il une si grande influence sur J[acottet] ? Quels foutus drôles que tous ces gens-là ! – Il paraît que les quais sont chargés de numéros de la R[evue] de P[aris] non coupés et que l’on vend au rabais. Tu as raison, ne donne rien dans cette boutique. Mais puisque tu es bien avec Jourdan et Pelletan, pourquoi ne prendraient-ils pas La Paysanne pour la mettre en feuilleton ? Au reste, à l’heure qu’il est, tu dois avoir conclu avec Perrotin. –
Non, pauvre muse, nous n’avons rien pu du côté du préfet. La seule voie que nous ayons vue, nous l’avons tentée, et le résultat tu le connais. – Mon frère n’est nullement en relation avec lui. Il ne va pas même à ses soirées (où tout le monde va). Quant à connaître quelqu’un au Havre, j’ai beau me retourner ? Néant. Figure-toi, du reste, que je connais bien peu de monde, ayant, depuis 15 ans, fait tout ce que j’ai pu pour laisser tomber dans l’eau toute espèce de relation avec mes compatriotes. – Et j’ai réussi. Beaucoup de Rouennais ignorent parfaitement mon existence. J’ai si bien suivi la maxime d’Épictète « Cache ta vie » que c’est comme si j’étais enterré. La seule chance que j’aie de me faire reconnaître ce sera quand Bovary sera publiée. Et mes compatriotes rugiront, car la couleur normande du livre sera si vraie qu’elle les scandalisera.
J’attends le résultat du concours avec bien de l’impatience.
B[ouilhet] est dans mon cabinet. On cause à mes côtés. Je ne sais pas trop bien ce que je te dis. Mais j’ai voulu t’embrasser de suite. Je vois de là ta pauvre et belle figure si dolente.
Dieu ! que ma B[ovary] m’embête ! J’en arrive à la conviction quelquefois qu’il est impossible d’écrire. J’ai à faire un dialogue de ma petite femme avec un curé. – Dialogue canaille ! et épais. – Et, parce que le fonds est commun, il faut que le langage soit d’autant plus propre. L’idée et les mots me manquent. Je n’ai que le sentiment. B[ouilhet] prétend pourtant que mon plan est bon, mais moi je me sens écrasé. – Après chaque passage, j’espère que le reste ira plus vite et de nouveaux obstacles m’arrivent ! Enfin ça se finira un jour ou l’autre.
Va trouver Mignet. Qu’est-ce que tu risques ?
Adieu, mille baisers. Je t’écrirai au milieu de la semaine. Encore bien des caresses sur le cœur, sur le corps.