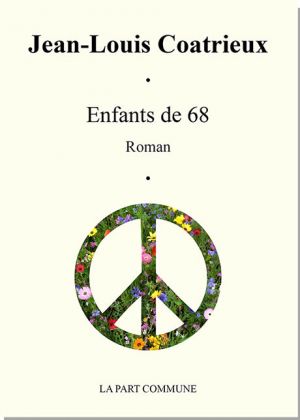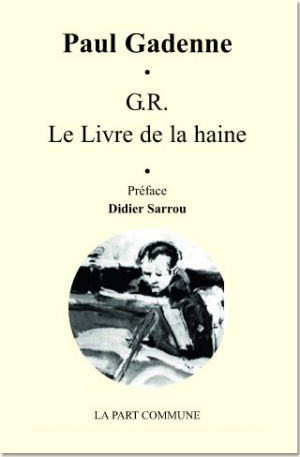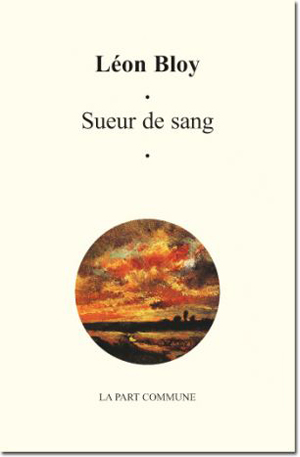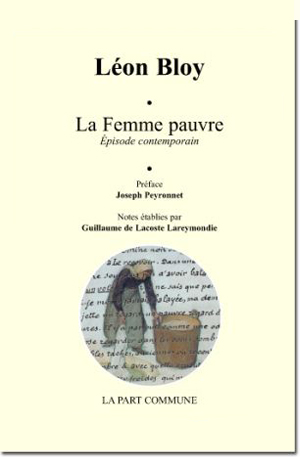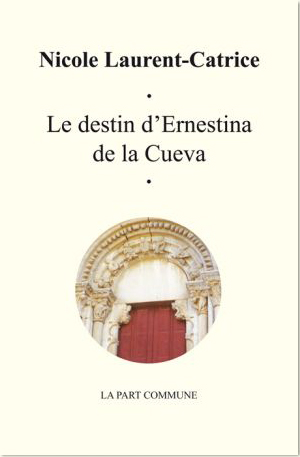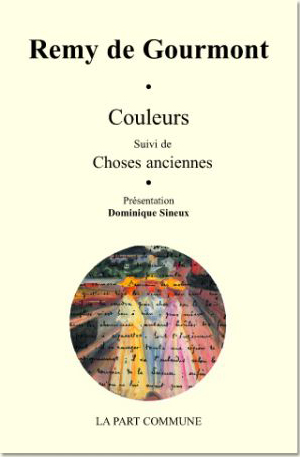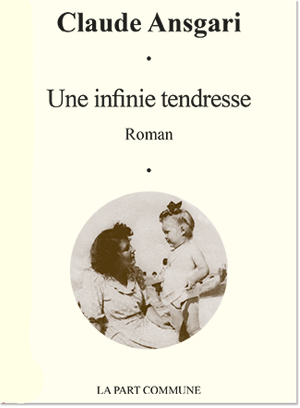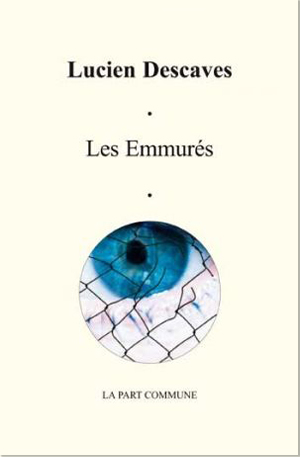Je m’appelle Pierre et je me demande pourquoi je suis encore vivant. Je ne me suis pas vu vieillir ou je n’ai pas voulu. Il faut croire que j’attendais ce temps plus que tout autre chose. Agrippé à des moments que je croyais importants. Je ne me trouve aucune excuse. Il est trop tard pour ça. J’aurais dû certainement les occuper différemment. Chercher à les confondre pour mieux me comprendre et comprendre le monde. Je reconnais n’y avoir jamais pensé. Ce sont maintenant des fantômes pour mes sommeils difficiles car les hommes et les femmes qui les habitaient n’ont pas disparu pour autant, ni les plaies et les bosses que nous nous faisions. Je leur serre encore la main dans mes nuits. J’ai ainsi traversé les années sans rien leur réclamer. Des coups de gueule partagés, des coups de poing que j’avais donnés et pris. Après ou avant l’alcool. Des coups de cœur aussi, des « pour de vrai » aussitôt avalés en enlevant ce qui nous tenait lieu de vêtements, pas grand-chose, prêtés contre un printemps ou échangés pour un été, histoire de nous frotter les yeux et les corps.
Oui, ils sont là, devant moi, de l’autre côté de la table en formica, assis sur des chaises en bois, leurs sourires en coin. Et je sais qu’ils me provoqueront jusqu’à la fin en me saluant de loin. Je les entends claquer les portes quand ils s’énervent. C’est tout juste s’ils ne chantent pas a cappella pour se moquer. Leurs rires ne veulent pas mourir. J’essaie de garder mon calme, je les laisse passer, je refuse de crier à mon tour et de me mêler à leur farandole. J’attends les paumes pressées sur mes oreilles. De partir, de revenir. J’attends paupières fermées. Je veux encore croire qu’il est possible d’avoir une vie. D’oublier celle que je n’ai pas eue et d’en vouloir plus malgré tout. La liberté, j’en avais rêvé comme eux. J’avais alors les jambes cotonneuses d’un adolescent. Quatorze ans, de l’acné et aucun souci d’épargner les grands mots payés dans des livres à bon marché. M’embarquer une fois pour toutes vers les Amériques ou vers l’Orient, qu’importe, il n’y avait là que des voyages à rêver, des îles à découvrir et des solstices à entreprendre. Je connaissais par cœur mes rues pavées et les deux pièces qui se cachaient derrière les façades noires de suie. Je brûlais de signer un bon d’engagement d’une tape sur l’épaule et de fêter l’événement à autre chose que de l’eau douce. Tout l’inverse s’est produit.
N’allez pas penser que je suis malade ou désespéré. Au contraire. Si ces voix, décousues, rayées, aiguës ou graves, soufflent dans ma tête, si ces ombres persistantes se penchent silencieusement vers moi jusqu’à me faire sursauter, c’est qu’elles ont beaucoup compté. Je les ai aimées. Elles étaient mes témoins d’existence. Rien d’extraordinaire ni de philosophique cependant. Aristote, Socrate, Descartes, Sartre et leurs figures singulières ne nous impressionnaient pas. Trop sèches. Nous préférions parler bonheur, amour, enthousiasme, vérité dans nos jeunes bavardages, nous voulions les étaler sur nous dans un plaisir sans calcul. Il nous fallait l’intensité plus que l’équilibre, l’instant en lieu et place de la durée. La question ne se posait pas de savoir si nous pouvions nous gagner un supplément de vie ou nous perdre dans des lendemains frelatés. La tranquillité d’un agencement reconnu et admis pour toujours ne figurait pas au programme. Il y avait là un appétit à refaire le monde ou tout au moins à refuser qu’il soit écrit d’avance. Les risques valaient bien plus et même davantage que les heures de solitude où chacun s’enferme dans des cités impossibles, où personne n’est appelé à rien sauf à courir après les jours de travail et à s’affaler les soirs dans un fauteuil fatigué, le regard posé sur le vide d’écrans neigeux.
Mes parents nous avaient avertis qu’ils comptaient sur nous pour prendre un chemin différent du leur. Nous étions quatre entre frères et sœurs, un par an, deux filles, deux garçons dans cet ordre. Les aînées, cheveux naturellement frisés, les plus jeunes coupés en brosse. Des enfants de six heures pour les matins ouvriers, des oiseaux couchés tard les uns contre les autres dissimulant la nuit sous les couvertures. Puis des adultes en herbe aux escapades amoureuses et souvent contrariées. La tendresse ne manquait pas, elle se multipliait par quatre. Et le courage des parents par le nombre de bouches à nourrir. Nous n’attendions pas notre reste de poulet ou de rosbif les dimanches. La pomme ou l’orange avalée, le père signifiait la fin du repas en tassant son tabac dans une rouleuse à cigarettes. Nous entamions alors le service vaisselle, la mère pestant contre les éclaboussures que nous allions étaler partout sous nos pieds. La tâche une fois accomplie, et quelle que soit l’humeur du ciel, nous sortions jouer au parc où les bateaux miniatures à quilles mélangeaient leurs voiles. Par beau temps, nous poursuivions notre promenade vers la Seine, ses eaux toujours grises et ses péniches flottant au ras de l’eau. Il y avait foule à déambuler et à se saluer poliment en silence. Mes sœurs ont appris là, j’en suis certain, à rouler les hanches qu’elles avaient déjà plutôt rondes.
Chez nous, l’éducation était du genre serré. L’école, le lycée puis au moins pour certains l’université, voilà ce qu’attendaient les parents. Tableau d’honneur ou félicitations de préférence. Travailler, voilà leur premier credo. Et en y mettant si possible de la joie, le second. J’étais le dernier et plus le temps passait, plus leurs espoirs se reportaient sur moi. Un fardeau trop lourd à porter. L’ingéniosité ne manquait pas à mon père dans ses œuvres. Nous avions deux coffres à battants fixés au mur de la salle-à-manger-cuisine pour gagner de la place, un pour les filles, l’autre pour les garçons où nous pouvions nous installer chacun à notre tour. À ouverture verticale, ils formaient une table miniature sur laquelle il valait mieux ne pas poser des coudes. Des casiers intérieurs pour les crayons, les gommes, les ciseaux, quelques cahiers et surtout la pièce maîtresse, le dictionnaire. Un coffre en bois servait de siège et de réserve pour nos livres de classe ou de lecture. Des « bibliothèque verte » pour l’essentiel avec couvertures cartonnées et lettres dorées que nous nous empressions de protéger par un film transparent. Le tout d’une bonne odeur mélangée de papier et d’encaustique. Jules Verne s’affichait en abondance et c’est peut-être là que tout a commencé pour moi.
Dès le printemps et tout l’été, bonimenteurs, musiciens et autres saltimbanques, debout ou assis sur des chaises pliantes, se pressaient sur les lieux. Nous nous arrêtions, ébahis par les tours d’adresse, les notes d’accordéon et les accroches de guitare. Ils savaient inviter les passants à laisser tomber une pièce généreuse dans leurs bérets ou leurs boites de fer blanc. Je préférais m’approcher des comédiens, jamais plus de deux ou trois ensemble, maniant les mots et le verbe sans bégaiement aucun. Ils nous invitaient à les partager comme si nous étions des connaissances de longue date. Ces ambulants du plein air avaient un don incontestable pour les phrases polies main, de celles qui vous convertissent à l’oral et font oublier la pénibilité de l’écrit. Nul besoin de planches pour leurs commerces de rue. Des grands gaillards broussailleux, des demoiselles aux mascaras colorés assaisonnaient les textes de répliques à vous fâcher avec la langue des banlieues. Je retrouvais là les lectures servies aux publics railleurs du théâtre de foire cher à Alain-René Lesage. Un autre siècle, certes, mais un siècle où le comique, la verve, les saillies, à défaut d’argent, se payaient pour presque rien et parfois gracieusement les portraits des puissants.
Je les entendais encore en m’endormant. Je voyais leurs gestes plus larges sous leurs déguisements. D’où venaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Leurs journées s’envolaient-elles comme les miennes ? Ou plus vite encore ? J’aurais tant aimé les retenir, avoir des projets à leur confier. Suivre le soleil que je devinais à travers eux. Ne serait-ce qu’une heure. Et la conclure d’un accord signé de regards déjà complices. Je me voyais fermer en tremblant ma valise. J’étais libre. Prêt à couper vers l’autre bout du monde. Celui dont j’ignorais tout. Je murmurais ces rêves dans mon demi-sommeil. Mon frère, dérangé dans le sien, me secouait durement. J’ouvrais les yeux sur la table ronde au pied du lit, la lampe penchée vers moi. La réalité me rattrapait. Les bruits de pas dans l’immeuble. Les voitures klaxonnant dans la rue. Les radios s’époumonant dans le bâtiment d’en face. Je n’avais pas bougé. Inutile de me voiler la face, j’avais une fois de plus échoué à m’échapper pour de bon. Les quelques onces d’imaginaire dont je disposais s’arrêtaient là où commençaient les usines. L’abstraction n’y existait pas. Mes nuances de couleurs prenaient la lumière comme une poussière blanche trop présente. Je restais persuadé, envers et contre tout, que la vie ailleurs avait un mot à me dire. Elle ne pouvait pas m’avoir déjà été volée et je ne comptais pas y renoncer de sitôt.
Ce trop-plein d’exigences auxquelles faire face, cette somme d’obligations à respecter, d’injonctions permanentes à réussir, oui, je voulais mes dix-sept ans différents, les laisser vivre autrement qu’une parenthèse, ne plus répondre de rien et protester contre tout. Je voulais pousser la porte d’entrée pour jouer avec le vent. Et pourquoi ne pas changer de nom et de prénom, me glisser dans l’inconnu, passer les frontières. J’étais devant une immense toile blanche, vide ou presque, et je voulais l’écrire d’une traite, des ébauches peut-être au début pour mieux m’en approcher. J’avais suffisamment de lettres à articuler pour m’y mettre de bon appétit. Des tâtonnements certes, des petits pas encore comme lorsque nous croyons à l’enfance devenir les maîtres du monde. J’avais eu ces démangeaisons que nous connaissons tous à l’adolescence. Puis cette envie de vraies enjambées. De celles qui nous portent vers plus de liberté, à la recherche d’autres accents, d’autres visages, dans l’espoir d’une autre naissance. Défaire ces vérités apparentes qui nous encombrent, démonter ces mensonges sur nous-mêmes, les secouer suffisamment fort pour les mettre à mal. En un mot, entrer en dissidence, à l’écart, loin de tous les conformismes du jour pour, enfin, parler ensemble de ce que nous avons sous les yeux et que nous ne voyons pas.
Ne me dites pas que vous n’en avez jamais rêvé, je ne vous croirai pas. Beaux ou mauvais rêves, étranges conversations, peu importe quand là il s’agit de vivre sans perdre de temps. Et sans les modes d’emploi imposés avant l’heure. L’âge de tous les hasards de rencontres et des excès à grande échelle où nous pouvons soit couler, soit grandir. Pancarte de réfractaire à la main, prises de position politique plus affirmées que bien arrêtées, expérience de réalités soi-disant décisives, il fallait craquer les codes de bonne conduite. Nous étions des centaines dans cette course sans carte ni compas à fuir les fausses évidences, la logique d’une époque délétère. À refuser de reporter le meilleur pour la fin. Nous avions cette soif de découvrir une terre n’appartenant à personne et qu’il suffirait de défricher pour y vivre en paix. Des innocents selon certains, des naïfs pour d’autres. Nous ne savions pas que nos faits et gestes feraient les unes des journaux. Et nos consommations, des objets de scandale. Nous avions nous aussi nos démons bien sûr à conjurer. Nos périodes de flottement et d’attente s’allongeaient souvent sur des matins sans titre et des soirées loin d’être toutes rieuses. Les corps que nous nous prêtions n’étaient pas aussi substituables que nous l’avions cru. Jalousies, rivalités, égos, critiques, rancœurs, petites méchancetés soufflent encore près d’un demi-siècle plus tard et de cette intensité en clair-obscur, malgré ou à cause d’elle, il fût un temps où j’aurais voulu témoigner de cette histoire. Me livrer en somme.
Enfants de 68
Les deux principaux personnages de ce roman sont à leur manière des enfants de 68. Le plus jeune par sa naissance, le plus âgé par la liberté qu’il y a acquise. 68, ce temps où il était « interdit d’interdire », ce temps « d’amour libre » et « d’enfants fleurs » où les mots n’étaient pas cher payés. Utopie pour certains, révolte pour d’autres, un « gauchisme existentiel » dira plus tard Edgar Morin. Leur rencontre improbable dans cette vallée perdue des Cévennes va révéler ce qu’ils ont espéré et rêvé, ce qu’ils auront aussi manqué. Deux vies donc remplies d’ombres, de silhouettes aimées et perdues, de voyages de hasard allant de « Be-in » en « Bed-in ». De ces deux vies que reste-t-il ? La fin d’une histoire ou une histoire à commencer ?
Format : 12×17
Nombre de pages : 248 pages
ISBN : 978-2-84418-349-1
Année de parution : 2017
17,00 €
| Poids | 101 g |
|---|---|
| Auteur |
Coatrieux Jean-Louis |
| Éditeur |
Collection La Part Classique |